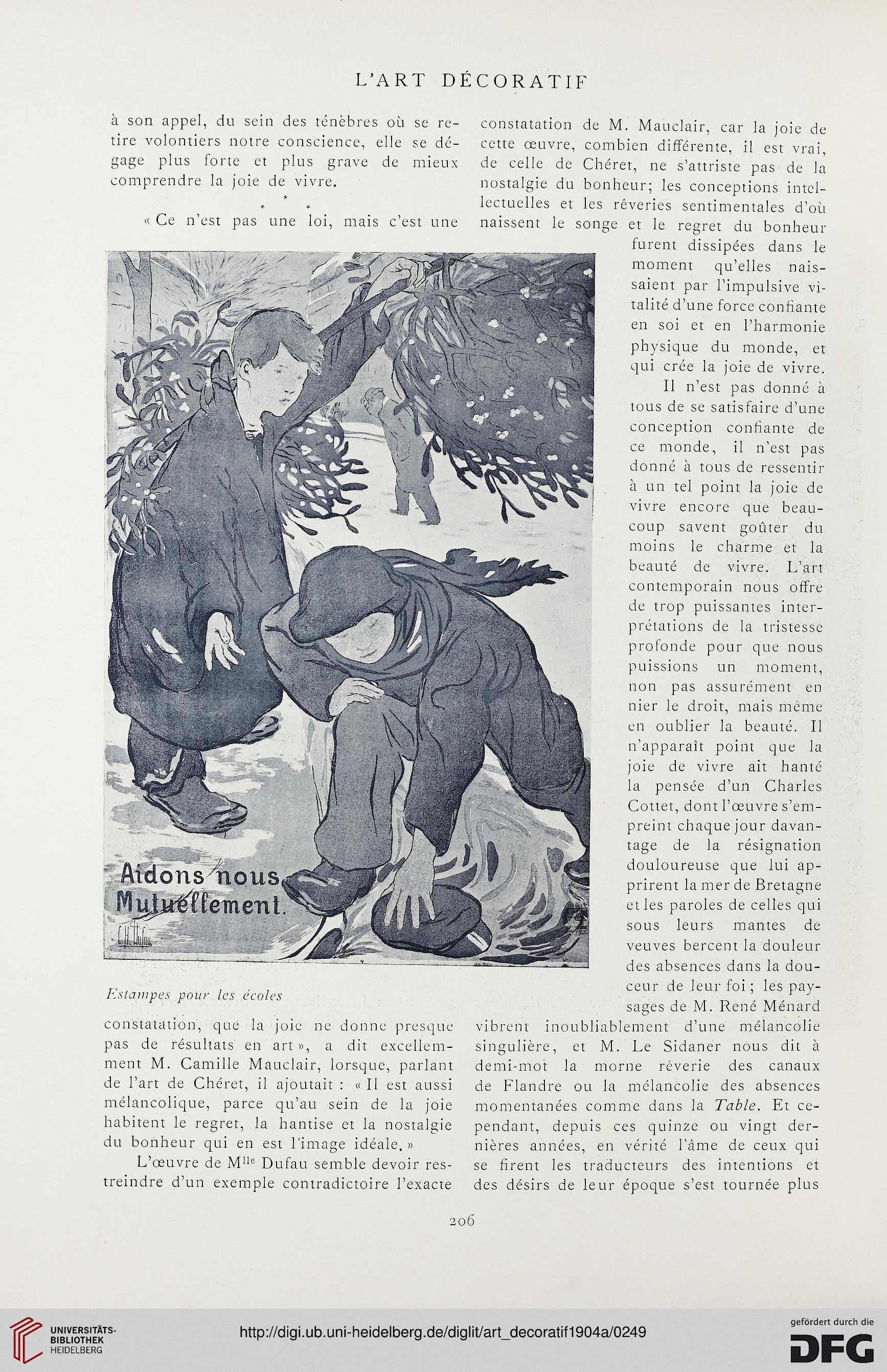L'ART DECORATIF
à son appel, du sein des ténèbres où se re-
tire volontiers notre conscience, elle se dé-
gage plus forte et plus grave de mieux
comprendre la joie de vivre.
Ce n'est pas mm loi, niais c'est une
7fs/a77;pes po;/7* /e-s
constatation, que la joie ne donne presque
pas de résultats en art », a dit excellem-
ment M. Camille Mauclair, lorsque, parlant
de l'art de Chérct, il ajoutait : M II est aussi
mélancolique, parce qu'au sein de la joie
habitent le regret, la hantise et la nostalgie
du bonheur qui en est l'image idéale. »
L'œuvre de Dufau semble devoir res-
treindre d'un exemple contradictoire l'exacte
constatation de M. Mauclair, car la joie de
cette œuvre, combien différente, il est vrai,
de celle de Chéret, ne s'attriste pas de la
nostalgie du bonheur; les conceptions intel-
lectuelles et les rêveries sentimentales d'où
naissent le songe et le regret du bonheur
lurent dissipées dans le
moment qu'elles nais-
saient par l'impulsive vi-
talité d'une force confiante
en soi et en l'harmonie
physique du monde, et
qui crée la joie de vivre.
Il n'est pas donné à
tous de se satisfaire d'une
conception confiante de
ce monde, il n'est pas
donné à tous de ressentir
à un tel point la joie de
vivre encore que beau-
coup savent goûter du
moins le charme et la
beauté de vivre. L'art
contemporain nous offre
de trop puissantes inter-
prétations de la tristesse
profonde pour que nous
puissions un moment,
non pas assurément en
nier le droit, mais meme
en oublier la beauté. Il
n'apparaît point que la
joie de vivre ait hanté
la pensée d'un Charles
Cottet, dont l'œuvre s'em-
preint chaque jour davan-
tage de la résignation
douloureuse que lui ap-
prirent la mer de Bretagne
et les paroles de celles qui
sous leurs mantes de
veuves bercent la douleur
des absences dans la dou-
ceur de leur foi ; les pay-
sages de M. René Ménard
vibrent inoubliablement d'une mélancolie
singulière, et M. Le Sidaner nous dit à
demi-mot la morne rêverie des canaux
de Flandre ou la mélancolie des absences
momentanées comme dans la 71DA. Et ce-
pendant, depuis ces quinze ou vingt der-
nières années, en vérité l'àme de ceux qui
se firent les traducteurs des intentions et
des désirs de leur époque s'est tournée plus
206
à son appel, du sein des ténèbres où se re-
tire volontiers notre conscience, elle se dé-
gage plus forte et plus grave de mieux
comprendre la joie de vivre.
Ce n'est pas mm loi, niais c'est une
7fs/a77;pes po;/7* /e-s
constatation, que la joie ne donne presque
pas de résultats en art », a dit excellem-
ment M. Camille Mauclair, lorsque, parlant
de l'art de Chérct, il ajoutait : M II est aussi
mélancolique, parce qu'au sein de la joie
habitent le regret, la hantise et la nostalgie
du bonheur qui en est l'image idéale. »
L'œuvre de Dufau semble devoir res-
treindre d'un exemple contradictoire l'exacte
constatation de M. Mauclair, car la joie de
cette œuvre, combien différente, il est vrai,
de celle de Chéret, ne s'attriste pas de la
nostalgie du bonheur; les conceptions intel-
lectuelles et les rêveries sentimentales d'où
naissent le songe et le regret du bonheur
lurent dissipées dans le
moment qu'elles nais-
saient par l'impulsive vi-
talité d'une force confiante
en soi et en l'harmonie
physique du monde, et
qui crée la joie de vivre.
Il n'est pas donné à
tous de se satisfaire d'une
conception confiante de
ce monde, il n'est pas
donné à tous de ressentir
à un tel point la joie de
vivre encore que beau-
coup savent goûter du
moins le charme et la
beauté de vivre. L'art
contemporain nous offre
de trop puissantes inter-
prétations de la tristesse
profonde pour que nous
puissions un moment,
non pas assurément en
nier le droit, mais meme
en oublier la beauté. Il
n'apparaît point que la
joie de vivre ait hanté
la pensée d'un Charles
Cottet, dont l'œuvre s'em-
preint chaque jour davan-
tage de la résignation
douloureuse que lui ap-
prirent la mer de Bretagne
et les paroles de celles qui
sous leurs mantes de
veuves bercent la douleur
des absences dans la dou-
ceur de leur foi ; les pay-
sages de M. René Ménard
vibrent inoubliablement d'une mélancolie
singulière, et M. Le Sidaner nous dit à
demi-mot la morne rêverie des canaux
de Flandre ou la mélancolie des absences
momentanées comme dans la 71DA. Et ce-
pendant, depuis ces quinze ou vingt der-
nières années, en vérité l'àme de ceux qui
se firent les traducteurs des intentions et
des désirs de leur époque s'est tournée plus
206