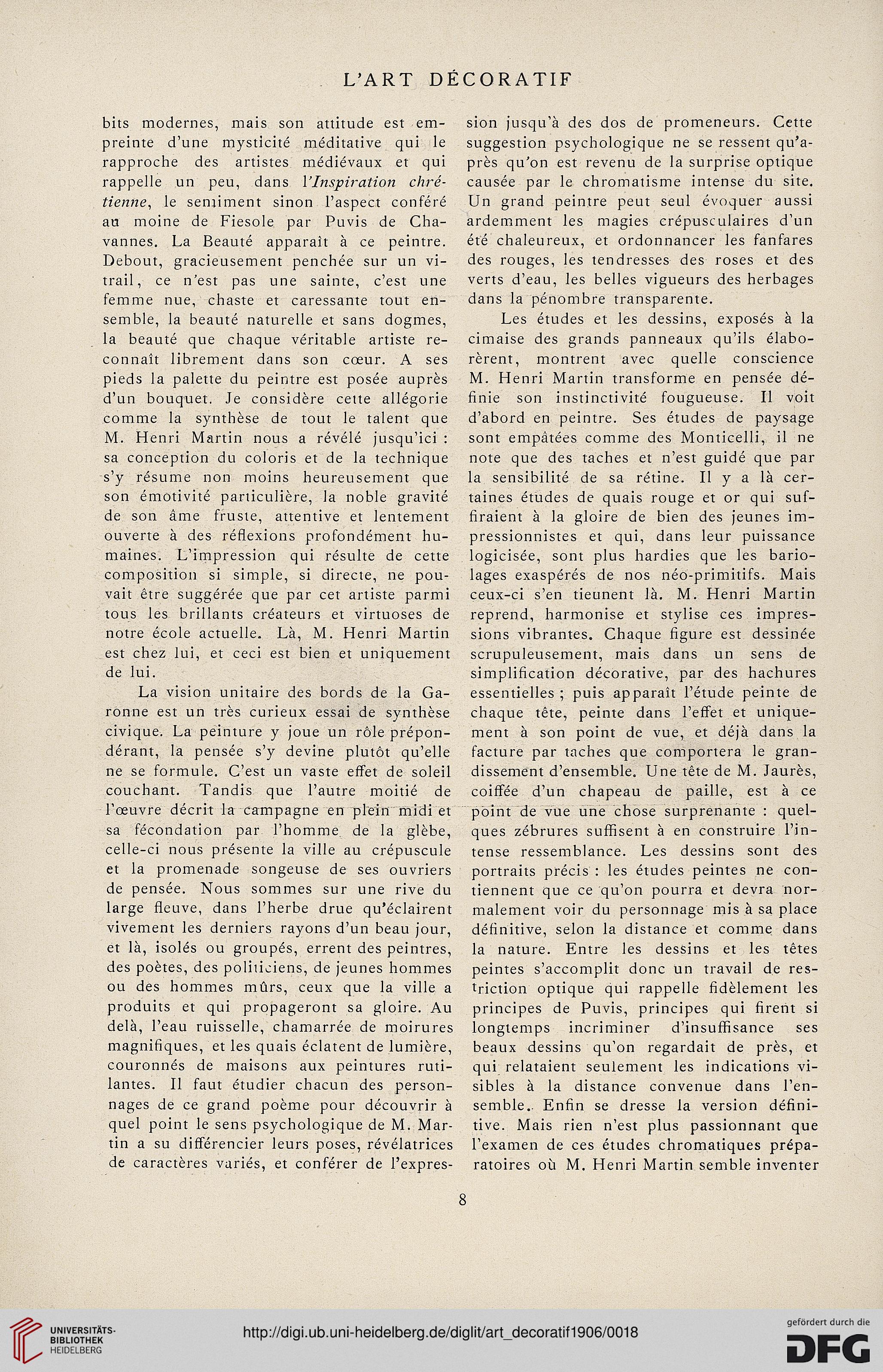L'ART DECORATIF
bits modernes, mais son attitude est em-
preinte d'une mysticité méditative qui ie
rapproche des artistes médiévaux et qui
rappelie un peu, dans lV??.SjPzr<3Ao7z c/?ré-
fz'<?7z?ze, le sentiment sinon l'aspect conféré
au moine de Fiesole par Puvis de Cha-
vannes. La Beauté apparaît à ce peintre.
Debout, gracieusement penchée sur un vi-
trail, ce n'est pas une sainte, c'est une
femme nue, chaste et caressante tout en-
semble, la beauté naturelle et sans dogmes,
la beauté que chaque véritable artiste re-
connaît librement dans son cœur. A ses
pieds la palette du peintre est posée auprès
d'un bouquet. Je considère cette allégorie
comme la synthèse de tout le talent que
M. Henri Martin nous a révélé jusqu'ici :
sa conception du coloris et de la technique
s'y résume non moins heureusement que
son émotivité particulière, la noble gravité
de son âme fruste, attentive et lentement
ouverte à des réflexions profondément hu-
maines. L'impression qui résulte de cette
composition si simple, si directe, ne pou-
vait être suggérée que par cet artiste parmi
tous les brillants créateurs et virtuoses de
notre école actuelle. Là, M. Henri Martin
est chez lui, et ceci est bien et uniquement
de lui.
La vision unitaire des bords de la Ga-
ronne est un très curieux essai de synthèse
civique. La peinture y joue un rôle prépon-
dérant, la pensée s'y devine plutôt qu'elle
ne se formule. C'est un vaste effet de soleil
couchant. Tandis que l'autre moitié de
l'œuvre décrit la campagne en plein midi et
sa fécondation par l'homme de la glèbe,
celle-ci nous présente la ville au crépuscule
et la promenade songeuse de ses ouvriers
de pensée. Nous sommes sur une rive du
large fleuve, dans l'herbe drue qu'éclairent
vivement les derniers rayons d'un beau jour,
et là, isolés ou groupés, errent des peintres,
des poètes, des politiciens, de jeunes hommes
ou des hommes mûrs, ceux que la ville a
produits et qui propageront sa gloire. Au
delà, l'eau ruisselle, chamarrée de moirures
magnifiques, et les quais éclatent de lumière,
couronnés de maisons aux peintures ruti-
lantes. Il faut étudier chacun des person-
nages de ce grand poème pour découvrir à
quel point le sens psychologique de M. Mar-
tin a su différencier leurs poses, révélatrices
de caractères variés, et conférer de l'expres-
sion jusqu'à des dos de promeneurs. Cette
suggestion psychologique ne se ressent qu'a-
près qu'on est revenu de la surprise optique
causée par le chromatisme intense du site.
Un grand peintre peut seul évoquer aussi
ardemment les magies crépusculaires d'un
été chaleureux, et ordonnancer les fanfares
des rouges, les tendresses des roses et des
verts d'eau, les belles vigueurs des herbages
dans la pénombre transparente.
Les études et les dessins, exposés à la
cimaise des grands panneaux qu'ils élabo-
rèrent, montrent avec quelle conscience
M. Henri Martin transforme en pensée dé-
finie son instinctivité fougueuse. Il voit
d'abord en peintre. Ses études de paysage
sont empâtées comme des Monticelli, il ne
note que des taches et n'est guidé que par
la sensibilité de sa rétine. Il y a là cer-
taines études de quais rouge et or qui suf-
firaient à la gloire de bien des jeunes im-
pressionnistes et qui, dans leur puissance
logicisée, sont plus hardies que les bario-
lages exaspérés de nos néo-primitifs. Mais
ceux-ci s'en tiennent là. M. Henri Martin
reprend, harmonise et stylise ces impres-
sions vibrantes. Chaque figure est dessinée
scrupuleusement, mais dans un sens de
simplification décorative, par des hachures
essentielles ; puis apparaît l'étude peinte de
chaque tête, peinte dans l'effet et unique-
ment à son point de vue, et déjà dans la
facture par taches que comportera le gran-
dissement d'ensemble. Une tête de M. Jaurès,
coiffée d'un chapeau de paille, est à ce
point de vue une chose surprenante : quel-
ques zébrures suffisent à en construire l'in-
tense ressemblance. Les dessins sont des
portraits précis : les études peintes ne con-
tiennent que ce qu'on pourra et devra nor-
malement voir du personnage mis à sa place
définitive, selon la distance et comme dans
la nature. Entre les dessins et les têtes
peintes s'accomplit donc un travail de res-
triction optique qui rappelle fidèlement les
principes de Puvis, principes qui firent si
longtemps incriminer d'insuffisance ses
beaux dessins qu'on regardait de près, et
qui relataient seulement les indications vi-
sibles à la distance convenue dans l'en-
semble. Enfin se dresse la version défini-
tive. Mais rien n'est plus passionnant que
l'examen de ces études chromatiques prépa-
ratoires où M. Henri Martin semble inventer
bits modernes, mais son attitude est em-
preinte d'une mysticité méditative qui ie
rapproche des artistes médiévaux et qui
rappelie un peu, dans lV??.SjPzr<3Ao7z c/?ré-
fz'<?7z?ze, le sentiment sinon l'aspect conféré
au moine de Fiesole par Puvis de Cha-
vannes. La Beauté apparaît à ce peintre.
Debout, gracieusement penchée sur un vi-
trail, ce n'est pas une sainte, c'est une
femme nue, chaste et caressante tout en-
semble, la beauté naturelle et sans dogmes,
la beauté que chaque véritable artiste re-
connaît librement dans son cœur. A ses
pieds la palette du peintre est posée auprès
d'un bouquet. Je considère cette allégorie
comme la synthèse de tout le talent que
M. Henri Martin nous a révélé jusqu'ici :
sa conception du coloris et de la technique
s'y résume non moins heureusement que
son émotivité particulière, la noble gravité
de son âme fruste, attentive et lentement
ouverte à des réflexions profondément hu-
maines. L'impression qui résulte de cette
composition si simple, si directe, ne pou-
vait être suggérée que par cet artiste parmi
tous les brillants créateurs et virtuoses de
notre école actuelle. Là, M. Henri Martin
est chez lui, et ceci est bien et uniquement
de lui.
La vision unitaire des bords de la Ga-
ronne est un très curieux essai de synthèse
civique. La peinture y joue un rôle prépon-
dérant, la pensée s'y devine plutôt qu'elle
ne se formule. C'est un vaste effet de soleil
couchant. Tandis que l'autre moitié de
l'œuvre décrit la campagne en plein midi et
sa fécondation par l'homme de la glèbe,
celle-ci nous présente la ville au crépuscule
et la promenade songeuse de ses ouvriers
de pensée. Nous sommes sur une rive du
large fleuve, dans l'herbe drue qu'éclairent
vivement les derniers rayons d'un beau jour,
et là, isolés ou groupés, errent des peintres,
des poètes, des politiciens, de jeunes hommes
ou des hommes mûrs, ceux que la ville a
produits et qui propageront sa gloire. Au
delà, l'eau ruisselle, chamarrée de moirures
magnifiques, et les quais éclatent de lumière,
couronnés de maisons aux peintures ruti-
lantes. Il faut étudier chacun des person-
nages de ce grand poème pour découvrir à
quel point le sens psychologique de M. Mar-
tin a su différencier leurs poses, révélatrices
de caractères variés, et conférer de l'expres-
sion jusqu'à des dos de promeneurs. Cette
suggestion psychologique ne se ressent qu'a-
près qu'on est revenu de la surprise optique
causée par le chromatisme intense du site.
Un grand peintre peut seul évoquer aussi
ardemment les magies crépusculaires d'un
été chaleureux, et ordonnancer les fanfares
des rouges, les tendresses des roses et des
verts d'eau, les belles vigueurs des herbages
dans la pénombre transparente.
Les études et les dessins, exposés à la
cimaise des grands panneaux qu'ils élabo-
rèrent, montrent avec quelle conscience
M. Henri Martin transforme en pensée dé-
finie son instinctivité fougueuse. Il voit
d'abord en peintre. Ses études de paysage
sont empâtées comme des Monticelli, il ne
note que des taches et n'est guidé que par
la sensibilité de sa rétine. Il y a là cer-
taines études de quais rouge et or qui suf-
firaient à la gloire de bien des jeunes im-
pressionnistes et qui, dans leur puissance
logicisée, sont plus hardies que les bario-
lages exaspérés de nos néo-primitifs. Mais
ceux-ci s'en tiennent là. M. Henri Martin
reprend, harmonise et stylise ces impres-
sions vibrantes. Chaque figure est dessinée
scrupuleusement, mais dans un sens de
simplification décorative, par des hachures
essentielles ; puis apparaît l'étude peinte de
chaque tête, peinte dans l'effet et unique-
ment à son point de vue, et déjà dans la
facture par taches que comportera le gran-
dissement d'ensemble. Une tête de M. Jaurès,
coiffée d'un chapeau de paille, est à ce
point de vue une chose surprenante : quel-
ques zébrures suffisent à en construire l'in-
tense ressemblance. Les dessins sont des
portraits précis : les études peintes ne con-
tiennent que ce qu'on pourra et devra nor-
malement voir du personnage mis à sa place
définitive, selon la distance et comme dans
la nature. Entre les dessins et les têtes
peintes s'accomplit donc un travail de res-
triction optique qui rappelle fidèlement les
principes de Puvis, principes qui firent si
longtemps incriminer d'insuffisance ses
beaux dessins qu'on regardait de près, et
qui relataient seulement les indications vi-
sibles à la distance convenue dans l'en-
semble. Enfin se dresse la version défini-
tive. Mais rien n'est plus passionnant que
l'examen de ces études chromatiques prépa-
ratoires où M. Henri Martin semble inventer