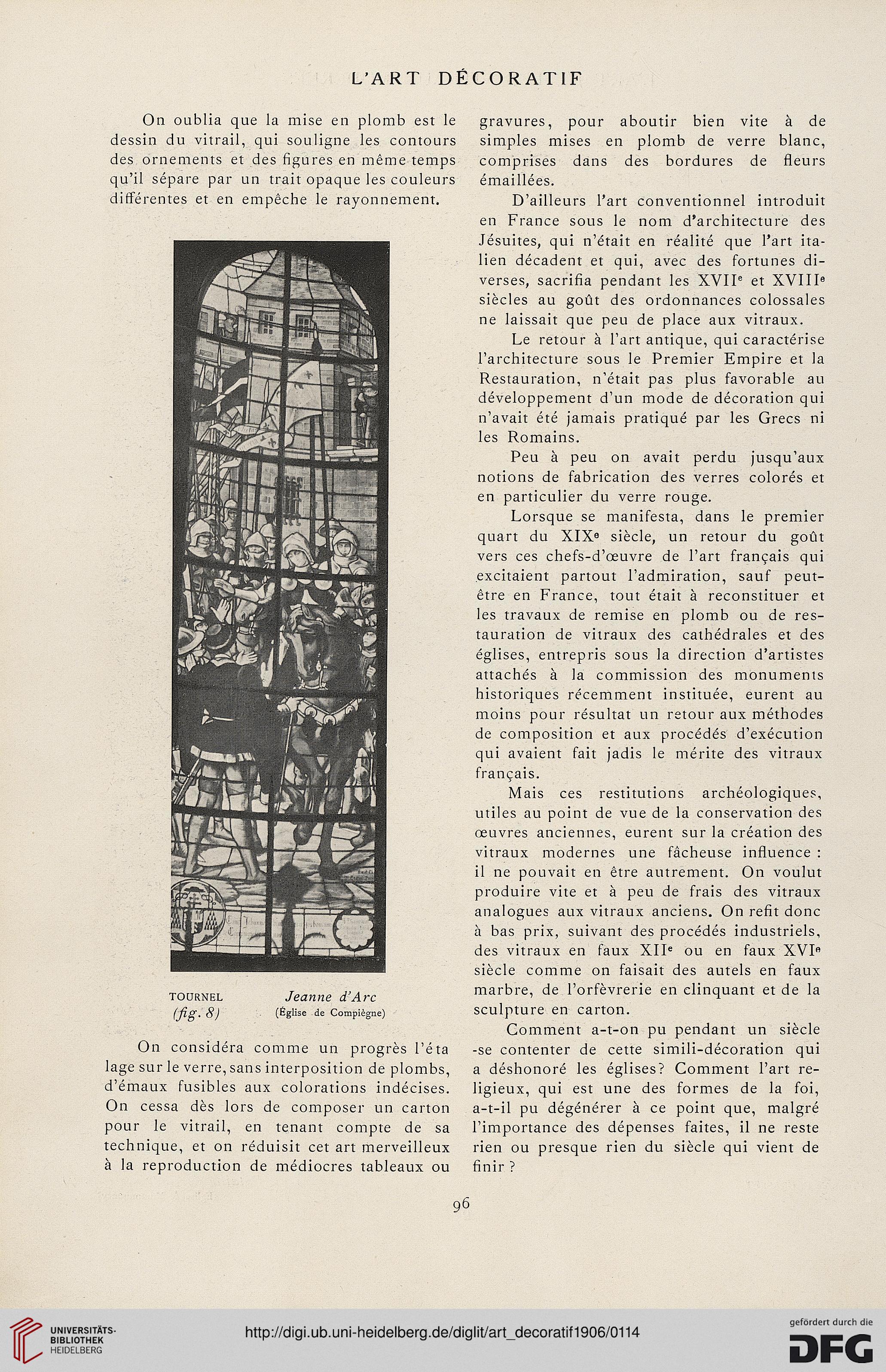L'ART DÉCORATIF
On oublia que la mise en plomb est le
dessin du vitrait, qui souligne les contours
des ornements et des figures en même temps
qu'il sépare par un trait opaque les couleurs
différentes et en empêche le rayonnement.
TOURNEL Je<27??ze dh4rc
On considéra comme un progrès l'éta
lagc sur le verre, sans interposition de plombs,
d'émaux fusibles aux colorations indécises.
On cessa dès lors de composer un carton
pour le vitrail, en tenant compte de sa
technique, et on réduisit cet art merveilleux
à la reproduction de médiocres tableaux ou
gravures, pour aboutir bien vite à de
simples mises en plomb de verre blanc,
comprises dans des bordures de fleurs
émaillées.
D'ailleurs l'art conventionnel introduit
en France sous le nom d'architecture des
Jésuites, qui n'était en réalité que l'art ita-
lien décadent et qui, avec des fortunes di-
verses, sacrifia pendant les XVII" et XVIII"
siècles au goût des ordonnances colossales
ne laissait que peu de place aux vitraux.
Le retour à l'art antique, qui caractérise
l'architecture sous le Premier Empire et la
Restauration, n'était pas plus favorable au
développement d'un mode de décoration qui
n'avait été jamais pratiqué par les Grecs ni
les Romains.
Peu à peu on avait perdu jusqu'aux
notions de fabrication des verres colorés et
en particulier du verre rouge.
Lorsque se manifesta, dans le premier
quart du XIX" siècle, un retour du goût
vers ces chefs-d'œuvre de l'art français qui
excitaient partout l'admiration, sauf peut-
être en France, tout était à reconstituer et
les travaux de remise en plomb ou de res-
tauration de vitraux des cathédrales et des
églises, entrepris sous la direction d'artistes
attachés à la commission des monuments
historiques récemment instituée, eurent au
moins pour résultat un retour aux méthodes
de composition et aux procédés d'exécution
qui avaient fait jadis le mérite des vitraux
français.
Mais ces restitutions archéologiques,
utiles au point de vue de la conservation des
œuvres anciennes, eurent sur la création des
vitraux modernes une fâcheuse influence :
il ne pouvait en être autrement. On voulut
produire vite et à peu de frais des vitraux
analogues aux vitraux anciens. On refit donc
à bas prix, suivant des procédés industriels,
des vitraux en faux XII" ou en faux XVI"
siècle comme on faisait des autels en faux
marbre, de l'orfèvrerie en clinquant et de la
sculpture en carton.
Comment a-t-on pu pendant un siècle
-se contenter de cette simili-décoration qui
a déshonoré les églises? Comment l'art re-
ligieux, qui est une des formes de la foi,
a-t-il pu dégénérer à ce point que, malgré
l'importance des dépenses faites, il ne reste
rien ou presque rien du siècle qui vient de
finir ?
96
On oublia que la mise en plomb est le
dessin du vitrait, qui souligne les contours
des ornements et des figures en même temps
qu'il sépare par un trait opaque les couleurs
différentes et en empêche le rayonnement.
TOURNEL Je<27??ze dh4rc
On considéra comme un progrès l'éta
lagc sur le verre, sans interposition de plombs,
d'émaux fusibles aux colorations indécises.
On cessa dès lors de composer un carton
pour le vitrail, en tenant compte de sa
technique, et on réduisit cet art merveilleux
à la reproduction de médiocres tableaux ou
gravures, pour aboutir bien vite à de
simples mises en plomb de verre blanc,
comprises dans des bordures de fleurs
émaillées.
D'ailleurs l'art conventionnel introduit
en France sous le nom d'architecture des
Jésuites, qui n'était en réalité que l'art ita-
lien décadent et qui, avec des fortunes di-
verses, sacrifia pendant les XVII" et XVIII"
siècles au goût des ordonnances colossales
ne laissait que peu de place aux vitraux.
Le retour à l'art antique, qui caractérise
l'architecture sous le Premier Empire et la
Restauration, n'était pas plus favorable au
développement d'un mode de décoration qui
n'avait été jamais pratiqué par les Grecs ni
les Romains.
Peu à peu on avait perdu jusqu'aux
notions de fabrication des verres colorés et
en particulier du verre rouge.
Lorsque se manifesta, dans le premier
quart du XIX" siècle, un retour du goût
vers ces chefs-d'œuvre de l'art français qui
excitaient partout l'admiration, sauf peut-
être en France, tout était à reconstituer et
les travaux de remise en plomb ou de res-
tauration de vitraux des cathédrales et des
églises, entrepris sous la direction d'artistes
attachés à la commission des monuments
historiques récemment instituée, eurent au
moins pour résultat un retour aux méthodes
de composition et aux procédés d'exécution
qui avaient fait jadis le mérite des vitraux
français.
Mais ces restitutions archéologiques,
utiles au point de vue de la conservation des
œuvres anciennes, eurent sur la création des
vitraux modernes une fâcheuse influence :
il ne pouvait en être autrement. On voulut
produire vite et à peu de frais des vitraux
analogues aux vitraux anciens. On refit donc
à bas prix, suivant des procédés industriels,
des vitraux en faux XII" ou en faux XVI"
siècle comme on faisait des autels en faux
marbre, de l'orfèvrerie en clinquant et de la
sculpture en carton.
Comment a-t-on pu pendant un siècle
-se contenter de cette simili-décoration qui
a déshonoré les églises? Comment l'art re-
ligieux, qui est une des formes de la foi,
a-t-il pu dégénérer à ce point que, malgré
l'importance des dépenses faites, il ne reste
rien ou presque rien du siècle qui vient de
finir ?
96