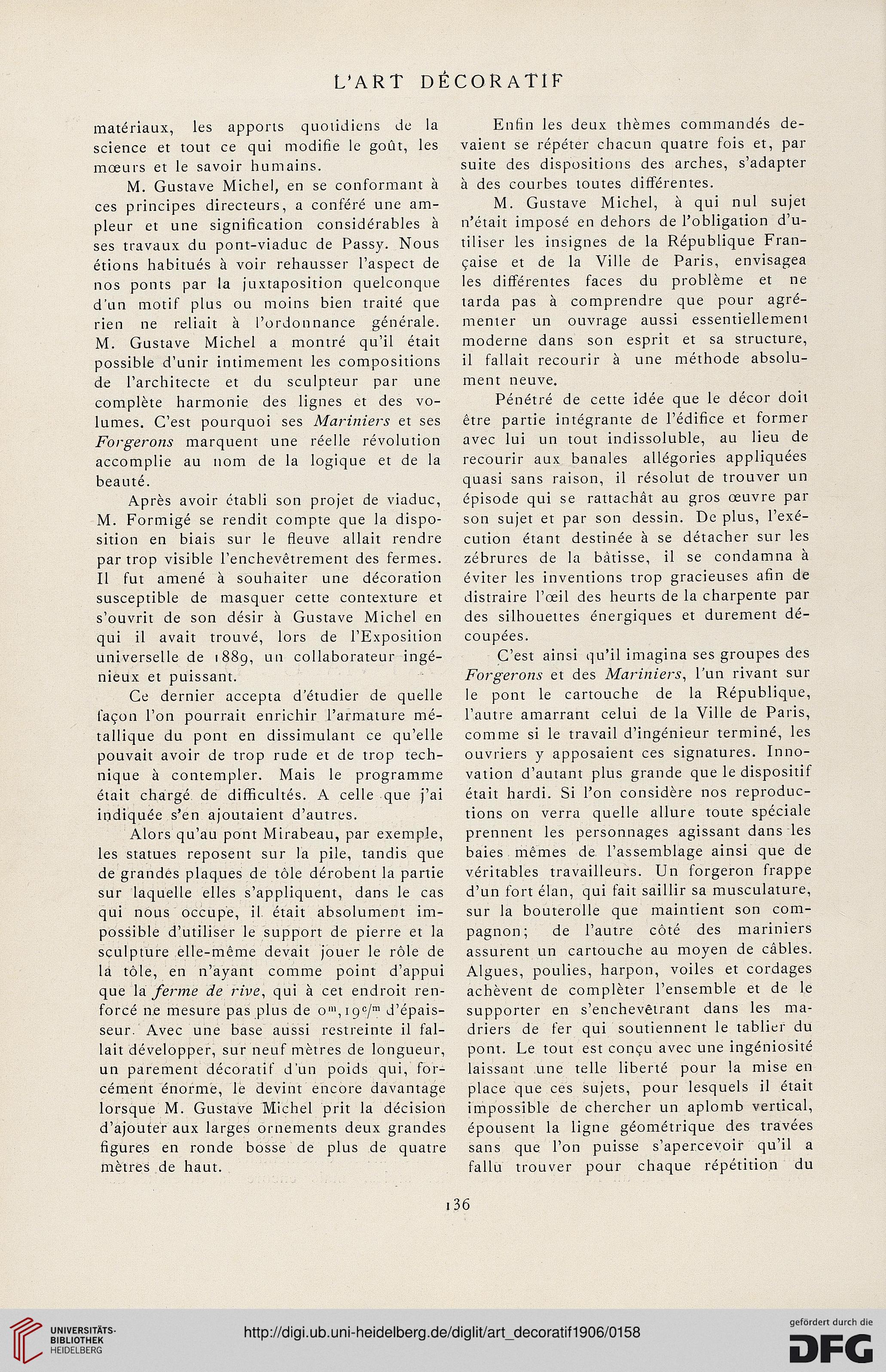L'ART DÉCORATIF
matériaux, les apports quotidiens de !a
science et tout ce qui modifie te goût, les
moeurs et ie savoir humains.
M. Gustave Miche), en se conformant à
ces principes directeurs, a conféré une am-
pleur et une signification considérables à
ses travaux du pont-viaduc de Passy. Nous
étions habitués à voir rehausser l'aspect de
nos ponts par la juxtaposition quelconque
d'un motif plus ou moins bien traité que
rien ne reliait à l'ordonnance générale.
M. Gustave Michel a montré qu'il était
possible d'unir intimement les compositions
de l'architecte et du sculpteur par une
complète harmonie des lignes et des vo-
lumes. C'est pourquoi ses Afm'zbzferx et ses
Aorg*gro7z.y marquent une réelle révolution
accomplie au nom de la logique et de la
beauté.
Après avoir établi son projet de viaduc,
M. Formigé se rendit compte que la dispo-
sition en biais sur le fleuve allait rendre
par trop visible l'enchevêtrement des fermes.
Il fut amené à souhaiter une décoration
susceptible de masquer cette contexture et
s'ouvrit de son désir à Gustave Michel en
qui il avait trouvé, lors de l'Exposition
universelle de t88q, un collaborateur ingé-
nieux et puissant.
Ce dernier accepta d'étudier de quelle
façon l'on pourrait enrichir l'armature mé-
tallique du pont en dissimulant ce qu'elle
pouvait avoir de trop rude et de trop tech-
nique à contempler. Mais le programme
était chargé de difficultés. A celle que j'ai
indiquée s'en ajoutaient d'autres.
Alors qu'au pont Mirabeau, par exemple,
les statues reposent sur la pile, tandis que
de grandes plaques de tôle dérobent la partie
sur laquelle elles s'appliquent, dans le cas
qui nous occupe, il était absolument im-
possible d'utiliser le support de pierre et la
sculpture elle-même devait jouer le rôle de
la tôle, en n'ayant comme point d'appui
que la yFrme aie rz'i^, qui à cet endroit ren-
forcé ne mesure pas plus de o"',iqc/m d'épais-
seur. Avec une base aussi restreinte il fal-
lait développer, sur neuf mètres de longueur,
un parement décoratif d'un poids qui, for-
cément énorme, 1e devint encore davantage
lorsque M. Gustave Michel prit la décision
d'ajouter aux larges ornements deux grandes
figures en ronde bosse de plus de quatre
mètres de haut.
Enfin les deux thèmes commandés de-
vaient se répéter chacun quatre fois et, par
suite des dispositions des arches, s'adapter
à des courbes toutes différentes.
M. Gustave Michel, à qui nul sujet
n'était imposé en dehors de l'obligation d'u-
tiliser les insignes de la République Fran-
çaise et de la Ville de Paris, envisagea
les différentes faces du problème et ne
tarda pas à comprendre que pour agré-
menter un ouvrage aussi essentiellement
moderne dans son esprit et sa structure,
il fallait recourir à une méthode absolu-
ment neuve.
Pénétré de cette idée que le décor doit
être partie intégrante de l'édifice et former
avec lui un tout indissoluble, au lieu de
recourir aux banales allégories appliquées
quasi sans raison, il résolut de trouver un
épisode qui se rattachât au gros œuvre par
son sujet et par son dessin. De plus, l'exé-
cution étant destinée à se détacher sur les
zébrures de la bâtisse, il se condamna à
éviter les inventions trop gracieuses afin de
distraire l'œil des heurts de la charpente par
des silhouettes énergiques et durement dé-
coupées.
C'est ainsi qu'il imagina ses groupes des
Forg*^ro7z.s' et des Af<27*Z7z;'<?7'x, l'un rivant sur
le pont le cartouche de la République,
l'autre amarrant celui de la Ville de Paris,
comme si le travail d'ingénieur terminé, les
ouvriers y apposaient ces signatures. Inno-
vation d'autant plus grande que le dispositif
était hardi. Si l'on considère nos reproduc-
tions on verra quelle allure toute spéciale
prennent les personnages agissant dans les
baies mêmes de l'assemblage ainsi que de
véritables travailleurs. Un forgeron frappe
d'un fort élan, qui fait saillir sa musculature,
sur la bouterolle que maintient son com-
pagnon; de l'autre côté des mariniers
assurent un cartouche au moyen de câbles.
Algues, poulies, harpon, voiles et cordages
achèvent de compléter l'ensemble et de le
supporter en s'enchevêtrant dans les ma-
driers de fer qui soutiennent le tablier du
pont. Le tout est conçu avec une ingéniosité
laissant une telle liberté pour la mise en
place que ces sujets, pour lesquels il était
impossible de chercher un aplomb vertical,
épousent la ligne géométrique des travées
sans que l'on puisse s'apercevoir qu'il a
fallu trouver pour chaque répétition du
i36
matériaux, les apports quotidiens de !a
science et tout ce qui modifie te goût, les
moeurs et ie savoir humains.
M. Gustave Miche), en se conformant à
ces principes directeurs, a conféré une am-
pleur et une signification considérables à
ses travaux du pont-viaduc de Passy. Nous
étions habitués à voir rehausser l'aspect de
nos ponts par la juxtaposition quelconque
d'un motif plus ou moins bien traité que
rien ne reliait à l'ordonnance générale.
M. Gustave Michel a montré qu'il était
possible d'unir intimement les compositions
de l'architecte et du sculpteur par une
complète harmonie des lignes et des vo-
lumes. C'est pourquoi ses Afm'zbzferx et ses
Aorg*gro7z.y marquent une réelle révolution
accomplie au nom de la logique et de la
beauté.
Après avoir établi son projet de viaduc,
M. Formigé se rendit compte que la dispo-
sition en biais sur le fleuve allait rendre
par trop visible l'enchevêtrement des fermes.
Il fut amené à souhaiter une décoration
susceptible de masquer cette contexture et
s'ouvrit de son désir à Gustave Michel en
qui il avait trouvé, lors de l'Exposition
universelle de t88q, un collaborateur ingé-
nieux et puissant.
Ce dernier accepta d'étudier de quelle
façon l'on pourrait enrichir l'armature mé-
tallique du pont en dissimulant ce qu'elle
pouvait avoir de trop rude et de trop tech-
nique à contempler. Mais le programme
était chargé de difficultés. A celle que j'ai
indiquée s'en ajoutaient d'autres.
Alors qu'au pont Mirabeau, par exemple,
les statues reposent sur la pile, tandis que
de grandes plaques de tôle dérobent la partie
sur laquelle elles s'appliquent, dans le cas
qui nous occupe, il était absolument im-
possible d'utiliser le support de pierre et la
sculpture elle-même devait jouer le rôle de
la tôle, en n'ayant comme point d'appui
que la yFrme aie rz'i^, qui à cet endroit ren-
forcé ne mesure pas plus de o"',iqc/m d'épais-
seur. Avec une base aussi restreinte il fal-
lait développer, sur neuf mètres de longueur,
un parement décoratif d'un poids qui, for-
cément énorme, 1e devint encore davantage
lorsque M. Gustave Michel prit la décision
d'ajouter aux larges ornements deux grandes
figures en ronde bosse de plus de quatre
mètres de haut.
Enfin les deux thèmes commandés de-
vaient se répéter chacun quatre fois et, par
suite des dispositions des arches, s'adapter
à des courbes toutes différentes.
M. Gustave Michel, à qui nul sujet
n'était imposé en dehors de l'obligation d'u-
tiliser les insignes de la République Fran-
çaise et de la Ville de Paris, envisagea
les différentes faces du problème et ne
tarda pas à comprendre que pour agré-
menter un ouvrage aussi essentiellement
moderne dans son esprit et sa structure,
il fallait recourir à une méthode absolu-
ment neuve.
Pénétré de cette idée que le décor doit
être partie intégrante de l'édifice et former
avec lui un tout indissoluble, au lieu de
recourir aux banales allégories appliquées
quasi sans raison, il résolut de trouver un
épisode qui se rattachât au gros œuvre par
son sujet et par son dessin. De plus, l'exé-
cution étant destinée à se détacher sur les
zébrures de la bâtisse, il se condamna à
éviter les inventions trop gracieuses afin de
distraire l'œil des heurts de la charpente par
des silhouettes énergiques et durement dé-
coupées.
C'est ainsi qu'il imagina ses groupes des
Forg*^ro7z.s' et des Af<27*Z7z;'<?7'x, l'un rivant sur
le pont le cartouche de la République,
l'autre amarrant celui de la Ville de Paris,
comme si le travail d'ingénieur terminé, les
ouvriers y apposaient ces signatures. Inno-
vation d'autant plus grande que le dispositif
était hardi. Si l'on considère nos reproduc-
tions on verra quelle allure toute spéciale
prennent les personnages agissant dans les
baies mêmes de l'assemblage ainsi que de
véritables travailleurs. Un forgeron frappe
d'un fort élan, qui fait saillir sa musculature,
sur la bouterolle que maintient son com-
pagnon; de l'autre côté des mariniers
assurent un cartouche au moyen de câbles.
Algues, poulies, harpon, voiles et cordages
achèvent de compléter l'ensemble et de le
supporter en s'enchevêtrant dans les ma-
driers de fer qui soutiennent le tablier du
pont. Le tout est conçu avec une ingéniosité
laissant une telle liberté pour la mise en
place que ces sujets, pour lesquels il était
impossible de chercher un aplomb vertical,
épousent la ligne géométrique des travées
sans que l'on puisse s'apercevoir qu'il a
fallu trouver pour chaque répétition du
i36