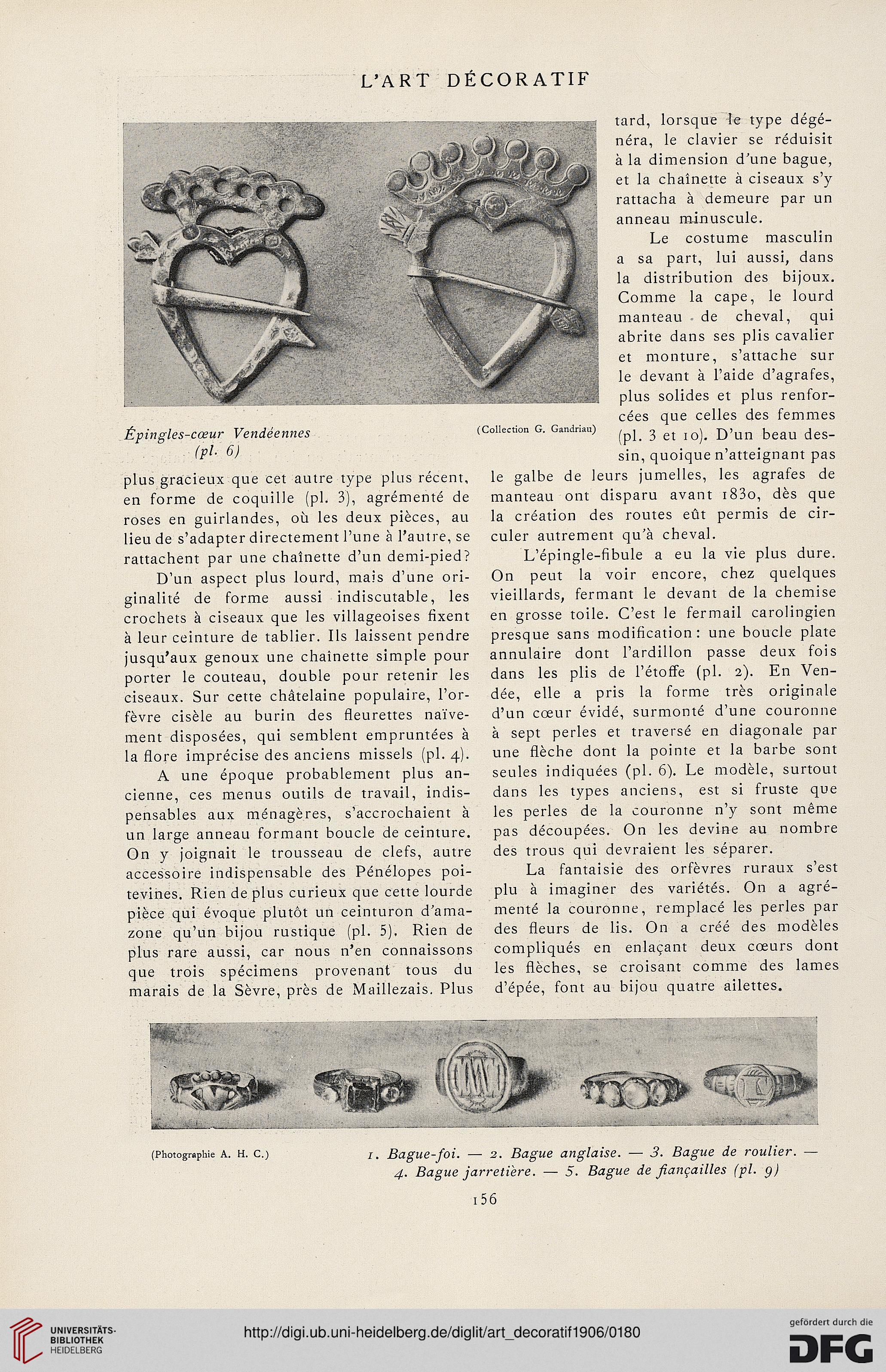L'ART DÉCORATIF
.Ép/7?g7M-C(3?M7* EC7!tïée 7777M
plus gracieux que cet autre type plus récent,
en forme de coquille (pl. 3), agrémenté de
roses en guirlandes, où les deux pièces, au
lieu de s'adapter directement l'une à l'autre, se
rattachent par une chaînette d'un demi-pied?
D'un aspect plus lourd, mais d'une ori-
ginalité de forme aussi indiscutable, les
crochets à ciseaux que les villageoises fixent
à leur ceinture de tablier. Ils laissent pendre
jusqu'aux genoux une chaînette simple pour
porter le couteau, double pour retenir les
ciseaux. Sur cette châtelaine populaire, l'or-
fèvre cisèle au burin des fleurettes naïve-
ment disposées, qui semblent empruntées à
la flore imprécise des anciens missels (pl. 4).
A une époque probablement plus an-
cienne, ces menus outils de travail, indis-
pensables aux ménagères, s'accrochaient à
un large anneau formant boucle de ceinture.
On y joignait le trousseau de clefs, autre
accessoire indispensable des Pénélopes poi-
tevines. Rien de plus curieux que cette lourde
pièce qui évoque plutôt un ceinturon d'ama-
zone qu'un bijou rustique (pl. 5). Rien de
plus rare aussi, car nous n'en connaissons
que trois spécimens provenant tous du
marais de la Sèvre, près de Maillezais. Plus
tard, lorsque le type dégé-
néra, le clavier se réduisit
à la dimension d'une bague,
et la chaînette à ciseaux s'y
rattacha à demeure par un
anneau minuscule.
Le costume masculin
a sa part, lui aussi, dans
la distribution des bijoux.
Comme la cape, le lourd
manteau de cheval, qui
abrite dans ses plis cavalier
et monture, s'attache sur
le devant à l'aide d'agrafes,
plus solides et plus renfor-
cées que celles des femmes
(pl. 3 et to). D'un beau des-
sin, quoique n'atteignant pas
le galbe de leurs jumelles, les agrafes de
manteau ont disparu avant i83o, dès que
la création des routes eût permis de cir-
culer autrement qu'à cheval.
L'épingle-fibule a eu la vie plus dure.
On peut la voir encore, chez quelques
vieillards, fermant le devant de la chemise
en grosse toile. C'est le fermail carolingien
presque sans modification : une boucle plate
annulaire dont l'ardillon passe deux fois
dans les plis de l'étoffe (pl. 2). En Ven-
dée, elle a pris la forme très originale
d'un cœur évidé, surmonté d'une couronne
à sept perles et traversé en diagonale par
une flèche dont la pointe et la barbe sont
seules indiquées (pl. 6). Le modèle, surtout
dans les types anciens, est si fruste que
les perles de la couronne n'y sont même
pas découpées. On les devine au nombre
des trous qui devraient les séparer.
La fantaisie des orfèvres ruraux s'est
plu à imaginer des variétés. On a agré-
menté la couronne, remplacé les perles par
des fleurs de lis. On a créé des modèles
compliqués en enlaçant deux cœurs dont
les flèches, se croisant comme des lames
d'épée, font au bijou quatre ailettes.
r. Rag*Me-yb7. — 2. Æ<2g*Me <277g7<27'3<?. — é?. Æap'Me 7*oMÙ'e7*. —
4. — J. Æ<3p*M<? <ieyz<37zç<2z7/e.? fp/.
t 56
(Photographie A. H. C.)
.Ép/7?g7M-C(3?M7* EC7!tïée 7777M
plus gracieux que cet autre type plus récent,
en forme de coquille (pl. 3), agrémenté de
roses en guirlandes, où les deux pièces, au
lieu de s'adapter directement l'une à l'autre, se
rattachent par une chaînette d'un demi-pied?
D'un aspect plus lourd, mais d'une ori-
ginalité de forme aussi indiscutable, les
crochets à ciseaux que les villageoises fixent
à leur ceinture de tablier. Ils laissent pendre
jusqu'aux genoux une chaînette simple pour
porter le couteau, double pour retenir les
ciseaux. Sur cette châtelaine populaire, l'or-
fèvre cisèle au burin des fleurettes naïve-
ment disposées, qui semblent empruntées à
la flore imprécise des anciens missels (pl. 4).
A une époque probablement plus an-
cienne, ces menus outils de travail, indis-
pensables aux ménagères, s'accrochaient à
un large anneau formant boucle de ceinture.
On y joignait le trousseau de clefs, autre
accessoire indispensable des Pénélopes poi-
tevines. Rien de plus curieux que cette lourde
pièce qui évoque plutôt un ceinturon d'ama-
zone qu'un bijou rustique (pl. 5). Rien de
plus rare aussi, car nous n'en connaissons
que trois spécimens provenant tous du
marais de la Sèvre, près de Maillezais. Plus
tard, lorsque le type dégé-
néra, le clavier se réduisit
à la dimension d'une bague,
et la chaînette à ciseaux s'y
rattacha à demeure par un
anneau minuscule.
Le costume masculin
a sa part, lui aussi, dans
la distribution des bijoux.
Comme la cape, le lourd
manteau de cheval, qui
abrite dans ses plis cavalier
et monture, s'attache sur
le devant à l'aide d'agrafes,
plus solides et plus renfor-
cées que celles des femmes
(pl. 3 et to). D'un beau des-
sin, quoique n'atteignant pas
le galbe de leurs jumelles, les agrafes de
manteau ont disparu avant i83o, dès que
la création des routes eût permis de cir-
culer autrement qu'à cheval.
L'épingle-fibule a eu la vie plus dure.
On peut la voir encore, chez quelques
vieillards, fermant le devant de la chemise
en grosse toile. C'est le fermail carolingien
presque sans modification : une boucle plate
annulaire dont l'ardillon passe deux fois
dans les plis de l'étoffe (pl. 2). En Ven-
dée, elle a pris la forme très originale
d'un cœur évidé, surmonté d'une couronne
à sept perles et traversé en diagonale par
une flèche dont la pointe et la barbe sont
seules indiquées (pl. 6). Le modèle, surtout
dans les types anciens, est si fruste que
les perles de la couronne n'y sont même
pas découpées. On les devine au nombre
des trous qui devraient les séparer.
La fantaisie des orfèvres ruraux s'est
plu à imaginer des variétés. On a agré-
menté la couronne, remplacé les perles par
des fleurs de lis. On a créé des modèles
compliqués en enlaçant deux cœurs dont
les flèches, se croisant comme des lames
d'épée, font au bijou quatre ailettes.
r. Rag*Me-yb7. — 2. Æ<2g*Me <277g7<27'3<?. — é?. Æap'Me 7*oMÙ'e7*. —
4. — J. Æ<3p*M<? <ieyz<37zç<2z7/e.? fp/.
t 56
(Photographie A. H. C.)