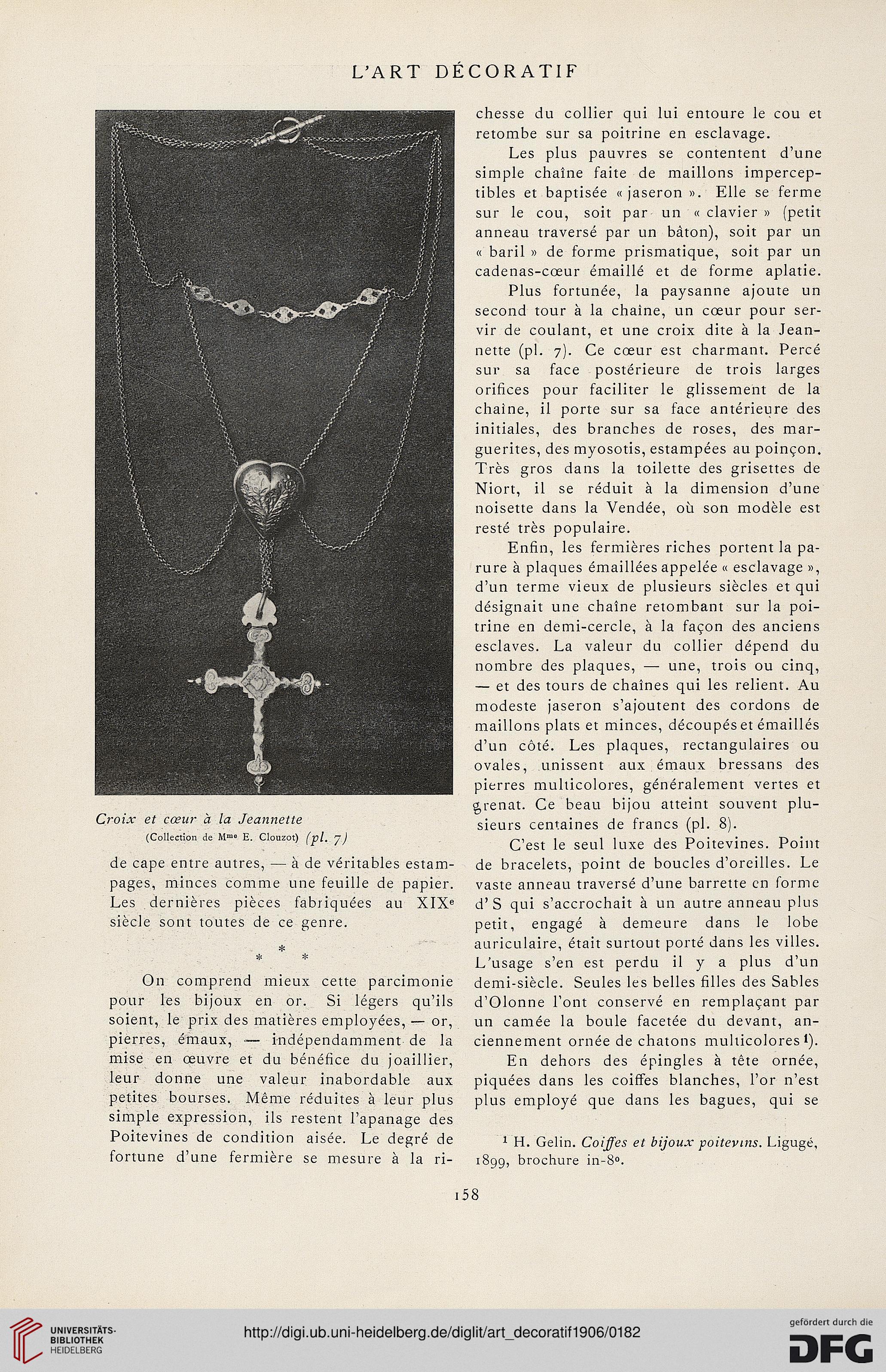L'ART DECORATIF
Crohv g? ggear à; /a; Jg<2?n!g^g
de cape entre autres, — à de véritables estam-
pages, minces comme une feuilie de papier.
Les dernières pièces fabriquées au XIX"
siècie sont toutes de ce genre.
On comprend mieux cette parcimonie
pour les bijoux en or. Si légers qu'ils
soient, le prix des matières employées, — or,
pierres, émaux, — indépendamment de la
mise en œuvre et du bénéfice du joailiier,
leur donne une valeur inabordable aux
petites bourses. Même réduites à leur plus
simple expression, ils restent l'apanage des
Poitevines de condition aisée. Le degré de
fortune d'une fermière se mesure à la ri-
chesse du collier qui lui entoure le cou et
retombe sur sa poitrine en esclavage.
Les plus pauvres se contentent d'une
simple chaîne faite de maillons impercep-
tibles et baptisée ((jaseron ». Elle se ferme
sur le cou, soit par un « clavier » (petit
anneau traversé par un bâton), soit par un
w baril » de forme prismatique, soit par un
cadenas-cœur émaillé et de forme aplatie.
Plus fortunée, la paysanne ajoute un
second tour à la chaîne, un cœur pour ser-
vir de coulant, et une croix dite à la Jean-
nette (pi. 7). Ce cœur est charmant. Percé
sur sa face postérieure de trois larges
orihces pour faciliter le glissement de la
chaîne, il porte sur sa face antérieure des
initiales, des branches de roses, des mar-
guerites, des myosotis, estampées au poinçon.
Très gros dans la toilette des grisettes de
Niort, il se réduit à la dimension d'une
noisette dans la Vendée, où son modèle est
resté très populaire.
Enfin, les fermières riches portent la pa-
rure à plaques émaillées appelée K esclavage »,
d'un terme vieux de plusieurs siècles et qui
désignait une chaîne retombant sur la poi-
trine en demi-cercle, à la façon des anciens
esclaves. La valeur du collier dépend du
nombre des plaques, — une, trois ou cinq,
— et des tours de chaînes qui les relient. Au
modeste jaseron s'ajoutent des cordons de
maillons plats et minces, découpés et émaillés
d'un côté. Les plaques, rectangulaires ou
ovales, unissent aux émaux bressans des
pierres multicolores, généralement vertes et
orenat. Ce beau bijou atteint souvent plu-
sieurs centaines de francs (pl. 8).
C'est le seul luxe des Poitevines. Point
de bracelets, point de boucles d'oreilles. Le
vaste anneau traversé d'une barrette en forme
d'S qui s'accrochait à un autre anneau plus
petit, engagé à demeure dans le lobe
auriculaire, était surtout porté dans les villes.
L'usage s'en est perdu il y a plus d'un
demi-siècle. Seules les belles filles des Sables
d'Olonne l'ont conservé en remplaçant par
un camée la boule facetée du devant, an-
ciennement ornée de chatons multicolores*).
En dehors des épingles à tête ornée,
piquées dans les coiffes blanches, l'or n'est
plus employé que dans les bagues, qui se
* H. Gelin. Co(/fe.s g; poùgynz.5. Ligugë,
1899, brochure in-8°.
l58
Crohv g? ggear à; /a; Jg<2?n!g^g
de cape entre autres, — à de véritables estam-
pages, minces comme une feuilie de papier.
Les dernières pièces fabriquées au XIX"
siècie sont toutes de ce genre.
On comprend mieux cette parcimonie
pour les bijoux en or. Si légers qu'ils
soient, le prix des matières employées, — or,
pierres, émaux, — indépendamment de la
mise en œuvre et du bénéfice du joailiier,
leur donne une valeur inabordable aux
petites bourses. Même réduites à leur plus
simple expression, ils restent l'apanage des
Poitevines de condition aisée. Le degré de
fortune d'une fermière se mesure à la ri-
chesse du collier qui lui entoure le cou et
retombe sur sa poitrine en esclavage.
Les plus pauvres se contentent d'une
simple chaîne faite de maillons impercep-
tibles et baptisée ((jaseron ». Elle se ferme
sur le cou, soit par un « clavier » (petit
anneau traversé par un bâton), soit par un
w baril » de forme prismatique, soit par un
cadenas-cœur émaillé et de forme aplatie.
Plus fortunée, la paysanne ajoute un
second tour à la chaîne, un cœur pour ser-
vir de coulant, et une croix dite à la Jean-
nette (pi. 7). Ce cœur est charmant. Percé
sur sa face postérieure de trois larges
orihces pour faciliter le glissement de la
chaîne, il porte sur sa face antérieure des
initiales, des branches de roses, des mar-
guerites, des myosotis, estampées au poinçon.
Très gros dans la toilette des grisettes de
Niort, il se réduit à la dimension d'une
noisette dans la Vendée, où son modèle est
resté très populaire.
Enfin, les fermières riches portent la pa-
rure à plaques émaillées appelée K esclavage »,
d'un terme vieux de plusieurs siècles et qui
désignait une chaîne retombant sur la poi-
trine en demi-cercle, à la façon des anciens
esclaves. La valeur du collier dépend du
nombre des plaques, — une, trois ou cinq,
— et des tours de chaînes qui les relient. Au
modeste jaseron s'ajoutent des cordons de
maillons plats et minces, découpés et émaillés
d'un côté. Les plaques, rectangulaires ou
ovales, unissent aux émaux bressans des
pierres multicolores, généralement vertes et
orenat. Ce beau bijou atteint souvent plu-
sieurs centaines de francs (pl. 8).
C'est le seul luxe des Poitevines. Point
de bracelets, point de boucles d'oreilles. Le
vaste anneau traversé d'une barrette en forme
d'S qui s'accrochait à un autre anneau plus
petit, engagé à demeure dans le lobe
auriculaire, était surtout porté dans les villes.
L'usage s'en est perdu il y a plus d'un
demi-siècle. Seules les belles filles des Sables
d'Olonne l'ont conservé en remplaçant par
un camée la boule facetée du devant, an-
ciennement ornée de chatons multicolores*).
En dehors des épingles à tête ornée,
piquées dans les coiffes blanches, l'or n'est
plus employé que dans les bagues, qui se
* H. Gelin. Co(/fe.s g; poùgynz.5. Ligugë,
1899, brochure in-8°.
l58