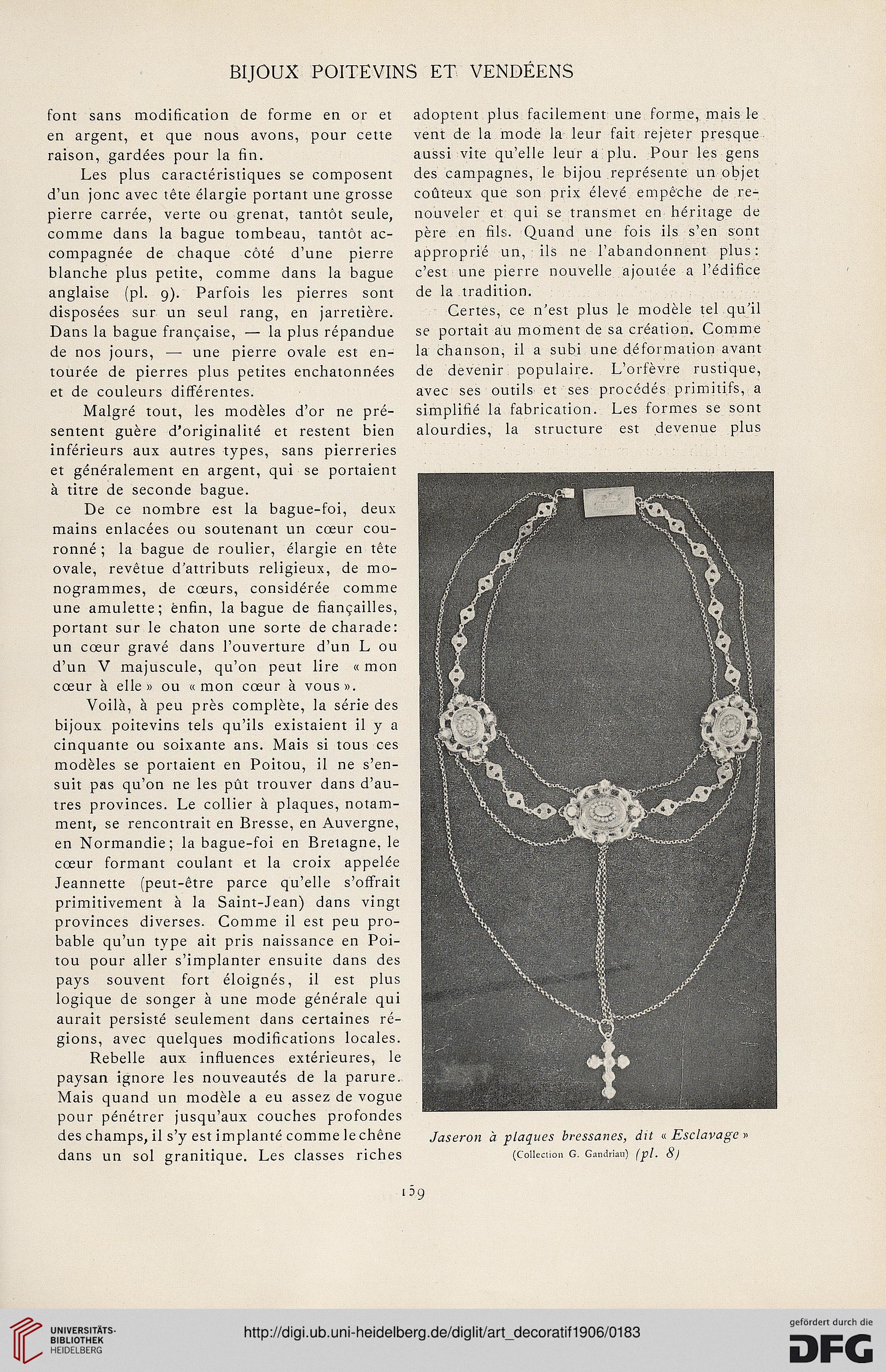BIJOUX POITEVINS ET VENDEENS
font sans modification de forme en or et
en argent, et que nous avons, pour cette
raison, gardées pour la fin.
Les plus caractéristiques se composent
d'un jonc avec tête élargie portant une grosse
pierre carrée, verte ou grenat, tantôt seule,
comme dans la bague tombeau, tantôt ac-
compagnée de chaque côté d'une pierre
blanche plus petite, comme dans la bague
anglaise (pl. g). Parfois les pierres sont
disposées sur un seul rang, en jarretière.
Dans la bague française, — la plus répandue
de nos jours, — une pierre ovale est en-
tourée de pierres plus petites enchatonnées
et de couleurs différentes.
Malgré tout, les modèles d'or ne pré-
sentent guère d'originalité et restent bien
inférieurs aux autres types, sans pierreries
et généralement en argent, qui se portaient
à titre de seconde bague.
De ce nombre est la bague-foi, deux
mains enlacées ou soutenant un cœur cou-
ronné ; la bague de roulier, élargie en tête
ovale, revêtue d'attributs religieux, de mo-
nogrammes, de cœurs, considérée comme
une amulette; enfin, la bague de fiançailles,
portant sur le chaton une sorte de charade:
un cœur gravé dans l'ouverture d'un L ou
d'un V majuscule, qu'on peut lire « mon
cœur à elle)) ou ((mon cœur à vous».
Voilà, à peu près complète, la série des
bijoux poitevins tels qu'ils existaient il y a
cinquante ou soixante ans. Mais si tous ces
modèles se portaient en Poitou, il ne s'en-
suit pas qu'on ne les pût trouver dans d'au-
tres provinces. Le collier à plaques, notam-
ment, se rencontrait en Bresse, en Auvergne,
en Normandie; la bague-foi en Bretagne, le
cœur formant coulant et la croix appelée
Jeannette (peut-être parce qu'elle s'offrait
primitivement à la Saint-Jean) dans vingt
provinces diverses. Comme il est peu pro-
bable qu'un type ait pris naissance en Poi-
tou pour aller s'implanter ensuite dans des
pays souvent fort éloignés, il est plus
logique de songer à une mode générale qui
aurait persisté seulement dans certaines ré-
gions, avec quelques modifications locales.
Rebelle aux influences extérieures, le
paysan ignore les nouveautés de la parure.
Mais quand un modèle a eu assez de vogue
pour pénétrer jusqu'aux couches profondes
des champs, il s'y est implanté comme le chêne
dans un sol granitique. Les classes riches
adoptent plus facilement une forme, mais le
vent de la mode la leur fait rejeter presque
aussi vite qu'elle leur a plu. Pour les gens
des campagnes, le bijou représente un objet
coûteux que son prix élevé empêche de re-
nouveler et qui se transmet en héritage de
père en fils. Quand une fois ils s'en sont
approprié un, ils ne l'abandonnent plus:
c'est une pierre nouvelle ajoutée a l'édifice
de la tradition.
Certes, ce n'est plus le modèle tel qu'il
se portait au moment de sa création. Comme
la chanson, il a subi une déformation avant
de devenir populaire. L'orfèvre rustique,
avec ses outils et ses procédés primitifs, a
simplifié la fabrication. Les formes se sont
alourdies, la structure est devenue plus
(CoHection G. Gandrian) fp/. (S^
font sans modification de forme en or et
en argent, et que nous avons, pour cette
raison, gardées pour la fin.
Les plus caractéristiques se composent
d'un jonc avec tête élargie portant une grosse
pierre carrée, verte ou grenat, tantôt seule,
comme dans la bague tombeau, tantôt ac-
compagnée de chaque côté d'une pierre
blanche plus petite, comme dans la bague
anglaise (pl. g). Parfois les pierres sont
disposées sur un seul rang, en jarretière.
Dans la bague française, — la plus répandue
de nos jours, — une pierre ovale est en-
tourée de pierres plus petites enchatonnées
et de couleurs différentes.
Malgré tout, les modèles d'or ne pré-
sentent guère d'originalité et restent bien
inférieurs aux autres types, sans pierreries
et généralement en argent, qui se portaient
à titre de seconde bague.
De ce nombre est la bague-foi, deux
mains enlacées ou soutenant un cœur cou-
ronné ; la bague de roulier, élargie en tête
ovale, revêtue d'attributs religieux, de mo-
nogrammes, de cœurs, considérée comme
une amulette; enfin, la bague de fiançailles,
portant sur le chaton une sorte de charade:
un cœur gravé dans l'ouverture d'un L ou
d'un V majuscule, qu'on peut lire « mon
cœur à elle)) ou ((mon cœur à vous».
Voilà, à peu près complète, la série des
bijoux poitevins tels qu'ils existaient il y a
cinquante ou soixante ans. Mais si tous ces
modèles se portaient en Poitou, il ne s'en-
suit pas qu'on ne les pût trouver dans d'au-
tres provinces. Le collier à plaques, notam-
ment, se rencontrait en Bresse, en Auvergne,
en Normandie; la bague-foi en Bretagne, le
cœur formant coulant et la croix appelée
Jeannette (peut-être parce qu'elle s'offrait
primitivement à la Saint-Jean) dans vingt
provinces diverses. Comme il est peu pro-
bable qu'un type ait pris naissance en Poi-
tou pour aller s'implanter ensuite dans des
pays souvent fort éloignés, il est plus
logique de songer à une mode générale qui
aurait persisté seulement dans certaines ré-
gions, avec quelques modifications locales.
Rebelle aux influences extérieures, le
paysan ignore les nouveautés de la parure.
Mais quand un modèle a eu assez de vogue
pour pénétrer jusqu'aux couches profondes
des champs, il s'y est implanté comme le chêne
dans un sol granitique. Les classes riches
adoptent plus facilement une forme, mais le
vent de la mode la leur fait rejeter presque
aussi vite qu'elle leur a plu. Pour les gens
des campagnes, le bijou représente un objet
coûteux que son prix élevé empêche de re-
nouveler et qui se transmet en héritage de
père en fils. Quand une fois ils s'en sont
approprié un, ils ne l'abandonnent plus:
c'est une pierre nouvelle ajoutée a l'édifice
de la tradition.
Certes, ce n'est plus le modèle tel qu'il
se portait au moment de sa création. Comme
la chanson, il a subi une déformation avant
de devenir populaire. L'orfèvre rustique,
avec ses outils et ses procédés primitifs, a
simplifié la fabrication. Les formes se sont
alourdies, la structure est devenue plus
(CoHection G. Gandrian) fp/. (S^