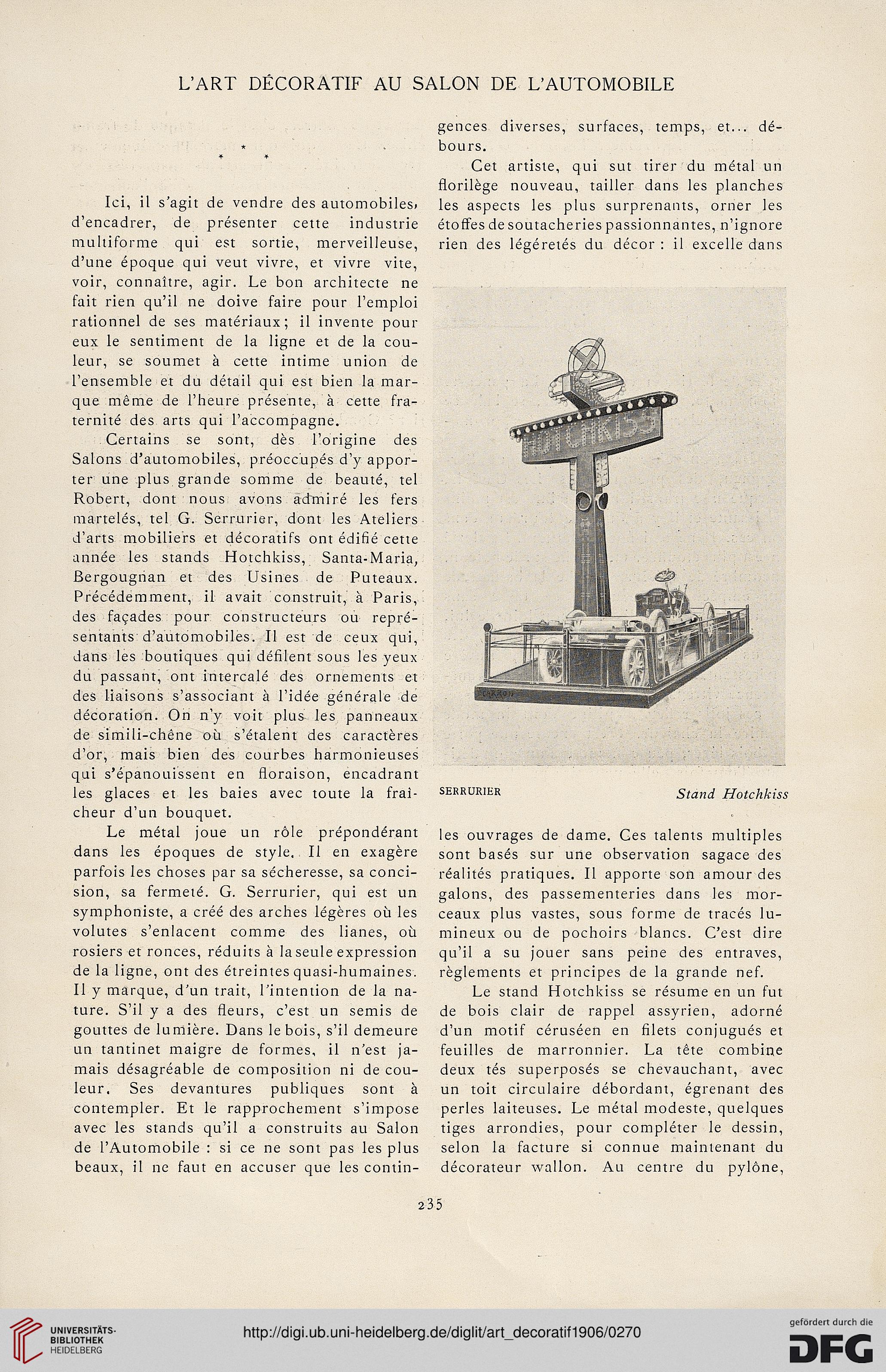L'ART DÉCORATIF AU SALON DE L'AUTOMOBILE
Ici, ii s'agit de vendre des automobiles*
d'encadrer, de présenter cette industrie
multiforme qui est sortie, merveilleuse,
d'une époque qui veut vivre, et vivre vite,
voir, connaître, agir. Le bon architecte ne
fait rien qu'il ne doive faire pour l'emploi
rationnel de ses matériaux; il invente pour
eux le sentiment de la ligne et de la cou-
leur, se soumet à cette intime union de
l'ensemble et du détail qui est bien la mar-
que même de l'heure présente, à cette fra-
ternité des arts qui l'accompagne.
Certains se sont, dès l'origine des
Salons d'automobiles, préoccupés d'y appor-
ter une plus grande somme de beauté, tel
Robert, dont nous avons admiré les fers
martelés, tel G. Serrurier, dont les Ateliers
d'arts mobiliers et décoratifs ont édifié cette
année les stands Hotchkiss, Santa-Maria,
Bergougnan et des Usines de Puteaux.
Précédemment, il avait construit, à Paris,
des façades pour constructeurs ou repré-
sentants d'automobiles. Il est de ceux qui,
dans les boutiques qui défilent sous les yeux
du passant, ont intercalé des ornements et
des liaisons s'associant à l'idée générale de
décoration. On n'y voit plus les panneaux
de simili-chêne où s'étalent des caractères
d'or, mais bien des courbes harmonieuses
qui s'épanouissent en floraison, encadrant
les glaces et les baies avec toute la fraî-
cheur d'un bouquet.
Le métal joue un rôle prépondérant
dans les époques de style. Il en exagère
parfois les choses par sa sécheresse, sa conci-
sion, sa fermeté. G. Serrurier, qui est un
symphoniste, a créé des arches légères où les
volutes s'enlacent comme des lianes, où
rosiers et ronces, réduits à la seule expression
de la ligne, ont des étreintes quasi-humaines.
Il y marque, d'un trait, l'intention de la na-
ture. S'il y a des fleurs, c'est un semis de
gouttes de lumière. Dans le bois, s'il demeure
un tantinet maigre de formes, il n'est ja-
mais désagréable de composition ni de cou-
leur. Ses devantures publiques sont à
contempler. Et le rapprochement s'impose
avec les stands qu'il a construits au Salon
de l'Automobile : si ce ne sont pas les plus
beaux, il ne faut en accuser que les contin-
gences diverses, surfaces, temps, et... dé-
bours.
Cet artiste, qui sut tirer du métal un
florilège nouveau, tailler dans les planches
les aspects les plus surprenants, orner les
étoffes de soutacheries passionnantes, n'ignore
rien des légèretés du décor : il excelle dans
SERRURIER
.Stand?
les ouvrages de dame. Ces talents multiples
sont basés sur une observation sagace des
réalités pratiques. Il apporte son amour des
galons, des passementeries dans les mor-
ceaux plus vastes, sous forme de tracés lu-
mineux ou de pochoirs blancs. C'est dire
qu'il a su jouer sans peine des entraves,
règlements et principes de la grande nef.
Le stand Hotchkiss se résume en un fut
de bois clair de rappel assyrien, adorné
d'un motif céruséen en filets conjugués et
feuilles de marronnier. La tête combine
deux tés superposés se chevauchant, avec
un toit circulaire débordant, égrenant des
perles laiteuses. Le métal modeste, quelques
tiges arrondies, pour compléter le dessin,
selon la facture si connue maintenant du
décorateur wallon. Au centre du pylône,
Ici, ii s'agit de vendre des automobiles*
d'encadrer, de présenter cette industrie
multiforme qui est sortie, merveilleuse,
d'une époque qui veut vivre, et vivre vite,
voir, connaître, agir. Le bon architecte ne
fait rien qu'il ne doive faire pour l'emploi
rationnel de ses matériaux; il invente pour
eux le sentiment de la ligne et de la cou-
leur, se soumet à cette intime union de
l'ensemble et du détail qui est bien la mar-
que même de l'heure présente, à cette fra-
ternité des arts qui l'accompagne.
Certains se sont, dès l'origine des
Salons d'automobiles, préoccupés d'y appor-
ter une plus grande somme de beauté, tel
Robert, dont nous avons admiré les fers
martelés, tel G. Serrurier, dont les Ateliers
d'arts mobiliers et décoratifs ont édifié cette
année les stands Hotchkiss, Santa-Maria,
Bergougnan et des Usines de Puteaux.
Précédemment, il avait construit, à Paris,
des façades pour constructeurs ou repré-
sentants d'automobiles. Il est de ceux qui,
dans les boutiques qui défilent sous les yeux
du passant, ont intercalé des ornements et
des liaisons s'associant à l'idée générale de
décoration. On n'y voit plus les panneaux
de simili-chêne où s'étalent des caractères
d'or, mais bien des courbes harmonieuses
qui s'épanouissent en floraison, encadrant
les glaces et les baies avec toute la fraî-
cheur d'un bouquet.
Le métal joue un rôle prépondérant
dans les époques de style. Il en exagère
parfois les choses par sa sécheresse, sa conci-
sion, sa fermeté. G. Serrurier, qui est un
symphoniste, a créé des arches légères où les
volutes s'enlacent comme des lianes, où
rosiers et ronces, réduits à la seule expression
de la ligne, ont des étreintes quasi-humaines.
Il y marque, d'un trait, l'intention de la na-
ture. S'il y a des fleurs, c'est un semis de
gouttes de lumière. Dans le bois, s'il demeure
un tantinet maigre de formes, il n'est ja-
mais désagréable de composition ni de cou-
leur. Ses devantures publiques sont à
contempler. Et le rapprochement s'impose
avec les stands qu'il a construits au Salon
de l'Automobile : si ce ne sont pas les plus
beaux, il ne faut en accuser que les contin-
gences diverses, surfaces, temps, et... dé-
bours.
Cet artiste, qui sut tirer du métal un
florilège nouveau, tailler dans les planches
les aspects les plus surprenants, orner les
étoffes de soutacheries passionnantes, n'ignore
rien des légèretés du décor : il excelle dans
SERRURIER
.Stand?
les ouvrages de dame. Ces talents multiples
sont basés sur une observation sagace des
réalités pratiques. Il apporte son amour des
galons, des passementeries dans les mor-
ceaux plus vastes, sous forme de tracés lu-
mineux ou de pochoirs blancs. C'est dire
qu'il a su jouer sans peine des entraves,
règlements et principes de la grande nef.
Le stand Hotchkiss se résume en un fut
de bois clair de rappel assyrien, adorné
d'un motif céruséen en filets conjugués et
feuilles de marronnier. La tête combine
deux tés superposés se chevauchant, avec
un toit circulaire débordant, égrenant des
perles laiteuses. Le métal modeste, quelques
tiges arrondies, pour compléter le dessin,
selon la facture si connue maintenant du
décorateur wallon. Au centre du pylône,