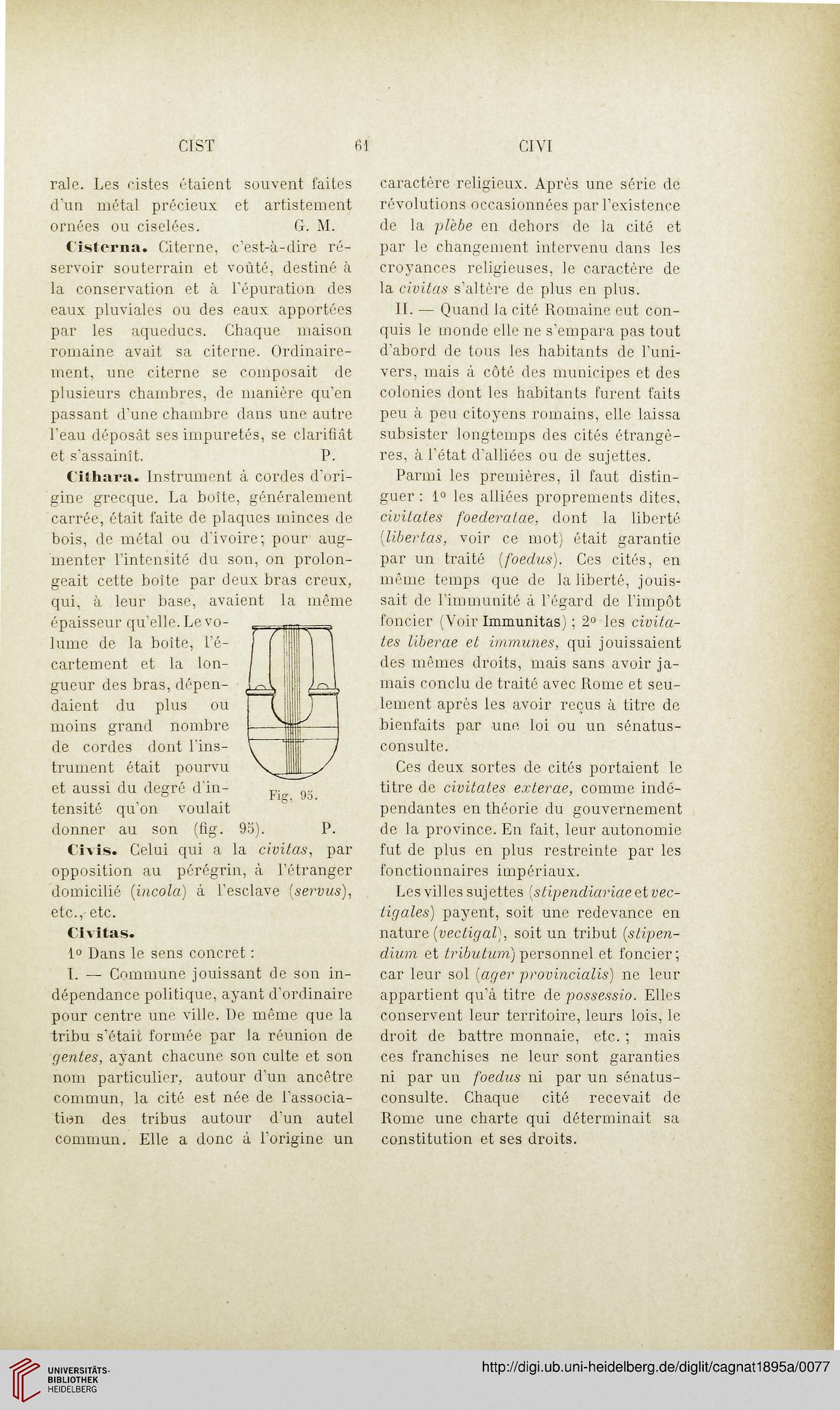Cl ST
61
CIVI
raie. Les cistes étaient souvent faites
d’un métal précieux et artistement
ornées ou ciselées. G. M.
Cisterna. Citerne, c’est-à-dire ré-
servoir souterrain et voûté, destiné à
la conservation et à l’épuration des
eaux pluviales ou des eaux apportées
par les aqueducs. Chaque maison
romaine avait sa citerne. Ordinaire-
ment, une citerne se composait de
plusieurs chambres, de manière qu’en
passant d’une chambre dans une autre
l'eau déposât ses impuretés, se clarifiât
et s’assainît. P.
Cithara. Instrument à cordes d'ori-
gine grecque. La boîte, généralement
carrée, était faite de plaques minces de
bois, de métal ou d'ivoire; pour aug-
menter l’intensité du son, on prolon-
geait cette boîte par deux bras creux,
qui, à leur base, avaient la même
épaisseur qu’elle. Le vo-
lume de la boîte, l’é-
cartement et la lon-
gueur des bras, dépen-
daient du plus ou
moins grand nombre
de cordes dont l'ins-
trument était pourvu
et aussi du degré d'in-
tensité qu’on voulait
donner au son (fig. 95). P.
Civis. Celui qui a la civitas, par
opposition au pérégrin, à l’étranger
domicilié {incola') à l’esclave {servus'),
etc., etc.
Civitas.
1° Dans le sens concret :
I. — Commune jouissant de son in-
dépendance politique, ayant d’ordinaire
pour centre une ville. De même que la
tribu s’était formée par la réunion de
gentes, ayant chacune son culte et son
nom particulier, autour d’un ancêtre
commun, la cité est née de l'associa-
tion des tribus autour d’un autel
commun. Elle a donc à l’origine un
caractère religieux. Après une série de
révolutions occasionnées par l’existence
de la plèbe en dehors de la cité et
par le changement intervenu dans les
croyances religieuses, le caractère de
la civitas s’altère de plus en plus.
IL — Quand la cité Romaine eut con-
quis le monde elle ne s'empara pas tout
d’abord de tous les habitants de l’uni-
vers, mais à côté des municipes et des
colonies dont les habitants furent faits
peu à peu citoyens romains, elle laissa
subsister longtemps des cités étrangè-
res, à l’état d’alliées ou de sujettes.
Parmi les premières, il faut distin-
guer : 1° les alliées proprements dites.
civitates foederatae, dont la liberté
{libertas, voir ce mot) était garantie
par un traité {foedus). Ces cités, en
même temps que de la liberté, jouis-
sait de l'immunité à l’égard de l'impôt
foncier (Voir Immunitas) ; 2° les civita-
tes liberae et immunes, qui jouissaient
des mêmes droits, mais sans avoir ja-
mais conclu de traité avec Rome et seu-
lement après les avoir reçus à titre de
bienfaits par une loi ou un sénatus-
consulte.
Ces deux sortes de cités portaient le
titre de civitates exterae, comme indé-
pendantes en théorie du gouvernement
de la province. En fait, leur autonomie
fut de plus en plus restreinte par les
fonctionnaires impériaux.
Les villes sujettes {stipendiariae et vec-
tigales) payent, soit une redevance en
nature {vectigal), soit un tribut {stipen-
dium et tributum) personnel et foncier;
car leur sol {ager provincialis) ne leur
appartient qu’à titre de possessio. Elles
conservent leur territoire, leurs lois, le
droit de battre monnaie, etc. ; mais
ces franchises ne leur sont garanties
ni par un foedus ni par un sénatus-
consulte. Chaque cité recevait de
Rome une charte qui déterminait sa
constitution et ses droits.
61
CIVI
raie. Les cistes étaient souvent faites
d’un métal précieux et artistement
ornées ou ciselées. G. M.
Cisterna. Citerne, c’est-à-dire ré-
servoir souterrain et voûté, destiné à
la conservation et à l’épuration des
eaux pluviales ou des eaux apportées
par les aqueducs. Chaque maison
romaine avait sa citerne. Ordinaire-
ment, une citerne se composait de
plusieurs chambres, de manière qu’en
passant d’une chambre dans une autre
l'eau déposât ses impuretés, se clarifiât
et s’assainît. P.
Cithara. Instrument à cordes d'ori-
gine grecque. La boîte, généralement
carrée, était faite de plaques minces de
bois, de métal ou d'ivoire; pour aug-
menter l’intensité du son, on prolon-
geait cette boîte par deux bras creux,
qui, à leur base, avaient la même
épaisseur qu’elle. Le vo-
lume de la boîte, l’é-
cartement et la lon-
gueur des bras, dépen-
daient du plus ou
moins grand nombre
de cordes dont l'ins-
trument était pourvu
et aussi du degré d'in-
tensité qu’on voulait
donner au son (fig. 95). P.
Civis. Celui qui a la civitas, par
opposition au pérégrin, à l’étranger
domicilié {incola') à l’esclave {servus'),
etc., etc.
Civitas.
1° Dans le sens concret :
I. — Commune jouissant de son in-
dépendance politique, ayant d’ordinaire
pour centre une ville. De même que la
tribu s’était formée par la réunion de
gentes, ayant chacune son culte et son
nom particulier, autour d’un ancêtre
commun, la cité est née de l'associa-
tion des tribus autour d’un autel
commun. Elle a donc à l’origine un
caractère religieux. Après une série de
révolutions occasionnées par l’existence
de la plèbe en dehors de la cité et
par le changement intervenu dans les
croyances religieuses, le caractère de
la civitas s’altère de plus en plus.
IL — Quand la cité Romaine eut con-
quis le monde elle ne s'empara pas tout
d’abord de tous les habitants de l’uni-
vers, mais à côté des municipes et des
colonies dont les habitants furent faits
peu à peu citoyens romains, elle laissa
subsister longtemps des cités étrangè-
res, à l’état d’alliées ou de sujettes.
Parmi les premières, il faut distin-
guer : 1° les alliées proprements dites.
civitates foederatae, dont la liberté
{libertas, voir ce mot) était garantie
par un traité {foedus). Ces cités, en
même temps que de la liberté, jouis-
sait de l'immunité à l’égard de l'impôt
foncier (Voir Immunitas) ; 2° les civita-
tes liberae et immunes, qui jouissaient
des mêmes droits, mais sans avoir ja-
mais conclu de traité avec Rome et seu-
lement après les avoir reçus à titre de
bienfaits par une loi ou un sénatus-
consulte.
Ces deux sortes de cités portaient le
titre de civitates exterae, comme indé-
pendantes en théorie du gouvernement
de la province. En fait, leur autonomie
fut de plus en plus restreinte par les
fonctionnaires impériaux.
Les villes sujettes {stipendiariae et vec-
tigales) payent, soit une redevance en
nature {vectigal), soit un tribut {stipen-
dium et tributum) personnel et foncier;
car leur sol {ager provincialis) ne leur
appartient qu’à titre de possessio. Elles
conservent leur territoire, leurs lois, le
droit de battre monnaie, etc. ; mais
ces franchises ne leur sont garanties
ni par un foedus ni par un sénatus-
consulte. Chaque cité recevait de
Rome une charte qui déterminait sa
constitution et ses droits.