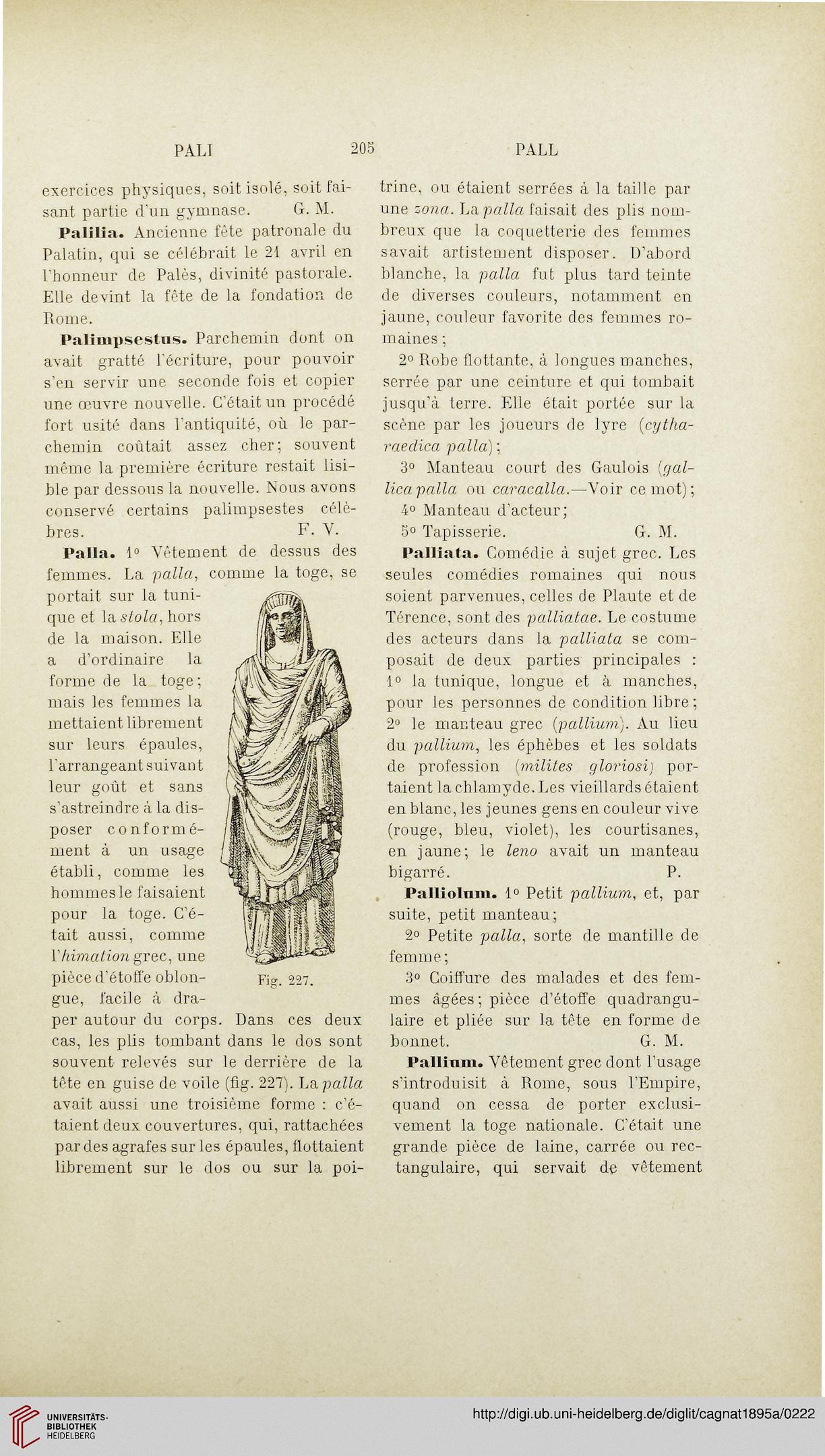PALI
205
PALL
exercices physiques, soit isolé, soit fai-
sant. partie d'un gymnase. G. M.
Palilia. Ancienne fête patronale du
Palatin, qui se célébrait le 21 avril en
l’honneur de Palès, divinité pastorale.
Elle devint la fête de la fondation de
Rome.
Palimpsestus. Parchemin dont on
avait gratté l’écriture, pour pouvoir
s’en servir une seconde fois et copier
une œuvre nouvelle. C’était un procédé
fort usité dans l’antiquité, où le par-
chemin coûtait assez cher; souvent
même la première écriture restait lisi-
ble par dessous la nouvelle. Nous avons
conservé certains palimpsestes célè-
bres. F. V.
Palla. 1° Vêtement de dessus des
femmes. La palla, comme la toge, se
portait sur la tuni-
que et la stola, hors
de la maison. Elle
a d’ordinaire la
forme de la toge;
mais les femmes la
mettaient librement
sur leurs épaules,
l’arrangeant suivant
leur goût et sans
s’astreindre à la dis-
poser conformé-
ment à un usage
établi, comme les
hommes le faisaient
pour la toge. C’é-
tait aussi, comme
Y himation grec, une
pièce d'étoffe oblon-
gue, facile à dra-
per autour du corps
Dans ces deux
cas, les plis tombant dans le dos sont
souvent relevés sur le derrière de la
tête en guise de voile (fig. 227). La palla
avait aussi une troisième forme : c’é-
taient deux couvertures, qui, rattachées
par des agrafes sur les épaules, flottaient
librement sur le dos ou sur la poi-
trine, ou étaient serrées à la taille par
une zona. La palla faisait des plis nom-
breux que la coquetterie des femmes
savait artistement disposer. D’abord
blanche, la palla fut plus tard teinte
de diverses couleurs, notamment en
jaune, couleur favorite des femmes ro-
maines ;
2° Robe flottante, à longues manches,
serrée par une ceinture et qui tombait
jusqu’à terre. Elle était portée sur la
scène par les joueurs de lyre {cytlia-
raedica palla) ;
3° Manteau court des Gaulois {gal-
licapalla ou caracalla.—Voir ce mot);
4° Manteau d’acteur;
5° Tapisserie. G. M.
Palliata. Comédie à sujet grec. Les
seules comédies romaines qui nous
soient parvenues, celles de Plaute et de
Térence, sont des palliatae. Le costume
des acteurs dans la palliata se com-
posait de deux parties principales :
1° la tunique, longue et à manches,
pour les personnes de condition libre ;
2° le manteau grec {pallium). Au lieu
du pallium, les éphèbes et les soldats
de profession {milites gloriosi) por-
taient la chlamyde. Les vieillards étaient
en blanc, les jeunes gens en couleur vive
(rouge, bleu, violet), les courtisanes,
en jaune; le leno avait un manteau
bigarré. P.
Palliolum. 1° Petit pallium, et, par
suite, petit manteau;
2° Petite palla, sorte de mantille de
femme;
3° Coiffure des malades et des fem-
mes âgées; pièce d’étoffe quadrangu-
laire et pliée sur la tête en forme de
bonnet. G. M.
Pallium. Vêtement grec dont l’usage
s’introduisit à Rome, sous l’Empire,
quand on cessa de porter exclusi-
vement la toge nationale. C’était une
grande pièce de laine, carrée ou rec-
tangulaire, qui servait de vêtement
205
PALL
exercices physiques, soit isolé, soit fai-
sant. partie d'un gymnase. G. M.
Palilia. Ancienne fête patronale du
Palatin, qui se célébrait le 21 avril en
l’honneur de Palès, divinité pastorale.
Elle devint la fête de la fondation de
Rome.
Palimpsestus. Parchemin dont on
avait gratté l’écriture, pour pouvoir
s’en servir une seconde fois et copier
une œuvre nouvelle. C’était un procédé
fort usité dans l’antiquité, où le par-
chemin coûtait assez cher; souvent
même la première écriture restait lisi-
ble par dessous la nouvelle. Nous avons
conservé certains palimpsestes célè-
bres. F. V.
Palla. 1° Vêtement de dessus des
femmes. La palla, comme la toge, se
portait sur la tuni-
que et la stola, hors
de la maison. Elle
a d’ordinaire la
forme de la toge;
mais les femmes la
mettaient librement
sur leurs épaules,
l’arrangeant suivant
leur goût et sans
s’astreindre à la dis-
poser conformé-
ment à un usage
établi, comme les
hommes le faisaient
pour la toge. C’é-
tait aussi, comme
Y himation grec, une
pièce d'étoffe oblon-
gue, facile à dra-
per autour du corps
Dans ces deux
cas, les plis tombant dans le dos sont
souvent relevés sur le derrière de la
tête en guise de voile (fig. 227). La palla
avait aussi une troisième forme : c’é-
taient deux couvertures, qui, rattachées
par des agrafes sur les épaules, flottaient
librement sur le dos ou sur la poi-
trine, ou étaient serrées à la taille par
une zona. La palla faisait des plis nom-
breux que la coquetterie des femmes
savait artistement disposer. D’abord
blanche, la palla fut plus tard teinte
de diverses couleurs, notamment en
jaune, couleur favorite des femmes ro-
maines ;
2° Robe flottante, à longues manches,
serrée par une ceinture et qui tombait
jusqu’à terre. Elle était portée sur la
scène par les joueurs de lyre {cytlia-
raedica palla) ;
3° Manteau court des Gaulois {gal-
licapalla ou caracalla.—Voir ce mot);
4° Manteau d’acteur;
5° Tapisserie. G. M.
Palliata. Comédie à sujet grec. Les
seules comédies romaines qui nous
soient parvenues, celles de Plaute et de
Térence, sont des palliatae. Le costume
des acteurs dans la palliata se com-
posait de deux parties principales :
1° la tunique, longue et à manches,
pour les personnes de condition libre ;
2° le manteau grec {pallium). Au lieu
du pallium, les éphèbes et les soldats
de profession {milites gloriosi) por-
taient la chlamyde. Les vieillards étaient
en blanc, les jeunes gens en couleur vive
(rouge, bleu, violet), les courtisanes,
en jaune; le leno avait un manteau
bigarré. P.
Palliolum. 1° Petit pallium, et, par
suite, petit manteau;
2° Petite palla, sorte de mantille de
femme;
3° Coiffure des malades et des fem-
mes âgées; pièce d’étoffe quadrangu-
laire et pliée sur la tête en forme de
bonnet. G. M.
Pallium. Vêtement grec dont l’usage
s’introduisit à Rome, sous l’Empire,
quand on cessa de porter exclusi-
vement la toge nationale. C’était une
grande pièce de laine, carrée ou rec-
tangulaire, qui servait de vêtement