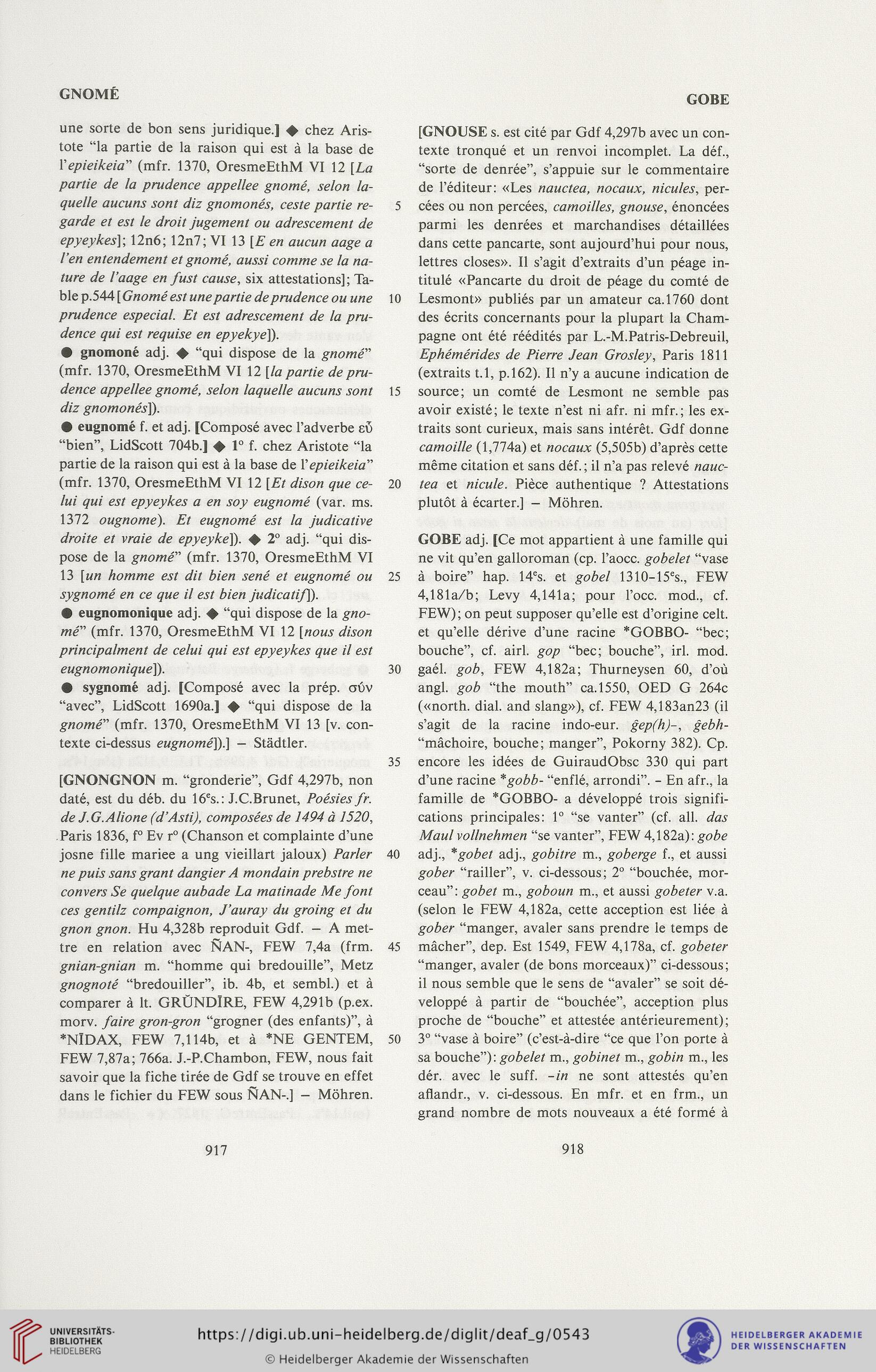GNOME
GOBE
une sorte de bon sens juridique.] ♦ chez Aris-
tote “la partie de la raison qui est à la base de
Vepieikeia" (mfr. 1370, OresmeEthM VI 12 [La
partie de la prudence appellee gnome, selon la-
quelle aucuns sont diz gnomonés, ceste partie re- 5
garde et est le droit jugement ou adrescement de
epyeykes]-, 12n6; 12n7; VI 13 [£ en aucun aage a
l’en entendement et gnome, aussi comme se la na-
ture de l’aage en fust cause, six attestations]; Ta-
ble p.544[Gnomé est une partie de prudence ou une 10
prudence especial. Et est adrescement de la pru-
dence qui est requise en epyekyé]).
• gnomoné adj. ♦ “qui dispose de la gnomé”
(mfr. 1370, OresmeEthM VI 12 [la partie de pru-
dence appellee gnomé, selon laquelle aucuns sont 15
diz gnomonés]).
• eugnomé f. et adj. [Composé avec l’adverbe eù
“bien”, LidScott 704b.] ♦ 1° f. chez Aristote “la
partie de la raison qui est à la base de Vepieikeia”
(mfr. 1370, OresmeEthM VI 12 [Et dison que ce- 20
lui qui est epyeykes a en soy eugnomé (var. ms.
1372 ougnome). Et eugnomé est la judicative
droite et vraie de epyeyke]). ♦ 2° adj. “qui dis-
pose de la gnomé” (mfr. 1370, OresmeEthM VI
13 [wm homme est dit bien séné et eugnomé ou 25
sygnomé en ce que il est bien judicatif]).
• eugnomonique adj. ♦ “qui dispose de la gno-
mé” (mfr. 1370, OresmeEthM VI 12 [nous dison
principalment de celui qui est epyeykes que il est
eugnomonique]). 30
• sygnomé adj. [Composé avec la prép. oOv
“avec”, LidScott 1690a.] ♦ “qui dispose de la
gnomé” (mfr. 1370, OresmeEthM VI 13 [v. con-
texte ci-dessus eugnomé]).] — Stâdtler.
35
[GNONGNON m. “gronderie”, Gdf 4,297b, non
daté, est du déb. du 16es. : J.C.Brunet, Poésies fr.
de J.G.Alione (d’Asti), composées de 1494 à 1520,
Paris 1836, f° Ev r° (Chanson et complainte d’une
josne fille mariee a ung vieillart jaloux) Parler 40
ne puis sans grant dangier A mondain prebstre ne
convers Se quelque aubade La matinade Me font
ces gentilz compaignon, J’auray du groing et du
gnon gnon. Hu 4,328b reproduit Gdf. - A met-
tre en relation avec NAN-, FEW 7,4a (frm. 45
gnian-gnian m. “homme qui bredouille”, Metz
gnognoté “bredouiller”, ib. 4b, et sembl.) et à
comparer à 1t. GRÜNDÎRE, FEW 4,291b (p.ex.
morv. faire gron-gron “grogner (des enfants)”, à
*NÎDAX, FEW 7,114b, et à *NE GENTEM, 50
FEW 7,87a; 766a. J.-P.Chambon, FEW, nous fait
savoir que la fiche tirée de Gdf se trouve en effet
dans le fichier du FEW sous NAN-.] — Môhren.
[GNOUSE s. est cité par Gdf 4,297b avec un con-
texte tronqué et un renvoi incomplet. La déf.,
“sorte de denrée”, s’appuie sur le commentaire
de l’éditeur: «Les nauctea, nocaux, nicules, per-
cées ou non percées, camoilles, gnouse, énoncées
parmi les denrées et marchandises détaillées
dans cette pancarte, sont aujourd’hui pour nous,
lettres closes». Il s’agit d’extraits d’un péage in-
titulé «Pancarte du droit de péage du comté de
Lesmont» publiés par un amateur ca.1760 dont
des écrits concernants pour la plupart la Cham-
pagne ont été réédités par L.-M.Patris-Debreuil,
Ephémérides de Pierre Jean Grosley, Paris 1811
(extraits t.l, p. 162). Il n’y a aucune indication de
source; un comté de Lesmont ne semble pas
avoir existé; le texte n’est ni afr. ni mfr.; les ex-
traits sont curieux, mais sans intérêt. Gdf donne
camoille (1,774a) et nocaux (5,505b) d’après cette
même citation et sans déf. ; il n’a pas relevé nauc-
tea et nicule. Pièce authentique ? Attestations
plutôt à écarter.] - Môhren.
GOBE adj. [Ce mot appartient à une famille qui
ne vit qu’en galloroman (cp. l’aocc. gobelet “vase
à boire” hap. 14es. et gobel 1310-15es., FEW
4,181a/b; Levy 4,141a; pour l’occ. mod., cf.
FEW); on peut supposer qu’elle est d’origine celt.
et qu’elle dérive d’une racine *GOBBO- “bec;
bouche”, cf. airl. gop “bec; bouche”, irl. mod.
gaél. gob, FEW 4,182a; Thurneysen 60, d’où
angl. gob “the mouth” ca.1550, OED G 264c
(«north. dial, and slang»), cf. FEW 4,183an23 (il
s’agit de la racine indo-eur. gep(h)-, gebh-
“mâchoire, bouche; manger”, Pokorny 382). Cp.
encore les idées de GuiraudObsc 330 qui part
d’une racine *gobb- “enflé, arrondi”. - En afr., la
famille de *GOBBO- a développé trois signifi-
cations principales: 1° “se vanter” (cf. ail. das
Maul vollnehmen “se vanter”, FEW 4,182a) : gobe
adj., *gobet adj., gobitre m., goberge f., et aussi
gober “railler”, v. ci-dessous; 2° “bouchée, mor-
ceau”: gobet m., goboun m., et aussi gobeter v.a.
(selon le FEW 4,182a, cette acception est liée à
gober “manger, avaler sans prendre le temps de
mâcher”, dep. Est 1549, FEW 4,178a, cf. gobeter
“manger, avaler (de bons morceaux)” ci-dessous ;
il nous semble que le sens de “avaler” se soit dé-
veloppé à partir de “bouchée”, acception plus
proche de “bouche” et attestée antérieurement);
3° “vase à boire” (c’est-à-dire “ce que l’on porte à
sa bouche”): gobelet m., gobinet m., gobin m., les
dér. avec le suff. -in ne sont attestés qu’en
aflandr., v. ci-dessous. En mfr. et en frm., un
grand nombre de mots nouveaux a été formé à
917
918
GOBE
une sorte de bon sens juridique.] ♦ chez Aris-
tote “la partie de la raison qui est à la base de
Vepieikeia" (mfr. 1370, OresmeEthM VI 12 [La
partie de la prudence appellee gnome, selon la-
quelle aucuns sont diz gnomonés, ceste partie re- 5
garde et est le droit jugement ou adrescement de
epyeykes]-, 12n6; 12n7; VI 13 [£ en aucun aage a
l’en entendement et gnome, aussi comme se la na-
ture de l’aage en fust cause, six attestations]; Ta-
ble p.544[Gnomé est une partie de prudence ou une 10
prudence especial. Et est adrescement de la pru-
dence qui est requise en epyekyé]).
• gnomoné adj. ♦ “qui dispose de la gnomé”
(mfr. 1370, OresmeEthM VI 12 [la partie de pru-
dence appellee gnomé, selon laquelle aucuns sont 15
diz gnomonés]).
• eugnomé f. et adj. [Composé avec l’adverbe eù
“bien”, LidScott 704b.] ♦ 1° f. chez Aristote “la
partie de la raison qui est à la base de Vepieikeia”
(mfr. 1370, OresmeEthM VI 12 [Et dison que ce- 20
lui qui est epyeykes a en soy eugnomé (var. ms.
1372 ougnome). Et eugnomé est la judicative
droite et vraie de epyeyke]). ♦ 2° adj. “qui dis-
pose de la gnomé” (mfr. 1370, OresmeEthM VI
13 [wm homme est dit bien séné et eugnomé ou 25
sygnomé en ce que il est bien judicatif]).
• eugnomonique adj. ♦ “qui dispose de la gno-
mé” (mfr. 1370, OresmeEthM VI 12 [nous dison
principalment de celui qui est epyeykes que il est
eugnomonique]). 30
• sygnomé adj. [Composé avec la prép. oOv
“avec”, LidScott 1690a.] ♦ “qui dispose de la
gnomé” (mfr. 1370, OresmeEthM VI 13 [v. con-
texte ci-dessus eugnomé]).] — Stâdtler.
35
[GNONGNON m. “gronderie”, Gdf 4,297b, non
daté, est du déb. du 16es. : J.C.Brunet, Poésies fr.
de J.G.Alione (d’Asti), composées de 1494 à 1520,
Paris 1836, f° Ev r° (Chanson et complainte d’une
josne fille mariee a ung vieillart jaloux) Parler 40
ne puis sans grant dangier A mondain prebstre ne
convers Se quelque aubade La matinade Me font
ces gentilz compaignon, J’auray du groing et du
gnon gnon. Hu 4,328b reproduit Gdf. - A met-
tre en relation avec NAN-, FEW 7,4a (frm. 45
gnian-gnian m. “homme qui bredouille”, Metz
gnognoté “bredouiller”, ib. 4b, et sembl.) et à
comparer à 1t. GRÜNDÎRE, FEW 4,291b (p.ex.
morv. faire gron-gron “grogner (des enfants)”, à
*NÎDAX, FEW 7,114b, et à *NE GENTEM, 50
FEW 7,87a; 766a. J.-P.Chambon, FEW, nous fait
savoir que la fiche tirée de Gdf se trouve en effet
dans le fichier du FEW sous NAN-.] — Môhren.
[GNOUSE s. est cité par Gdf 4,297b avec un con-
texte tronqué et un renvoi incomplet. La déf.,
“sorte de denrée”, s’appuie sur le commentaire
de l’éditeur: «Les nauctea, nocaux, nicules, per-
cées ou non percées, camoilles, gnouse, énoncées
parmi les denrées et marchandises détaillées
dans cette pancarte, sont aujourd’hui pour nous,
lettres closes». Il s’agit d’extraits d’un péage in-
titulé «Pancarte du droit de péage du comté de
Lesmont» publiés par un amateur ca.1760 dont
des écrits concernants pour la plupart la Cham-
pagne ont été réédités par L.-M.Patris-Debreuil,
Ephémérides de Pierre Jean Grosley, Paris 1811
(extraits t.l, p. 162). Il n’y a aucune indication de
source; un comté de Lesmont ne semble pas
avoir existé; le texte n’est ni afr. ni mfr.; les ex-
traits sont curieux, mais sans intérêt. Gdf donne
camoille (1,774a) et nocaux (5,505b) d’après cette
même citation et sans déf. ; il n’a pas relevé nauc-
tea et nicule. Pièce authentique ? Attestations
plutôt à écarter.] - Môhren.
GOBE adj. [Ce mot appartient à une famille qui
ne vit qu’en galloroman (cp. l’aocc. gobelet “vase
à boire” hap. 14es. et gobel 1310-15es., FEW
4,181a/b; Levy 4,141a; pour l’occ. mod., cf.
FEW); on peut supposer qu’elle est d’origine celt.
et qu’elle dérive d’une racine *GOBBO- “bec;
bouche”, cf. airl. gop “bec; bouche”, irl. mod.
gaél. gob, FEW 4,182a; Thurneysen 60, d’où
angl. gob “the mouth” ca.1550, OED G 264c
(«north. dial, and slang»), cf. FEW 4,183an23 (il
s’agit de la racine indo-eur. gep(h)-, gebh-
“mâchoire, bouche; manger”, Pokorny 382). Cp.
encore les idées de GuiraudObsc 330 qui part
d’une racine *gobb- “enflé, arrondi”. - En afr., la
famille de *GOBBO- a développé trois signifi-
cations principales: 1° “se vanter” (cf. ail. das
Maul vollnehmen “se vanter”, FEW 4,182a) : gobe
adj., *gobet adj., gobitre m., goberge f., et aussi
gober “railler”, v. ci-dessous; 2° “bouchée, mor-
ceau”: gobet m., goboun m., et aussi gobeter v.a.
(selon le FEW 4,182a, cette acception est liée à
gober “manger, avaler sans prendre le temps de
mâcher”, dep. Est 1549, FEW 4,178a, cf. gobeter
“manger, avaler (de bons morceaux)” ci-dessous ;
il nous semble que le sens de “avaler” se soit dé-
veloppé à partir de “bouchée”, acception plus
proche de “bouche” et attestée antérieurement);
3° “vase à boire” (c’est-à-dire “ce que l’on porte à
sa bouche”): gobelet m., gobinet m., gobin m., les
dér. avec le suff. -in ne sont attestés qu’en
aflandr., v. ci-dessous. En mfr. et en frm., un
grand nombre de mots nouveaux a été formé à
917
918