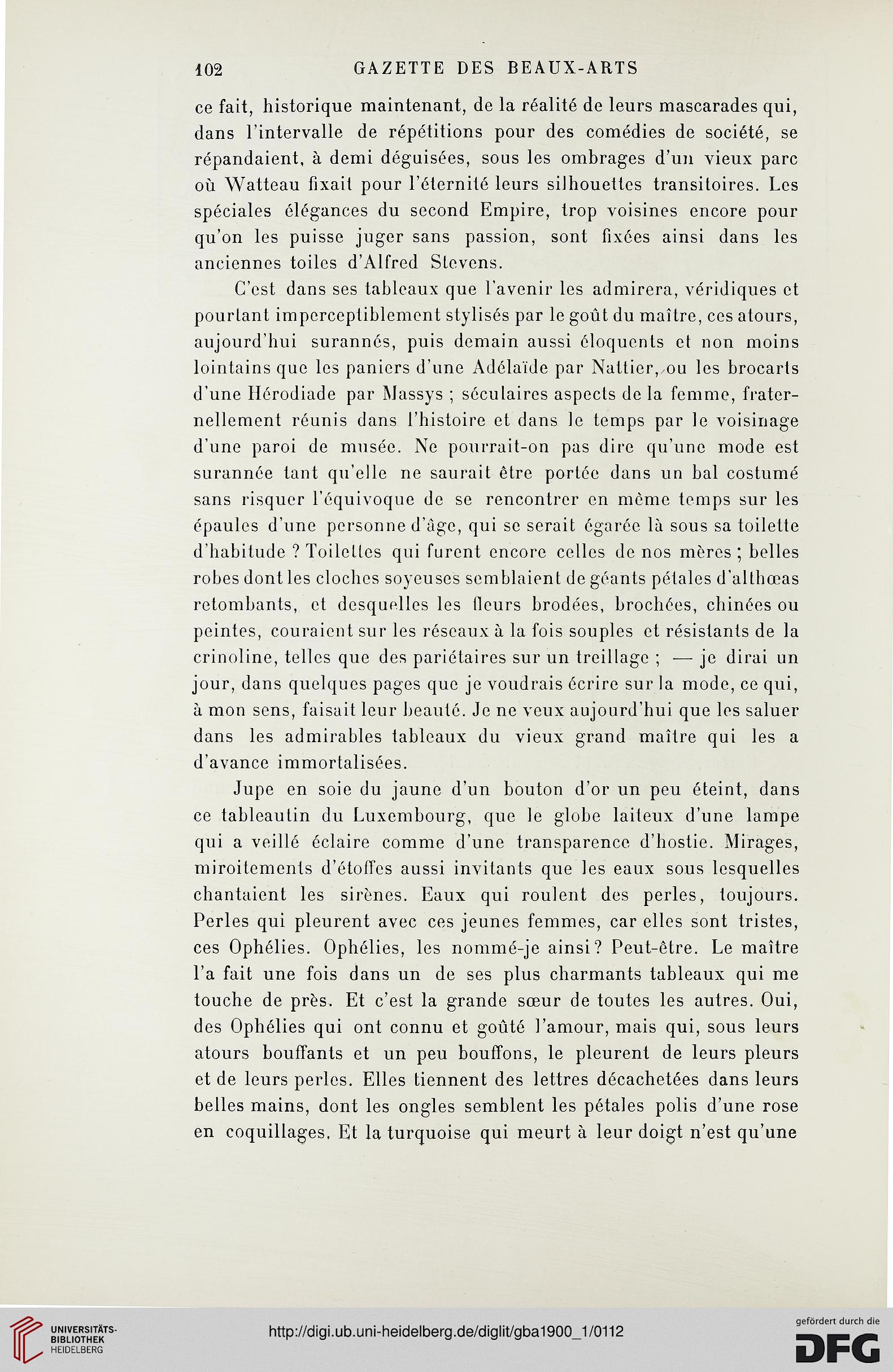102
GAZETTE DES BEAUX-ARTS
ce fait, historique maintenant, de la réalité de leurs mascarades qui,
dans l'intervalle de répétitions pour des comédies de société, se
répandaient, à demi déguisées, sous les ombrages d’un vieux parc
où Watteau fixait pour l’éternité leurs silhouettes transitoires. Les
spéciales élégances du second Empire, trop voisines encore pour
qu’on les puisse juger sans passion, sont fixées ainsi dans les
anciennes toiles d’Alfred Stevens.
C’est dans ses tableaux que l'avenir les admirera, véridiques et
pourtant imperceptiblement stylisés par le goût du maître, ces atours,
aujourd’hui surannés, puis demain aussi éloquents et non moins
lointains que les paniers d’une Adélaïde par Nattier, ou les brocarts
d’une Ilérodiade par Massys ; séculaires aspects de la femme, frater-
nellement réunis dans l’histoire et dans le temps par le voisinage
d’une paroi de musée. Ne pourrait-on pas dire qu’une mode est
surannée tant qu’elle ne saurait être portée dans un bal costumé
sans risquer l’équivoque de se rencontrer en même temps sur les
épaules d’une personne d’âge, qui se serait égarée là sous sa toilette
d’habitude ? Toilettes qui furent encore celles de nos mères ; belles
robes dont les cloches soyeuses semblaient de géants pétales d’althœas
retombants, et desquelles les (leurs brodées, brochées, chinées ou
peintes, couraient sur les réseaux à la fois souples et résistants de la
crinoline, telles que des pariétaires sur un treillage ; — je dirai un
jour, dans quelques pages que je voudrais écrire sur la mode, ce qui,
à mon sens, faisait leur beauté. Je ne veux aujourd’hui que les saluer
dans les admirables tableaux du vieux grand maître qui les a
d’avance immortalisées.
Jupe en soie du jaune d’un bouton d’or un peu éteint, dans
ce tableautin du Luxembourg, que le globe laiteux d’une lampe
qui a veillé éclaire comme d’une transparence d’hostie. Mirages,
miroitements d’étoffes aussi invitants que les eaux sous lesquelles
chantaient les sirènes. Eaux qui roulent des perles, toujours.
Perl es qui pleurent avec ces jeunes femmes, car elles sont tristes,
ces Ophélies. Ophélies, les nommé-je ainsi? Peut-être. Le maître
l’a fait une fois dans un de ses plus charmants tableaux qui me
touche de près. Et c’est la grande sœur de toutes les autres. Oui,
des Ophélies qui ont connu et goûté l’amour, mais qui, sous leurs
atours bouffants et un peu bouffons, le pleurent de leurs pleurs
et de leurs perles. Elles tiennent des lettres décachetées dans leurs
belles mains, dont les ongles semblent les pétales polis d’une rose
en coquillages, Et la turquoise qui meurt à leur doigt n’est qu’une
GAZETTE DES BEAUX-ARTS
ce fait, historique maintenant, de la réalité de leurs mascarades qui,
dans l'intervalle de répétitions pour des comédies de société, se
répandaient, à demi déguisées, sous les ombrages d’un vieux parc
où Watteau fixait pour l’éternité leurs silhouettes transitoires. Les
spéciales élégances du second Empire, trop voisines encore pour
qu’on les puisse juger sans passion, sont fixées ainsi dans les
anciennes toiles d’Alfred Stevens.
C’est dans ses tableaux que l'avenir les admirera, véridiques et
pourtant imperceptiblement stylisés par le goût du maître, ces atours,
aujourd’hui surannés, puis demain aussi éloquents et non moins
lointains que les paniers d’une Adélaïde par Nattier, ou les brocarts
d’une Ilérodiade par Massys ; séculaires aspects de la femme, frater-
nellement réunis dans l’histoire et dans le temps par le voisinage
d’une paroi de musée. Ne pourrait-on pas dire qu’une mode est
surannée tant qu’elle ne saurait être portée dans un bal costumé
sans risquer l’équivoque de se rencontrer en même temps sur les
épaules d’une personne d’âge, qui se serait égarée là sous sa toilette
d’habitude ? Toilettes qui furent encore celles de nos mères ; belles
robes dont les cloches soyeuses semblaient de géants pétales d’althœas
retombants, et desquelles les (leurs brodées, brochées, chinées ou
peintes, couraient sur les réseaux à la fois souples et résistants de la
crinoline, telles que des pariétaires sur un treillage ; — je dirai un
jour, dans quelques pages que je voudrais écrire sur la mode, ce qui,
à mon sens, faisait leur beauté. Je ne veux aujourd’hui que les saluer
dans les admirables tableaux du vieux grand maître qui les a
d’avance immortalisées.
Jupe en soie du jaune d’un bouton d’or un peu éteint, dans
ce tableautin du Luxembourg, que le globe laiteux d’une lampe
qui a veillé éclaire comme d’une transparence d’hostie. Mirages,
miroitements d’étoffes aussi invitants que les eaux sous lesquelles
chantaient les sirènes. Eaux qui roulent des perles, toujours.
Perl es qui pleurent avec ces jeunes femmes, car elles sont tristes,
ces Ophélies. Ophélies, les nommé-je ainsi? Peut-être. Le maître
l’a fait une fois dans un de ses plus charmants tableaux qui me
touche de près. Et c’est la grande sœur de toutes les autres. Oui,
des Ophélies qui ont connu et goûté l’amour, mais qui, sous leurs
atours bouffants et un peu bouffons, le pleurent de leurs pleurs
et de leurs perles. Elles tiennent des lettres décachetées dans leurs
belles mains, dont les ongles semblent les pétales polis d’une rose
en coquillages, Et la turquoise qui meurt à leur doigt n’est qu’une