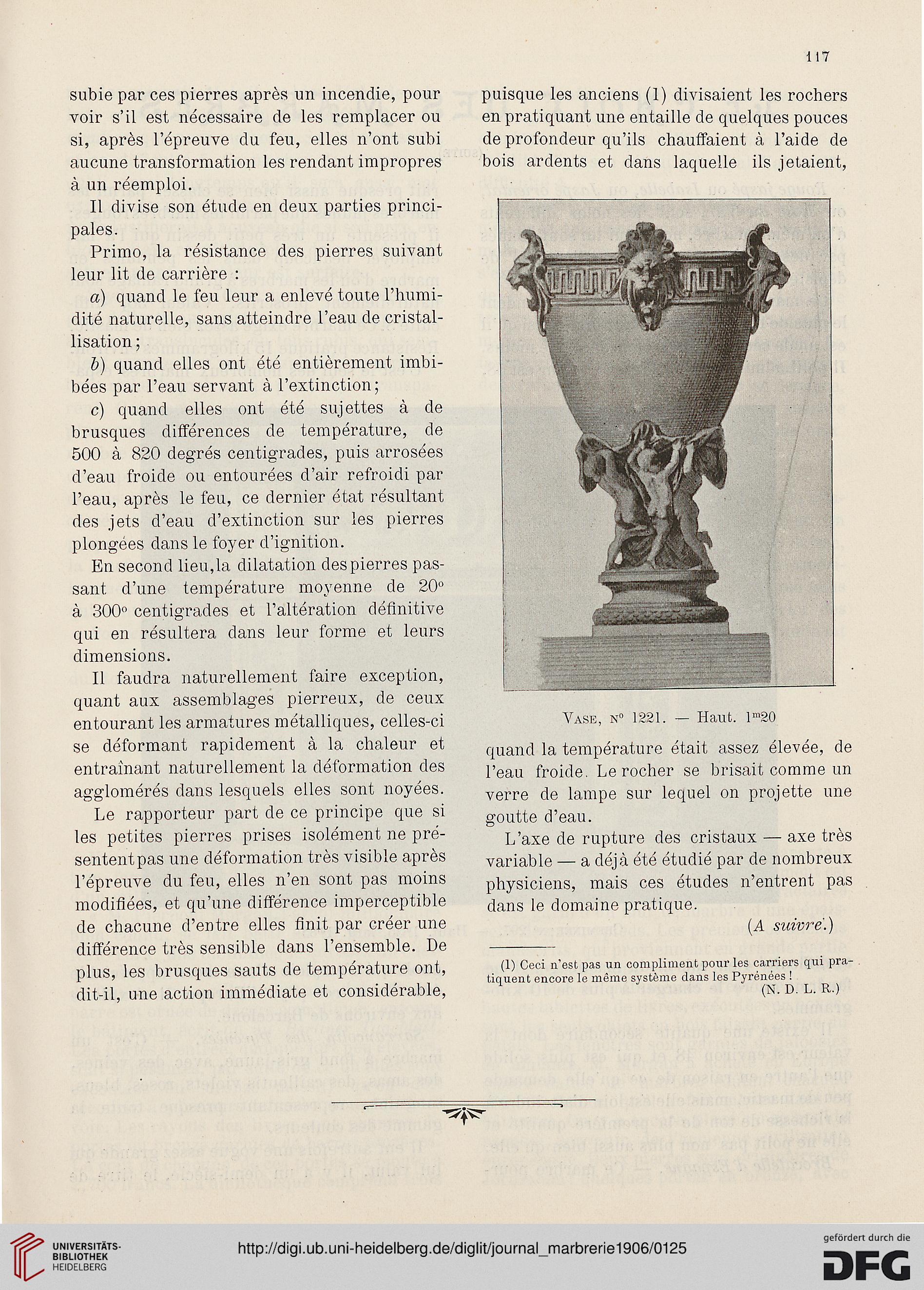1 17
subie par ces pierres après un incendie, pour
voir s'il est nécessaire de les remplacer ou
si, après l'épreuve du feu, elles n'ont subi
aucune transformation les rendant impropres
à un réemploi.
Il divise son étude en deux parties princi-
pales.
Primo, la résistance des pierres suivant
leur lit de carrière :
a) quand le feu leur a enlevé toute l'humi-
dité naturelle, sans atteindre l'eau de cristal-
lisation ;
b) quand elles ont été entièrement imbi-
bées par l'eau servant à l'extinction;
c) quand elles ont été sujettes à de
brusques différences de température, de
500 à 820 degrés centigrades, puis arrosées
d'eau froide ou entourées d'air refroidi par
l'eau, après le feu, ce dernier état résultant
des jets d'eau d'extinction sur les pierres
plongées dans le foyer d'ignition.
En second lieu,la dilatation des pierres pas-
sant, d'une température moyenne de 20°
à 300° centigrades et l'altération définitive
qui en résultera dans leur forme et leurs
dimensions.
Il faudra naturellement faire exception,
quant aux assemblages pierreux, de ceux
entourant les armatures métalliques, celles-ci
se déformant rapidement à la chaleur et
entraînant naturellement la déformation des
agglomérés dans lesquels elles sont noyées.
Le rapporteur part de ce principe que si
les petites pierres prises isolément ne pré-
sententpas une déformation très visible après
l'épreuve du feu, elles n'en sont pas moins
modifiées, et qu'une différence imperceptible
de chacune d'entre elles finit par créer une
différence très sensible dans l'ensemble. De
plus, les brusques sauts de température ont,
dit-il, une action immédiate et considérable,
puisque les anciens (1) divisaient les rochers
en pratiquant une entaille de quelques pouces
de profondeur qu'ils chauffaient à l'aide de
bois ardents et dans laquelle ils jetaient,
Vase, n° 1221. — Haut. lm20
quand la température était assez élevée, de
l'eau froide. Le rocher se brisait comme un
verre de lampe sur lequel on projette une
goutte d'eau.
L'axe de rupture des cristaux — axe très
variable — a déjà été étudié par de nombreux
physiciens, mais ces études n'entrent pas
dans le domaine pratique.
(A suivre.)
(1) Ceci n'est pas un compliment pour les carriers qui pra-
tiquent encore le même système dans les Pyrénées !
(N. D. L. R.)
subie par ces pierres après un incendie, pour
voir s'il est nécessaire de les remplacer ou
si, après l'épreuve du feu, elles n'ont subi
aucune transformation les rendant impropres
à un réemploi.
Il divise son étude en deux parties princi-
pales.
Primo, la résistance des pierres suivant
leur lit de carrière :
a) quand le feu leur a enlevé toute l'humi-
dité naturelle, sans atteindre l'eau de cristal-
lisation ;
b) quand elles ont été entièrement imbi-
bées par l'eau servant à l'extinction;
c) quand elles ont été sujettes à de
brusques différences de température, de
500 à 820 degrés centigrades, puis arrosées
d'eau froide ou entourées d'air refroidi par
l'eau, après le feu, ce dernier état résultant
des jets d'eau d'extinction sur les pierres
plongées dans le foyer d'ignition.
En second lieu,la dilatation des pierres pas-
sant, d'une température moyenne de 20°
à 300° centigrades et l'altération définitive
qui en résultera dans leur forme et leurs
dimensions.
Il faudra naturellement faire exception,
quant aux assemblages pierreux, de ceux
entourant les armatures métalliques, celles-ci
se déformant rapidement à la chaleur et
entraînant naturellement la déformation des
agglomérés dans lesquels elles sont noyées.
Le rapporteur part de ce principe que si
les petites pierres prises isolément ne pré-
sententpas une déformation très visible après
l'épreuve du feu, elles n'en sont pas moins
modifiées, et qu'une différence imperceptible
de chacune d'entre elles finit par créer une
différence très sensible dans l'ensemble. De
plus, les brusques sauts de température ont,
dit-il, une action immédiate et considérable,
puisque les anciens (1) divisaient les rochers
en pratiquant une entaille de quelques pouces
de profondeur qu'ils chauffaient à l'aide de
bois ardents et dans laquelle ils jetaient,
Vase, n° 1221. — Haut. lm20
quand la température était assez élevée, de
l'eau froide. Le rocher se brisait comme un
verre de lampe sur lequel on projette une
goutte d'eau.
L'axe de rupture des cristaux — axe très
variable — a déjà été étudié par de nombreux
physiciens, mais ces études n'entrent pas
dans le domaine pratique.
(A suivre.)
(1) Ceci n'est pas un compliment pour les carriers qui pra-
tiquent encore le même système dans les Pyrénées !
(N. D. L. R.)