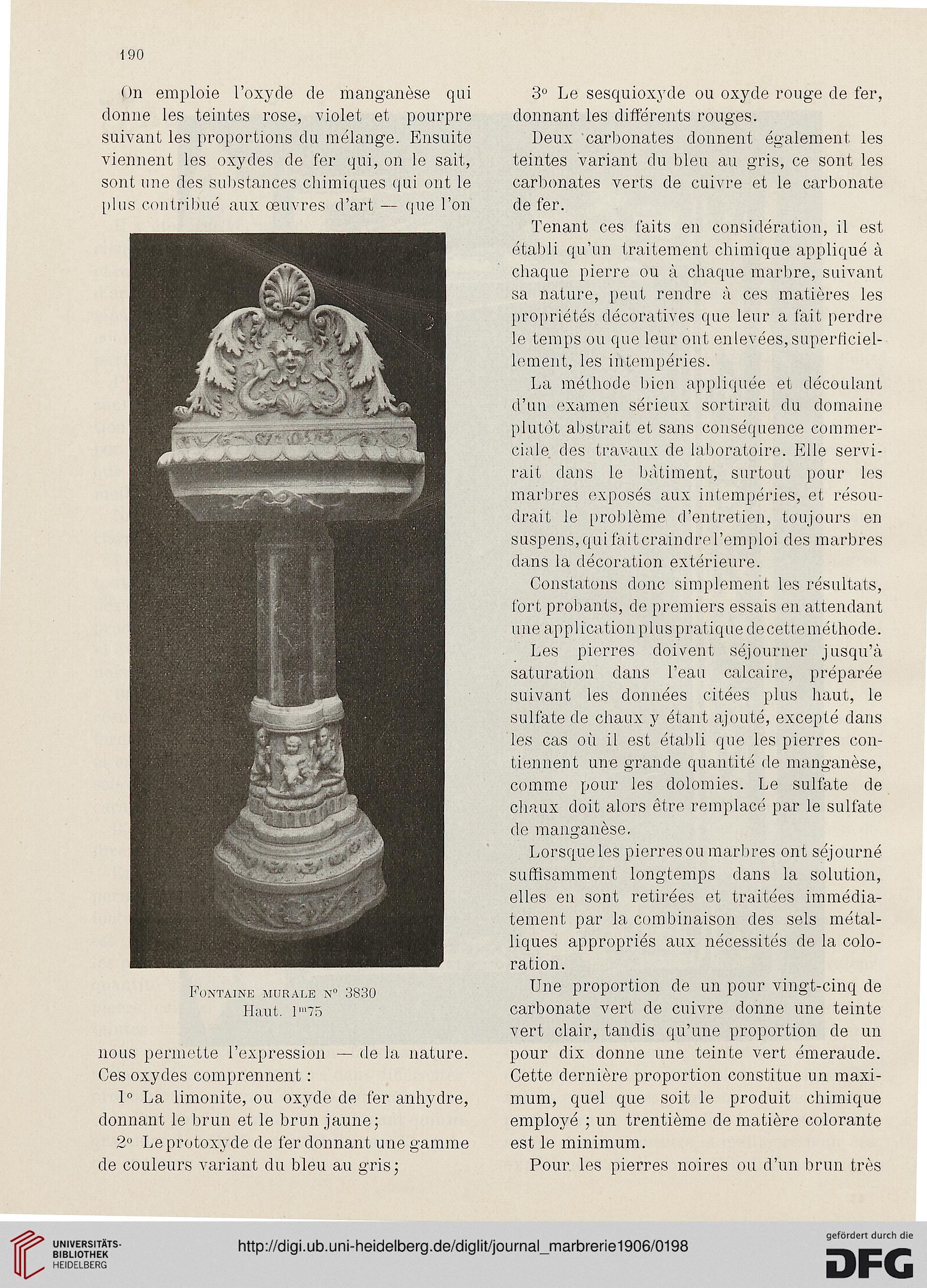190
On emploie l'oxyde de manganèse qui
donne les teintes rose, violet et pourpre
suivant les proportions du mélange. Ensuite
viennent les oxydes de fer qui, on le sait,
sont une des substances chimiques qui ont le
plus contribué aux oeuvres d'art — que l'on
Fontaine murale n° 3830
Haut. l'"75
nous permette l'expression — de la nature.
Ces oxydes comprennent :
1° La limonite, ou oxyde de ter anhydre,
donnant le brun et le brun jaune;
2° Le protoxyde de fer donnant une gamme
de couleurs variant du bleu au gris ;
3° Le sesquioxyde ou oxyde rouge de fer,
donnant les différents rouges.
Deux carbonates donnent également les
teintes variant du bleu au gris, ce sont les
carbonates verts de cuivre et le carbonate
de fer.
Tenant ces faits en considération, il est
établi qu'un traitement chimique appliqué à
chaque pierre ou à chaque marbre, suivant
sa nature, peut rendre à ces matières les
propriétés décoratives que leur a fait perdre
le temps ou que leur ont en levées, superficiel-
lement, les intempéries.
La méthode bien appliquée et découlant
d'un examen sérieux sortirait du domaine
plutôt abstrait et sans conséquence commer-
ciale des travaux de laboratoire. Elle servi-
rait dans le bâtiment, surtout pour les
marbres exposés aux intempéries, et résou-
drait le problème d'entretien, toujours en
suspens,quifaitcraindrel'emploi des marbres
dans la décoration extérieure.
Constatons donc simplement les résultats,
fort probants, de premiers essais en attendant
une application plus pratique de cette méthode.
Les pierres doivent séjourner jusqu'à
saturation dans l'eau calcaire, préparée
suivant les données citées plus haut, le
sulfate de chaux y étant ajouté, excepté dans
les cas où il est établi que les pierres con-
tiennent une grande quantité de manganèse,
comme pour les dolomies. Le sulfate de
chaux doit alors être remplacé par le sulfate
de manganèse.
Lorsque les pierres ou marbres ont séjourné
suffisamment longtemps dans la solution,
elles en sont retirées et traitées immédia-
tement par la combinaison des sels métal-
liques appropriés aux nécessités de la colo-
ration.
Une proportion de un pour vingt-cinq de
carbonate vert de cuivre donne une teinte
vert clair, tandis qu'une proportion de un
pour dix donne une teinte vert émeraude.
Cette dernière proportion constitue un maxi-
mum, quel que soit le produit chimique
employé ; un trentième de matière colorante
est le minimum.
Pour les pierres noires ou d'un brun très
On emploie l'oxyde de manganèse qui
donne les teintes rose, violet et pourpre
suivant les proportions du mélange. Ensuite
viennent les oxydes de fer qui, on le sait,
sont une des substances chimiques qui ont le
plus contribué aux oeuvres d'art — que l'on
Fontaine murale n° 3830
Haut. l'"75
nous permette l'expression — de la nature.
Ces oxydes comprennent :
1° La limonite, ou oxyde de ter anhydre,
donnant le brun et le brun jaune;
2° Le protoxyde de fer donnant une gamme
de couleurs variant du bleu au gris ;
3° Le sesquioxyde ou oxyde rouge de fer,
donnant les différents rouges.
Deux carbonates donnent également les
teintes variant du bleu au gris, ce sont les
carbonates verts de cuivre et le carbonate
de fer.
Tenant ces faits en considération, il est
établi qu'un traitement chimique appliqué à
chaque pierre ou à chaque marbre, suivant
sa nature, peut rendre à ces matières les
propriétés décoratives que leur a fait perdre
le temps ou que leur ont en levées, superficiel-
lement, les intempéries.
La méthode bien appliquée et découlant
d'un examen sérieux sortirait du domaine
plutôt abstrait et sans conséquence commer-
ciale des travaux de laboratoire. Elle servi-
rait dans le bâtiment, surtout pour les
marbres exposés aux intempéries, et résou-
drait le problème d'entretien, toujours en
suspens,quifaitcraindrel'emploi des marbres
dans la décoration extérieure.
Constatons donc simplement les résultats,
fort probants, de premiers essais en attendant
une application plus pratique de cette méthode.
Les pierres doivent séjourner jusqu'à
saturation dans l'eau calcaire, préparée
suivant les données citées plus haut, le
sulfate de chaux y étant ajouté, excepté dans
les cas où il est établi que les pierres con-
tiennent une grande quantité de manganèse,
comme pour les dolomies. Le sulfate de
chaux doit alors être remplacé par le sulfate
de manganèse.
Lorsque les pierres ou marbres ont séjourné
suffisamment longtemps dans la solution,
elles en sont retirées et traitées immédia-
tement par la combinaison des sels métal-
liques appropriés aux nécessités de la colo-
ration.
Une proportion de un pour vingt-cinq de
carbonate vert de cuivre donne une teinte
vert clair, tandis qu'une proportion de un
pour dix donne une teinte vert émeraude.
Cette dernière proportion constitue un maxi-
mum, quel que soit le produit chimique
employé ; un trentième de matière colorante
est le minimum.
Pour les pierres noires ou d'un brun très