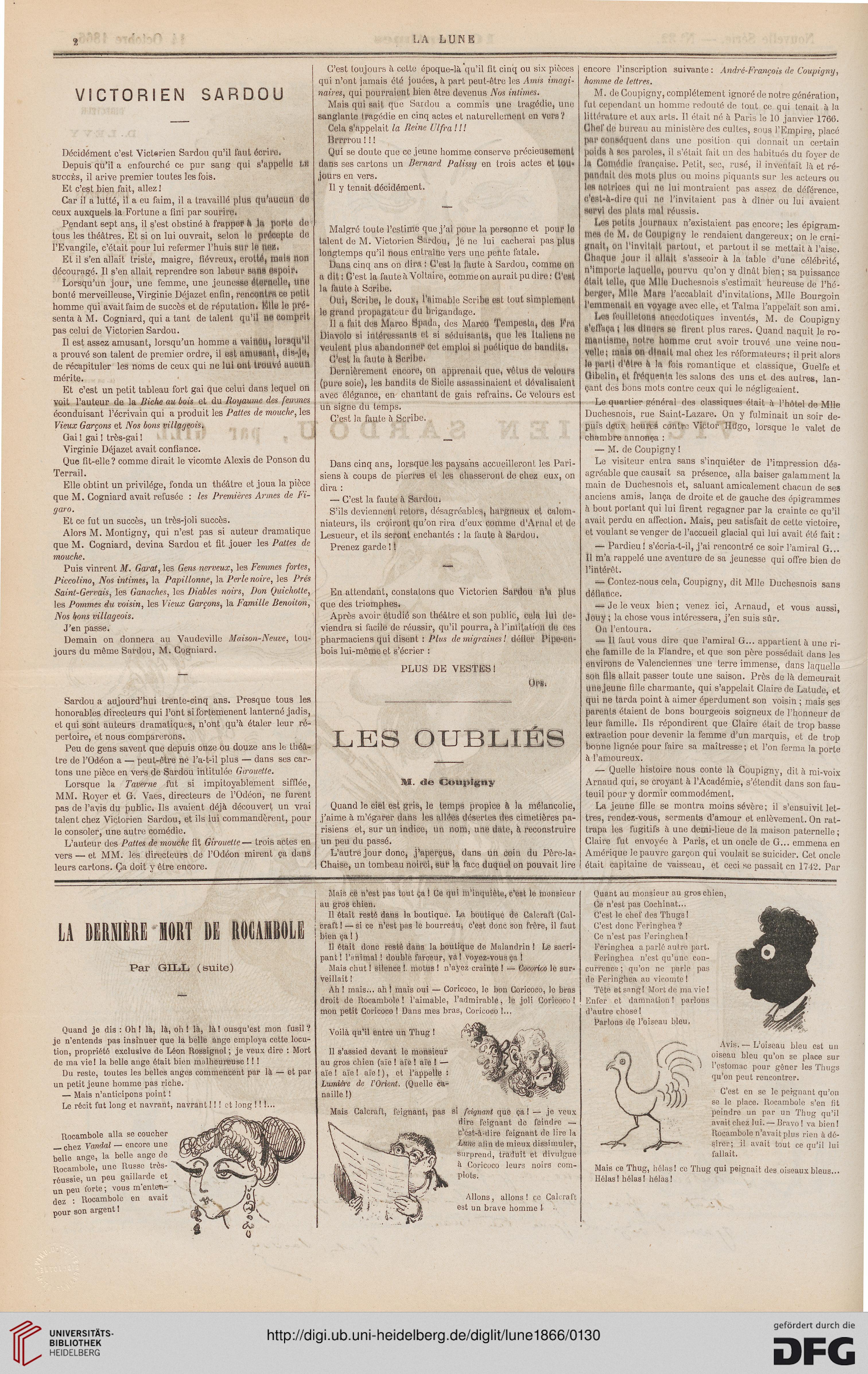LA LUNE
VICTORIEN SARDOU
Décidément c'est Victerien Sardou qu'il i'aut écrire.
Depuis qu'il a enfourché ce pur sang qui s'appelle i.rc
succès, il arive premier toutes les l'ois.
Et c'est bien l'ait, allez 1
Car il a lutté, il a eu faim, il a travaillé plus qu'aucun de
ceux auxquels la Fortune a fini par sourire.
Pendant sept ans, il s'est obstiné à frapper h la porto do
tous les théâtres. Et si on lui ouvrait, selon lo précepte de
l'Evangile, c'était pour lui refermer l'huis sur lo hOB.
Et il s'en allait triste, maigre, fiévreux, crotté) mais lion
découragé. Il s'en allait reprendre son labeur biUIb espoir.
Lorsqu'un .jour, une femme, une jeunesse éternelle, Une
bonté merveilleuse, Virginie Déjazet enfin, rencontré ce petit
homme qui avait faim de succès et de réputation. Elle le pré-
senta à M. Cogniard, qui a tant de talent qu'il ne comprit
pas celui de Victorien Sardou.
Il est assez amusant, lorsqu'un homme a vaindtlj lorsqu'il
a prouvé son talent de premier ordre, il est amusant, dis-jOj
de récapituler les noms de ceux qui ne lui ont trouvé aucun
mérite.
Et c'est un petit tableau fort gai que celui dans lequel on
voit l'auteur de la Biche au bois et du Jloyauiuc des femmes
éconduisant l'écrivain qui a produit les Pattes de mouche, les
Vieux Garçons et Nos botis villageois.
Gai ! gai ! trôs-gai !
Virginie Déjazet avait confiance.
Que fit-elle? comme dirait le vicomte Alexis de Ponson du
Terrail.
Elle obtint un privilège, fonda un théâtre et joua la pièce
que M. Cogniard avait refusée : les Premières Armes de Fi-
garo.
Et ce fut un succès, un très-joli succès.
Alors M. Montigny, qui n'est pas si auteur dramatique
que M. Cogniard, devina Sardou et fit jouer les Pattes de
mouche.
Puis vinrent M. Garât, les Gens nerveux, les Femmes fortes,
Piccolino, Nos intimes, la Papillonne, la Perle noire, les Prés
Saint-Gerrais, les Ganaches, les Diables noirs, Don Quichotte,
les Pommes du voisin, les Vieux Garçons, la Famille Benoiton,
Nos botis villageois.
J'en passe.
Demain on donnera au Vaudeville Maison-Neuve, tou-
jours du même Sardou, M. Cogniard.
Sardou a aujourd'hui trente-cinq ans. Presque tous les
honorables directeurs qui l'ont si l'ortemenent lanterné jadis,
et qui sont auteurs dramatiques, n'ont qu'à étaler leur ré-
pertoire, et nous comparerons.
Peu de gens savent que depuis onze ou douze ans le théâ-
tre de l'Odéon a — peut-ôtre ne l'a-t-il plus — dans ses car-
tons une pièce en vers de Sardou intitulée Girouette.
Lorsque la Taverne fut si impitoyablement sifflée,
MM. Royer et G. Vaes, directeurs de l'Odéon, ne furent
pas de l'avis du public. Ils avaient déjà découvert un vrai
talent chez Victorien Sardou, et ils lui commandèrent, pour
le consoler, une autre comédie.
L'auteur des Pattes de mouche fit Girouette— trois actes en
vers — et MM. les directeurs de l'Odéon mirent ça dans
leurs cartons. Ça doit y être encore.
C'est toujours à cette époque-là qu'il fit cinq ou six pièces
qui n'ont jamais été jouées, à part peut-être les Amis imagi-
naires, qui pourraient bien être devenus Nos intimes.
Mais qui sait que Sardou a commis une tragédie, une
sanglante tragédie en cinq actes et naturellement en vers?
Cela s'appelait la Reine Ulfra ! 1 !
Drrrrou ! ! !
Qui se doute que ce jeune homme conserve précieusement
dans ses cartons un Bernard Palissy en trois actes et tou»
jours en vers.
Il y tenait décidément.
Malgré toute l'estime que j'ai pour la personne et pour lo
talent de M. Victorien Sardou, je ne lui cacherai pas plus
longtemps qu'il nous entraîne vers une pente fatale.
Dans cinq ans on dira : C'est la faute à Sardou, comme on
a dit: G'est la faute à Voltaire, comme on aurait pu dire: C'obI
la faute à Scribe.
Oui, Serine, le doux, l'aimable Scribe est tout simplement
lo grand propagateur dut brigandage.
Il a fait des Marco Spada, des Marco T'empesta, des Fnt
Diavolo si intéressants et si séduisantSj que les Italiens no
veulent plus abandonner cet emploi si poétique de bandits.
C'est la faute a Scribe.
Dernièrement encore, on apprenait que, vêtus de velours
(pure soie), les bandits de Sicile assassinaient et dévalisaient
avec élégance, en chantant de gais refrains. Ce velours est
un signe du temps.
C'est la faute à Scribe.
Dans cinq ans, lorsque les paysans accueilleront, les Pari-
siens à coups de pierres et les chasseront de chez eux, on
dira :
— C'est la faute h Sanlou.
S'ils deviennent retors, désagréables, hargneux et calom-
niateurs, ils croiront qu'on rira d'eux comme d'Arnal et de
Lesueur, et ils seront enchantés : la faute à Sardou.
Prenez garde ! 1
En attendant, constatons que Victorien Sardou n'a blus
que des triomphes.
Après avoir étudié son théâtre et son publie, cela lui de-
viendra si facile de réussir, qu'il pourra, à l'imitation de ces
pharmaciens qui disent : Plu.s de migraines 1 défier Pipe-en-
bois lui-même et s'écrier :
PLUS DE VESTES I
Ors.
LES OUBLIÉS
\l. de Coupigny
Quand le ciel est gris, le temps propice à la mélancolie,
j'aime à m'égarer dans les allées désertes des cimetières pa
risiens et, sur un indice, un nom, une date, à reconstruire
un peu du passé.
L'autre jour donc, j'aperçus, dans un coin du Père-la
Chaise, un tombeau noirci, sur la face duquel on pouvait lire
encore l'inscription suivante : André-François de Coupigny,
homme de lettres.
M. de Coupigny, complètement ignoré de notre génération,
"ut cependant un homme redouté de tout ce qui tenait à ta
littérature et aux arts. Il était né à Paris le 10 janvier 1766.
Chef de bureau au ministère des cultes, snus l'Empire, placé
par conséquent dans une position qui donnait un certain
poids à ses paroles, il s'était fait un dos habitués du foyer de
la Comédie française. Petit, sec, rusé, il inventait là et ré-
pandait des mots plus ou moins piquants sur les acteurs ou
|M actrices qui ne lui montraient pas assez de déférence,
c'est-à-dire qui ne l'invitaient pas à dîner ou lui avaient
servi des plats mal réussis.
Les pulits journaux n'existaient pas encore; les épigram-
mes do M. de Coupigny le rendaient dangereux; on le crai-
gnait, on l'invitait partout, et partout il se mettait à l'aise.
Chaque jour il allait s'asseoir à la table d'une célébrité,
n'importe laquelle, pourvu qu'on y dînât bien; sa puissance
était telle, que Mlle Duchesnois s'estimait heureuse do l'hé-
berger, Mlle Mars l'accablait d'invitations, Mlle Bourgoin
l'emmunait en voyage avec elle, et Talma l'appelait son ami.
Les feuilletons anecdotiques inventés, M. de Coupigny
s'effaça i les dîners se firent plus rares. Quand naquit le ro-
mantisme, notre homme crut avoir trouvé une veine nou-
velle; mais on dînait mal chez les réformateurs; il prit alors
le parti d'être à la fois romantique et classique, Guelfe et
Gibelin, et fréquenta les salons des uns et des autres, lan-
çant des bons mots contre ceux qui le négligeaient.
Le quartier général des classiques était à l'hôtel de Mlle
Duchesnois, rue Saint-Lazare. On y fulminait un soir de-
puis deux heufe* contre Victor Hugo, lorsque le valet de
chambre annonça :
— M. de Coupigny !
Le visiteur entra sans s'inquiéter de l'impression dés-
agréable que causait sa présence, alla baiser galamment la
main de Duchesnois et, saluant amicalement chacun de ses
anciens amis, lança de droite et de gauche des épigrammes
à bout portant qui lui firent regagner par la crainte ce qu'il
avait perdu en affection. Mais, peu satisfait de cette victoire,
et voulant se venger de l'accueil glacial qui lui avait été fait :
— Pardieu! s'écria-t-il, j'ai rencontré ce soir l'amiral G...
Il m'a rappelé une aventure de sa jeunesse qui offre bien de
l'intérêt.
— Contez-nous cela, Coupigny, dit Mlle Duchesnois sans
défiance.
— Je le veux bien; venez ici, Arnaud, et vous aussi,
Jouy ; la chose vous intéressera, j'en suis sûr.
On l'entoura.
— 11 faut vous dire que l'amiral G... appartient à une ri-
che famille de la Flandre, et que son père possédait dans les
environs de Valenciennes une terre immense, dans laquelle
son fils allait passer toute une saison. Près de là demeurait
une jeune fille charmante, qui s'appelait Claire de Lalude, et
qui ne tarda point à aimer éperdument son voisin ; mais ses
parents étaient de bons bourgeois soigneux de l'honneur de
leur famille. Ils répondirent que Claire était de trop basse
extraction pour devenir la femme d'un marquis, et de trop
bonne lignée pour faire sa maîtresse; et l'on ferma la porte
à l'amoureux.
— Quelle histoire nous conte là Coupigny, dit à mi-voix
Arnaud qui, se croyant à l'Académie, s'étendit dans son fau-
teuil pour y dormir commodément.
La jeune fille se montra moins sévère; il s'ensuivit let-
tres, rendez-vous, serments d'amour et enlèvement. On rat-
trapa les fugitifs à une demi-lieue de la maison paternelle ;
Claire fut envoyée à Paris, et un oncle de G... emmena en
Amérique le pauvre garçon qui voulait se suicider. Cet oncle
était capitaine de vaisseau, ot ceci se passait en 17 12. Par
LA WMll MIT 1)1 ROUiBOLE
Par GILL (suite)
Quand je dis : Oh! là, là, oh ! là, là! ousqu'est mon fusil?
je n'entends pas insinuer que la belle ange employa cette locu-
tion, propriété exclusive de Léon Rossignol ; je veux dire : Mort
de ma vie! la belle ange était bien malheureuse ! ! !
Du reste, toutes les belles anges commencent par là — et par
un petit jeune homme pas riche.
— Mais n'anticipons point !
Le récit fut long et navrant, navrant ! I ! et long ! ! !...
Rocambole alla se coucher
— chez Vandal — encore une
belle ange, la belle ange de
Rocambole, une Russe très-
réussie, un peu gaillarde et
un peu t'orte ; vous m'enten-
dez : Rocambole en avait
pour son argent !
Mais cë n'est pas tout ça ! Ce qui m'inquiète, c'est le monsieur
au gros chien.
Il était resté dans la boutique. La boutique de Calerait (Cal-
craft ! — si ce n'est pas le bourreau; c'est donc son frère, il faut
bien ça I )
Il était donc resté dans la boutique de Malandrin ! Le sacri-
pant! l'animal ! double farceur, va! voyez-vous ça !
Mais chut ! silence !. motus ! n'ayez crainte ! — Cocorico le sur-
veillait !
Ah ! mais... ah ! mais oui — Coricoco, le bon Coricoco, lo bras
droit de Rocambole! l'aimable, l'admirable, le joli Coricoco!
mon petit Coricoco ! Dans mes bras, Coricoco !...
Voilà qu'il entre un Thug
Il s'assied devant le monsieur
au gros chien (aïe ! aïe ! aïe ! —
aïe ! aïe ! aïe ! ), et l'appelle :
Lumière de l'Orient. (Quelle ca-
naille !)
Mais Calcraft, feignant, pas si feignant que ça ! — je veux
dire feignant do feindre —
c'est-à-dire feignant de lire la
Lune afin de mieux dissimuler,
surprend, traduit et divufjrnc
à Coricoco leurs noirs com-
plots.
Allons, allons! ce Calcraft
est un brave homme l •
Quant au monsieur au gros chien,
Ce n'est pas Cochinat...
C'est le chef des Thugs!
C'est donc Feringhea ?
Ce n'est pas Feringhea !
Feringhea a parlé autre part.
Feringhea n'est qu'une con-
currence; qu'on ne parle pas
de Feringhea au vicomte !
Tète et sang! Mort do ma vie!
Enfer et damnation ! parlons
d'autre chose!
Parlons de l'oiseau bleu.
Avis. — L'oiseau bleu est un
oiseau bleu qu'on se place sur
l'estomac pour gêner les Thuga
qu'on peut rencontrer.
C'est en se le peignant qu'on
se le place. Rocambole s'en fit
peindre un par un Thug qu'il
avait chez lui.— Bravo! va bien!
Rocambole n'avait plus rien à dé-
sirer; il avait tout ce qu'il lui
fallait.
Mais ce Thug, hélas! ce Thug qui peignait des oiseaux bleus...
Hélas! hélas! hélas!
VICTORIEN SARDOU
Décidément c'est Victerien Sardou qu'il i'aut écrire.
Depuis qu'il a enfourché ce pur sang qui s'appelle i.rc
succès, il arive premier toutes les l'ois.
Et c'est bien l'ait, allez 1
Car il a lutté, il a eu faim, il a travaillé plus qu'aucun de
ceux auxquels la Fortune a fini par sourire.
Pendant sept ans, il s'est obstiné à frapper h la porto do
tous les théâtres. Et si on lui ouvrait, selon lo précepte de
l'Evangile, c'était pour lui refermer l'huis sur lo hOB.
Et il s'en allait triste, maigre, fiévreux, crotté) mais lion
découragé. Il s'en allait reprendre son labeur biUIb espoir.
Lorsqu'un .jour, une femme, une jeunesse éternelle, Une
bonté merveilleuse, Virginie Déjazet enfin, rencontré ce petit
homme qui avait faim de succès et de réputation. Elle le pré-
senta à M. Cogniard, qui a tant de talent qu'il ne comprit
pas celui de Victorien Sardou.
Il est assez amusant, lorsqu'un homme a vaindtlj lorsqu'il
a prouvé son talent de premier ordre, il est amusant, dis-jOj
de récapituler les noms de ceux qui ne lui ont trouvé aucun
mérite.
Et c'est un petit tableau fort gai que celui dans lequel on
voit l'auteur de la Biche au bois et du Jloyauiuc des femmes
éconduisant l'écrivain qui a produit les Pattes de mouche, les
Vieux Garçons et Nos botis villageois.
Gai ! gai ! trôs-gai !
Virginie Déjazet avait confiance.
Que fit-elle? comme dirait le vicomte Alexis de Ponson du
Terrail.
Elle obtint un privilège, fonda un théâtre et joua la pièce
que M. Cogniard avait refusée : les Premières Armes de Fi-
garo.
Et ce fut un succès, un très-joli succès.
Alors M. Montigny, qui n'est pas si auteur dramatique
que M. Cogniard, devina Sardou et fit jouer les Pattes de
mouche.
Puis vinrent M. Garât, les Gens nerveux, les Femmes fortes,
Piccolino, Nos intimes, la Papillonne, la Perle noire, les Prés
Saint-Gerrais, les Ganaches, les Diables noirs, Don Quichotte,
les Pommes du voisin, les Vieux Garçons, la Famille Benoiton,
Nos botis villageois.
J'en passe.
Demain on donnera au Vaudeville Maison-Neuve, tou-
jours du même Sardou, M. Cogniard.
Sardou a aujourd'hui trente-cinq ans. Presque tous les
honorables directeurs qui l'ont si l'ortemenent lanterné jadis,
et qui sont auteurs dramatiques, n'ont qu'à étaler leur ré-
pertoire, et nous comparerons.
Peu de gens savent que depuis onze ou douze ans le théâ-
tre de l'Odéon a — peut-ôtre ne l'a-t-il plus — dans ses car-
tons une pièce en vers de Sardou intitulée Girouette.
Lorsque la Taverne fut si impitoyablement sifflée,
MM. Royer et G. Vaes, directeurs de l'Odéon, ne furent
pas de l'avis du public. Ils avaient déjà découvert un vrai
talent chez Victorien Sardou, et ils lui commandèrent, pour
le consoler, une autre comédie.
L'auteur des Pattes de mouche fit Girouette— trois actes en
vers — et MM. les directeurs de l'Odéon mirent ça dans
leurs cartons. Ça doit y être encore.
C'est toujours à cette époque-là qu'il fit cinq ou six pièces
qui n'ont jamais été jouées, à part peut-être les Amis imagi-
naires, qui pourraient bien être devenus Nos intimes.
Mais qui sait que Sardou a commis une tragédie, une
sanglante tragédie en cinq actes et naturellement en vers?
Cela s'appelait la Reine Ulfra ! 1 !
Drrrrou ! ! !
Qui se doute que ce jeune homme conserve précieusement
dans ses cartons un Bernard Palissy en trois actes et tou»
jours en vers.
Il y tenait décidément.
Malgré toute l'estime que j'ai pour la personne et pour lo
talent de M. Victorien Sardou, je ne lui cacherai pas plus
longtemps qu'il nous entraîne vers une pente fatale.
Dans cinq ans on dira : C'est la faute à Sardou, comme on
a dit: G'est la faute à Voltaire, comme on aurait pu dire: C'obI
la faute à Scribe.
Oui, Serine, le doux, l'aimable Scribe est tout simplement
lo grand propagateur dut brigandage.
Il a fait des Marco Spada, des Marco T'empesta, des Fnt
Diavolo si intéressants et si séduisantSj que les Italiens no
veulent plus abandonner cet emploi si poétique de bandits.
C'est la faute a Scribe.
Dernièrement encore, on apprenait que, vêtus de velours
(pure soie), les bandits de Sicile assassinaient et dévalisaient
avec élégance, en chantant de gais refrains. Ce velours est
un signe du temps.
C'est la faute à Scribe.
Dans cinq ans, lorsque les paysans accueilleront, les Pari-
siens à coups de pierres et les chasseront de chez eux, on
dira :
— C'est la faute h Sanlou.
S'ils deviennent retors, désagréables, hargneux et calom-
niateurs, ils croiront qu'on rira d'eux comme d'Arnal et de
Lesueur, et ils seront enchantés : la faute à Sardou.
Prenez garde ! 1
En attendant, constatons que Victorien Sardou n'a blus
que des triomphes.
Après avoir étudié son théâtre et son publie, cela lui de-
viendra si facile de réussir, qu'il pourra, à l'imitation de ces
pharmaciens qui disent : Plu.s de migraines 1 défier Pipe-en-
bois lui-même et s'écrier :
PLUS DE VESTES I
Ors.
LES OUBLIÉS
\l. de Coupigny
Quand le ciel est gris, le temps propice à la mélancolie,
j'aime à m'égarer dans les allées désertes des cimetières pa
risiens et, sur un indice, un nom, une date, à reconstruire
un peu du passé.
L'autre jour donc, j'aperçus, dans un coin du Père-la
Chaise, un tombeau noirci, sur la face duquel on pouvait lire
encore l'inscription suivante : André-François de Coupigny,
homme de lettres.
M. de Coupigny, complètement ignoré de notre génération,
"ut cependant un homme redouté de tout ce qui tenait à ta
littérature et aux arts. Il était né à Paris le 10 janvier 1766.
Chef de bureau au ministère des cultes, snus l'Empire, placé
par conséquent dans une position qui donnait un certain
poids à ses paroles, il s'était fait un dos habitués du foyer de
la Comédie française. Petit, sec, rusé, il inventait là et ré-
pandait des mots plus ou moins piquants sur les acteurs ou
|M actrices qui ne lui montraient pas assez de déférence,
c'est-à-dire qui ne l'invitaient pas à dîner ou lui avaient
servi des plats mal réussis.
Les pulits journaux n'existaient pas encore; les épigram-
mes do M. de Coupigny le rendaient dangereux; on le crai-
gnait, on l'invitait partout, et partout il se mettait à l'aise.
Chaque jour il allait s'asseoir à la table d'une célébrité,
n'importe laquelle, pourvu qu'on y dînât bien; sa puissance
était telle, que Mlle Duchesnois s'estimait heureuse do l'hé-
berger, Mlle Mars l'accablait d'invitations, Mlle Bourgoin
l'emmunait en voyage avec elle, et Talma l'appelait son ami.
Les feuilletons anecdotiques inventés, M. de Coupigny
s'effaça i les dîners se firent plus rares. Quand naquit le ro-
mantisme, notre homme crut avoir trouvé une veine nou-
velle; mais on dînait mal chez les réformateurs; il prit alors
le parti d'être à la fois romantique et classique, Guelfe et
Gibelin, et fréquenta les salons des uns et des autres, lan-
çant des bons mots contre ceux qui le négligeaient.
Le quartier général des classiques était à l'hôtel de Mlle
Duchesnois, rue Saint-Lazare. On y fulminait un soir de-
puis deux heufe* contre Victor Hugo, lorsque le valet de
chambre annonça :
— M. de Coupigny !
Le visiteur entra sans s'inquiéter de l'impression dés-
agréable que causait sa présence, alla baiser galamment la
main de Duchesnois et, saluant amicalement chacun de ses
anciens amis, lança de droite et de gauche des épigrammes
à bout portant qui lui firent regagner par la crainte ce qu'il
avait perdu en affection. Mais, peu satisfait de cette victoire,
et voulant se venger de l'accueil glacial qui lui avait été fait :
— Pardieu! s'écria-t-il, j'ai rencontré ce soir l'amiral G...
Il m'a rappelé une aventure de sa jeunesse qui offre bien de
l'intérêt.
— Contez-nous cela, Coupigny, dit Mlle Duchesnois sans
défiance.
— Je le veux bien; venez ici, Arnaud, et vous aussi,
Jouy ; la chose vous intéressera, j'en suis sûr.
On l'entoura.
— 11 faut vous dire que l'amiral G... appartient à une ri-
che famille de la Flandre, et que son père possédait dans les
environs de Valenciennes une terre immense, dans laquelle
son fils allait passer toute une saison. Près de là demeurait
une jeune fille charmante, qui s'appelait Claire de Lalude, et
qui ne tarda point à aimer éperdument son voisin ; mais ses
parents étaient de bons bourgeois soigneux de l'honneur de
leur famille. Ils répondirent que Claire était de trop basse
extraction pour devenir la femme d'un marquis, et de trop
bonne lignée pour faire sa maîtresse; et l'on ferma la porte
à l'amoureux.
— Quelle histoire nous conte là Coupigny, dit à mi-voix
Arnaud qui, se croyant à l'Académie, s'étendit dans son fau-
teuil pour y dormir commodément.
La jeune fille se montra moins sévère; il s'ensuivit let-
tres, rendez-vous, serments d'amour et enlèvement. On rat-
trapa les fugitifs à une demi-lieue de la maison paternelle ;
Claire fut envoyée à Paris, et un oncle de G... emmena en
Amérique le pauvre garçon qui voulait se suicider. Cet oncle
était capitaine de vaisseau, ot ceci se passait en 17 12. Par
LA WMll MIT 1)1 ROUiBOLE
Par GILL (suite)
Quand je dis : Oh! là, là, oh ! là, là! ousqu'est mon fusil?
je n'entends pas insinuer que la belle ange employa cette locu-
tion, propriété exclusive de Léon Rossignol ; je veux dire : Mort
de ma vie! la belle ange était bien malheureuse ! ! !
Du reste, toutes les belles anges commencent par là — et par
un petit jeune homme pas riche.
— Mais n'anticipons point !
Le récit fut long et navrant, navrant ! I ! et long ! ! !...
Rocambole alla se coucher
— chez Vandal — encore une
belle ange, la belle ange de
Rocambole, une Russe très-
réussie, un peu gaillarde et
un peu t'orte ; vous m'enten-
dez : Rocambole en avait
pour son argent !
Mais cë n'est pas tout ça ! Ce qui m'inquiète, c'est le monsieur
au gros chien.
Il était resté dans la boutique. La boutique de Calerait (Cal-
craft ! — si ce n'est pas le bourreau; c'est donc son frère, il faut
bien ça I )
Il était donc resté dans la boutique de Malandrin ! Le sacri-
pant! l'animal ! double farceur, va! voyez-vous ça !
Mais chut ! silence !. motus ! n'ayez crainte ! — Cocorico le sur-
veillait !
Ah ! mais... ah ! mais oui — Coricoco, le bon Coricoco, lo bras
droit de Rocambole! l'aimable, l'admirable, le joli Coricoco!
mon petit Coricoco ! Dans mes bras, Coricoco !...
Voilà qu'il entre un Thug
Il s'assied devant le monsieur
au gros chien (aïe ! aïe ! aïe ! —
aïe ! aïe ! aïe ! ), et l'appelle :
Lumière de l'Orient. (Quelle ca-
naille !)
Mais Calcraft, feignant, pas si feignant que ça ! — je veux
dire feignant do feindre —
c'est-à-dire feignant de lire la
Lune afin de mieux dissimuler,
surprend, traduit et divufjrnc
à Coricoco leurs noirs com-
plots.
Allons, allons! ce Calcraft
est un brave homme l •
Quant au monsieur au gros chien,
Ce n'est pas Cochinat...
C'est le chef des Thugs!
C'est donc Feringhea ?
Ce n'est pas Feringhea !
Feringhea a parlé autre part.
Feringhea n'est qu'une con-
currence; qu'on ne parle pas
de Feringhea au vicomte !
Tète et sang! Mort do ma vie!
Enfer et damnation ! parlons
d'autre chose!
Parlons de l'oiseau bleu.
Avis. — L'oiseau bleu est un
oiseau bleu qu'on se place sur
l'estomac pour gêner les Thuga
qu'on peut rencontrer.
C'est en se le peignant qu'on
se le place. Rocambole s'en fit
peindre un par un Thug qu'il
avait chez lui.— Bravo! va bien!
Rocambole n'avait plus rien à dé-
sirer; il avait tout ce qu'il lui
fallait.
Mais ce Thug, hélas! ce Thug qui peignait des oiseaux bleus...
Hélas! hélas! hélas!
Werk/Gegenstand/Objekt
Titel
Titel/Objekt
La dernière mort de Rocambole par Gill
Weitere Titel/Paralleltitel
Serientitel
La Lune
Sachbegriff/Objekttyp
Inschrift/Wasserzeichen
Aufbewahrung/Standort
Aufbewahrungsort/Standort (GND)
Inv. Nr./Signatur
S 25/T 14
Objektbeschreibung
Maß-/Formatangaben
Auflage/Druckzustand
Werktitel/Werkverzeichnis
Herstellung/Entstehung
Künstler/Urheber/Hersteller (GND)
Entstehungsdatum
um 1866
Entstehungsdatum (normiert)
1861 - 1871
Entstehungsort (GND)
Auftrag
Publikation
Fund/Ausgrabung
Provenienz
Restaurierung
Sammlung Eingang
Ausstellung
Bearbeitung/Umgestaltung
Thema/Bildinhalt
Thema/Bildinhalt (GND)
Literaturangabe
Rechte am Objekt
Aufnahmen/Reproduktionen
Künstler/Urheber (GND)
Reproduktionstyp
Digitales Bild
Rechtsstatus
Public Domain Mark 1.0
Creditline
La Lune, 2.1866, Nr. 32, S. 32_2
Beziehungen
Erschließung
Lizenz
CC0 1.0 Public Domain Dedication
Rechteinhaber
Universitätsbibliothek Heidelberg