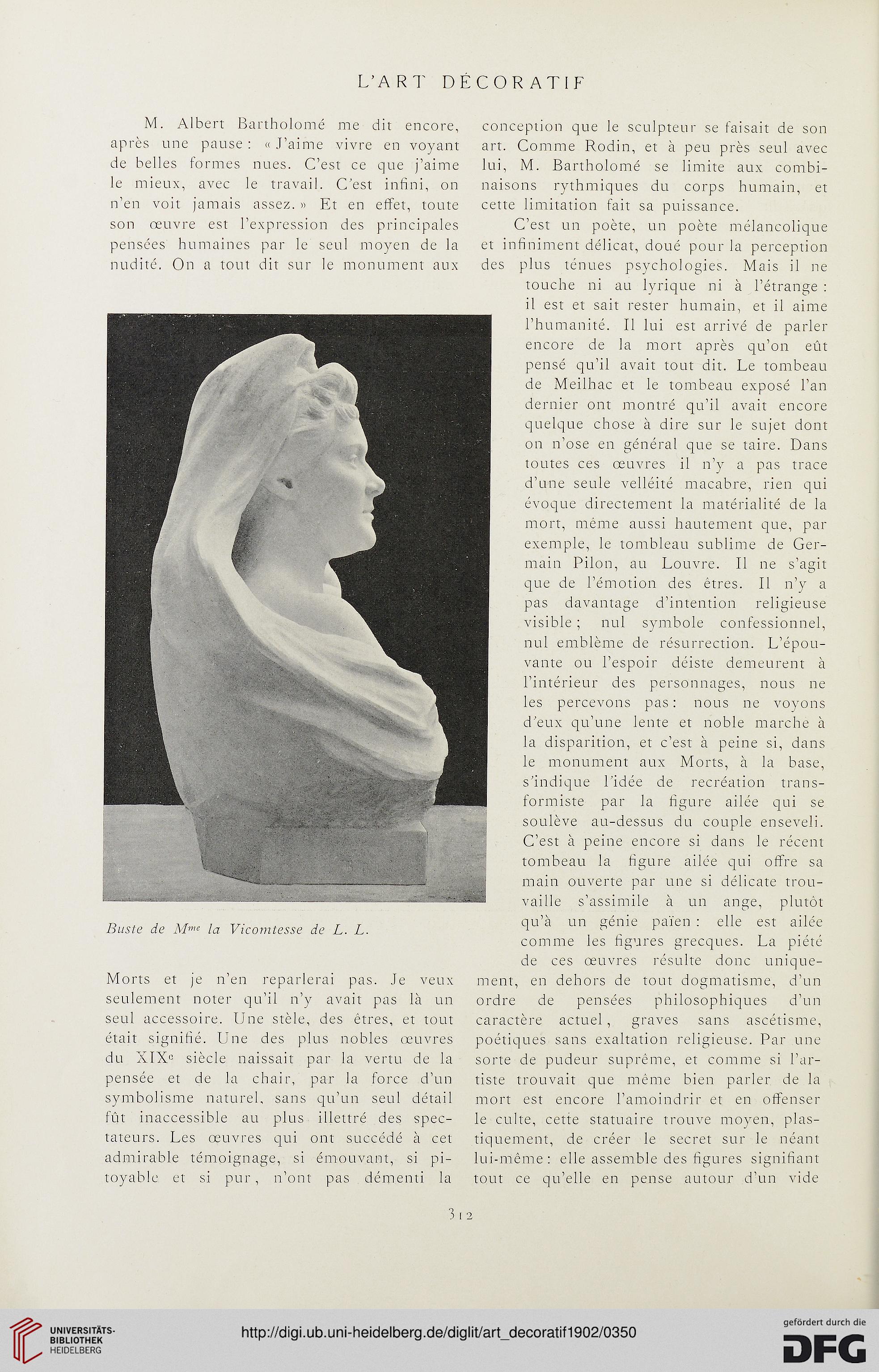L'ART DECORAT! F
M. Albert Bartbolomé me dit encore,
après une pause : « J'aime vivre en voyant
de belles formes nues. C'est ce que j'aime
le mieux, avec le travail. C'est infini, on
n'en voit jamais assez. H Et en effet, toute
son œuvre est l'expression des principales
pensées humaines par le seul moyen de la
nudité. On a tout dit sur le monument aux
Morts et je n'en reparlerai pas. Je veux
seulement noter qu'il n'y avait pas là un
seul accessoire. JJne stèle, des êtres, et tout
était signifié. Une des plus nobles œuvres
du XIX" siècle naissait par la vertu de la
pensée et de la chair, par la force d'un
symbolisme naturel, sans qu'un seul détail
fût inaccessible au plus illettré des spec-
tateurs. Les œuvres qui ont succédé à cet
admirable témoignage, si émouvant, si pi-
toyable et si pur, n'ont pas démenti la
conception que le sculpteur se faisait de son
art. Comme Rodin, et à peu près seul avec
lui, M. Bartholomé se limite aux combi-
naisons rythmiques du corps humain, et
cette limitation fait sa puissance.
C'est un poète, un poète mélancolique
et infiniment délicat, doué pour la perception
des plus ténues psychologies. Mais il ne
touche ni au lyrique ni à l'étrange :
il est et sait rester humain, et il aime
l'humanité. Hlm est arrivé de parler
encore de la mort après qu'on eût
pensé qu'il avait tout dit. Le tombeau
de Meilhac et le tombeau exposé l'an
dernier ont montré qu'il avait encore
quelque chose à dire sur le sujet dont
on n'ose en général que se taire. Dans
toutes ces œuvres il n'y a pas trace
d'une seule velléité macabre, rien qui
évoque directement la matérialité de la
mort, même aussi hautement que, par
exemple, le tombleau sublime de Ger-
main Pilon, au Louvre. Il ne s'agit
que de l'émotion des êtres. Il n'y a
pas davantage d'intention religieuse
visible ; nul symbole confessionnel,
nul emblème de résurrection. L'épou-
vante ou l'espoir déiste demeurent à
l'intérieur des personnages, nous ne
les percevons pas : nous ne voyons
d'eux qu'une lente et noble marche à
la disparition, et c'est à peine si, dans
le monument aux Morts, à la base,
s'indique l'idée de recréation trans-
formiste par U figure ailée qui se
soulève au-dessus du couple enseveli.
C'est à peine encore si dans le récent
tombeau la figure ailée qui offre sa
main ouverte par une si délicate trou-
vaille s'assimile à un ange, plutôt
qu'à un génie païen : elle est ailée
comme les figures grecques. La piété
de ces œuvres résulte donc unique-
ment, en dehors de tout dogmatisme, d'un
ordre de pensées philosophiques d'un
caractère actuel , graves sans ascétisme,
poétiques sans exaltation religieuse. Par une
sorte de pudeur suprême, et comme si l'ar-
tiste trouvait que même bien parler delà
mort est encore l'amoindrir et en offenser
le culte, cette statuaire trouve moyen, plas-
tiquement, de créer le secret sur le néant
lui-même: elle assemble des figures signifiant
tout ce qu'elle en pense autour d'un vide
ZLx/e (f<? G UfcoyHte&ye A? L. L.
3.2
M. Albert Bartbolomé me dit encore,
après une pause : « J'aime vivre en voyant
de belles formes nues. C'est ce que j'aime
le mieux, avec le travail. C'est infini, on
n'en voit jamais assez. H Et en effet, toute
son œuvre est l'expression des principales
pensées humaines par le seul moyen de la
nudité. On a tout dit sur le monument aux
Morts et je n'en reparlerai pas. Je veux
seulement noter qu'il n'y avait pas là un
seul accessoire. JJne stèle, des êtres, et tout
était signifié. Une des plus nobles œuvres
du XIX" siècle naissait par la vertu de la
pensée et de la chair, par la force d'un
symbolisme naturel, sans qu'un seul détail
fût inaccessible au plus illettré des spec-
tateurs. Les œuvres qui ont succédé à cet
admirable témoignage, si émouvant, si pi-
toyable et si pur, n'ont pas démenti la
conception que le sculpteur se faisait de son
art. Comme Rodin, et à peu près seul avec
lui, M. Bartholomé se limite aux combi-
naisons rythmiques du corps humain, et
cette limitation fait sa puissance.
C'est un poète, un poète mélancolique
et infiniment délicat, doué pour la perception
des plus ténues psychologies. Mais il ne
touche ni au lyrique ni à l'étrange :
il est et sait rester humain, et il aime
l'humanité. Hlm est arrivé de parler
encore de la mort après qu'on eût
pensé qu'il avait tout dit. Le tombeau
de Meilhac et le tombeau exposé l'an
dernier ont montré qu'il avait encore
quelque chose à dire sur le sujet dont
on n'ose en général que se taire. Dans
toutes ces œuvres il n'y a pas trace
d'une seule velléité macabre, rien qui
évoque directement la matérialité de la
mort, même aussi hautement que, par
exemple, le tombleau sublime de Ger-
main Pilon, au Louvre. Il ne s'agit
que de l'émotion des êtres. Il n'y a
pas davantage d'intention religieuse
visible ; nul symbole confessionnel,
nul emblème de résurrection. L'épou-
vante ou l'espoir déiste demeurent à
l'intérieur des personnages, nous ne
les percevons pas : nous ne voyons
d'eux qu'une lente et noble marche à
la disparition, et c'est à peine si, dans
le monument aux Morts, à la base,
s'indique l'idée de recréation trans-
formiste par U figure ailée qui se
soulève au-dessus du couple enseveli.
C'est à peine encore si dans le récent
tombeau la figure ailée qui offre sa
main ouverte par une si délicate trou-
vaille s'assimile à un ange, plutôt
qu'à un génie païen : elle est ailée
comme les figures grecques. La piété
de ces œuvres résulte donc unique-
ment, en dehors de tout dogmatisme, d'un
ordre de pensées philosophiques d'un
caractère actuel , graves sans ascétisme,
poétiques sans exaltation religieuse. Par une
sorte de pudeur suprême, et comme si l'ar-
tiste trouvait que même bien parler delà
mort est encore l'amoindrir et en offenser
le culte, cette statuaire trouve moyen, plas-
tiquement, de créer le secret sur le néant
lui-même: elle assemble des figures signifiant
tout ce qu'elle en pense autour d'un vide
ZLx/e (f<? G UfcoyHte&ye A? L. L.
3.2