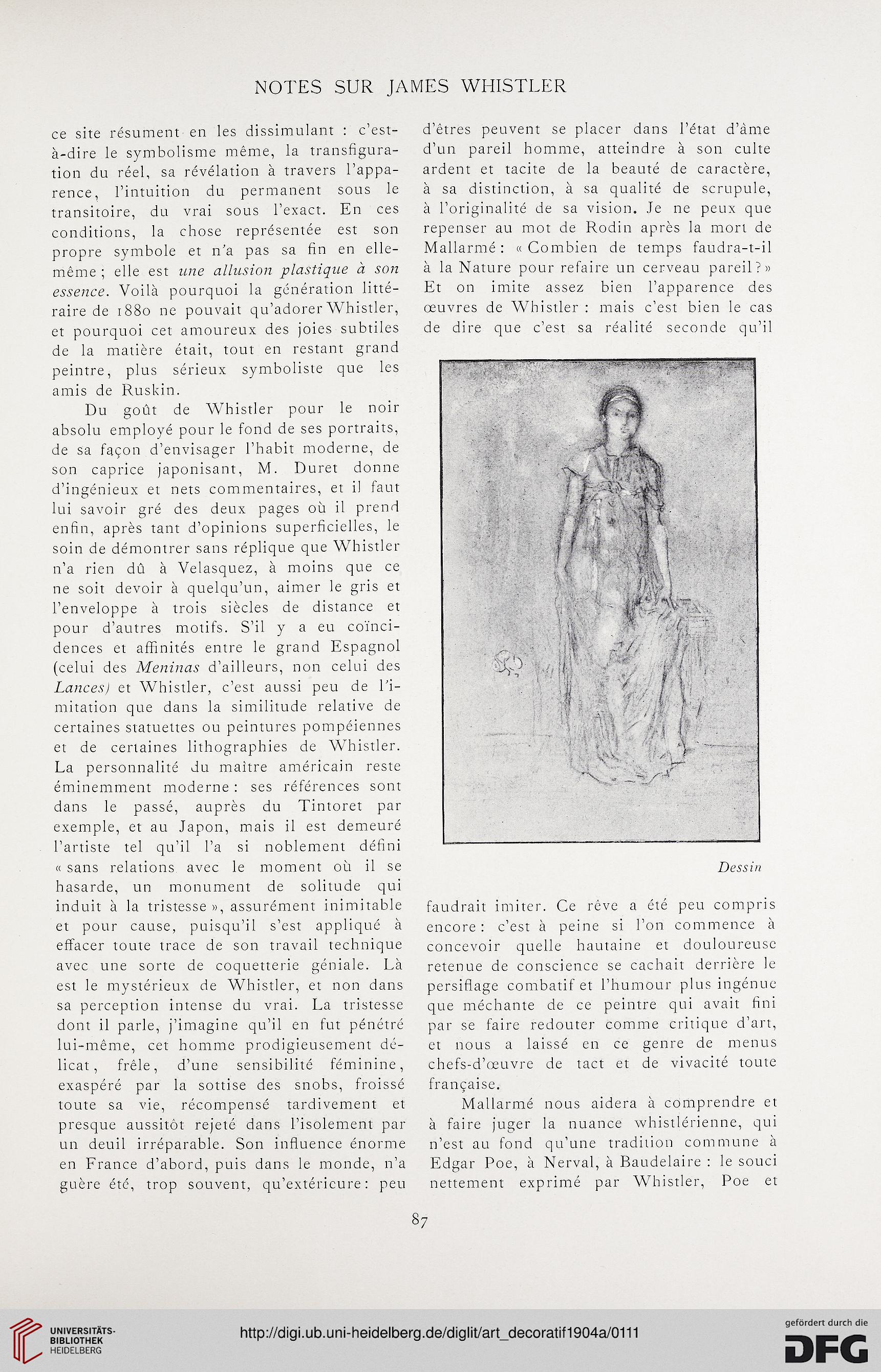NOTES SUR JAMES WHISTLER
ce site résument en les dissimulant : c'est-
à-dire le symbolisme même, la transfigura-
tion du réel, sa révélation à travers l'appa-
rence, l'intuition du permanent sous le
transitoire, du vrai sous l'exact. En ces
conditions, la chose représentée est son
propre symbole et n'a pas sa hn en elle-
même ; elle est zz;z<? u//zzxzozz p/uxP'^zzc ù xozz
cx^czzce. Voilà pourquoi la génération litté-
raire de 1880 ne pouvait qu'adorerWhistler,
et pourquoi cet amoureux des joies subtiles
de la matière était, tout en restant grand
peintre, plus sérieux symboliste que les
amis de Ruskin.
Du goût de Whistler pour le noir
absolu employé pour le fond de ses portraits,
de sa façon d'envisager l'habit moderne, de
son caprice japonisant, M. Duret donne
d'ingénieux et nets commentaires, et il faut
lui savoir gré des deux pages où il prend
enfin, après tant d'opinions superficielles, le
soin de démontrer sans réplique que Whistler
n'a rien dû à Velasquez, à moins que ce
ne soit devoir à quelqu'un, aimer le gris et
l'enveloppe à trois siècles de distance et
pour d'autres motifs. S'il y a eu coïnci-
dences et affinités entre le grand Espagnol
(celui des Afezzzzzux d'ailleurs, non celui des
EuzzceV et Whistler, c'est aussi peu de l'i-
mitation que dans la similitude relative de
certaines statuettes ou peintures pompéiennes
et de certaines lithographies de Whistler.
La personnalité du maître américain reste
éminemment moderne : ses références sont
dans le passé, auprès du Tint or et par
exemple, et au Japon, mais il est demeuré
l'artiste tel qu'il l'a si noblement déh ni
« sans relations avec le moment où il se
hasarde, un monument de solitude qui
induit à la tristesse )>, assurément inimitable
et pour cause, puisqu'il s'est appliqué à
effacer toute trace de son travail technique
avec une sorte de coquetterie géniale. Là
est le mystérieux de Whistler, et non dans
sa perception intense du vrai. La tristesse
dont il parle, j'imagine qu'il en fut pénétré
lui-même, cet homme prodigieusement dé-
licat, frêle, d'une sensibiiité féminine,
exaspéré par la sottise des snobs, froissé
toute sa vie, récompensé tardivement et
presque aussitôt rejeté dans l'isolement par
un deuil irréparable. Son influence énorme
en France d'abord, puis dans le monde, n'a
guère été, trop souvent, qu'extérieure: peu
d'êtres peuvent se placer dans l'état d'àme
d'un pareil homme, atteindre à son culte
ardent et tacite de la beauté de caractère,
à sa distinction, à sa qualité de scrupule,
à l'originalité de sa vision. Je ne peux que
repenser au mot de Rodin après la mort de
Mallarmé : « Combien de temps faudra-t-il
à la Nature pour refaire un cerveau pareil?))
Et on imite assez bien l'apparence des
oeuvres de Whistler : mais c'est bien le cas
de dire que c'est sa réalité seconde qu'il
faudrait imiter. Ce rêve a été peu compris
encore: c'est à peine si l'on commence à
concevoir quelle hautaine et douloureuse
retenue de conscience se cachait derrière le
persiflage combatif et l'humour plus ingénue
que méchante de ce peintre qui avait fini
par se faire redouter comme critique d'art,
et nous a laissé en ce genre de menus
chefs-d'œuvre de tact et de vivacité toute
française.
Mallarmé nous aidera à comprendre et
à faire juger la nuance whistlérienne, qui
n'est au fond qu'une tradition commune à
Edgar Poe, à Nerval, à Baudelaire : le souci
nettement exprimé par Whistler, Poe et
87
ce site résument en les dissimulant : c'est-
à-dire le symbolisme même, la transfigura-
tion du réel, sa révélation à travers l'appa-
rence, l'intuition du permanent sous le
transitoire, du vrai sous l'exact. En ces
conditions, la chose représentée est son
propre symbole et n'a pas sa hn en elle-
même ; elle est zz;z<? u//zzxzozz p/uxP'^zzc ù xozz
cx^czzce. Voilà pourquoi la génération litté-
raire de 1880 ne pouvait qu'adorerWhistler,
et pourquoi cet amoureux des joies subtiles
de la matière était, tout en restant grand
peintre, plus sérieux symboliste que les
amis de Ruskin.
Du goût de Whistler pour le noir
absolu employé pour le fond de ses portraits,
de sa façon d'envisager l'habit moderne, de
son caprice japonisant, M. Duret donne
d'ingénieux et nets commentaires, et il faut
lui savoir gré des deux pages où il prend
enfin, après tant d'opinions superficielles, le
soin de démontrer sans réplique que Whistler
n'a rien dû à Velasquez, à moins que ce
ne soit devoir à quelqu'un, aimer le gris et
l'enveloppe à trois siècles de distance et
pour d'autres motifs. S'il y a eu coïnci-
dences et affinités entre le grand Espagnol
(celui des Afezzzzzux d'ailleurs, non celui des
EuzzceV et Whistler, c'est aussi peu de l'i-
mitation que dans la similitude relative de
certaines statuettes ou peintures pompéiennes
et de certaines lithographies de Whistler.
La personnalité du maître américain reste
éminemment moderne : ses références sont
dans le passé, auprès du Tint or et par
exemple, et au Japon, mais il est demeuré
l'artiste tel qu'il l'a si noblement déh ni
« sans relations avec le moment où il se
hasarde, un monument de solitude qui
induit à la tristesse )>, assurément inimitable
et pour cause, puisqu'il s'est appliqué à
effacer toute trace de son travail technique
avec une sorte de coquetterie géniale. Là
est le mystérieux de Whistler, et non dans
sa perception intense du vrai. La tristesse
dont il parle, j'imagine qu'il en fut pénétré
lui-même, cet homme prodigieusement dé-
licat, frêle, d'une sensibiiité féminine,
exaspéré par la sottise des snobs, froissé
toute sa vie, récompensé tardivement et
presque aussitôt rejeté dans l'isolement par
un deuil irréparable. Son influence énorme
en France d'abord, puis dans le monde, n'a
guère été, trop souvent, qu'extérieure: peu
d'êtres peuvent se placer dans l'état d'àme
d'un pareil homme, atteindre à son culte
ardent et tacite de la beauté de caractère,
à sa distinction, à sa qualité de scrupule,
à l'originalité de sa vision. Je ne peux que
repenser au mot de Rodin après la mort de
Mallarmé : « Combien de temps faudra-t-il
à la Nature pour refaire un cerveau pareil?))
Et on imite assez bien l'apparence des
oeuvres de Whistler : mais c'est bien le cas
de dire que c'est sa réalité seconde qu'il
faudrait imiter. Ce rêve a été peu compris
encore: c'est à peine si l'on commence à
concevoir quelle hautaine et douloureuse
retenue de conscience se cachait derrière le
persiflage combatif et l'humour plus ingénue
que méchante de ce peintre qui avait fini
par se faire redouter comme critique d'art,
et nous a laissé en ce genre de menus
chefs-d'œuvre de tact et de vivacité toute
française.
Mallarmé nous aidera à comprendre et
à faire juger la nuance whistlérienne, qui
n'est au fond qu'une tradition commune à
Edgar Poe, à Nerval, à Baudelaire : le souci
nettement exprimé par Whistler, Poe et
87