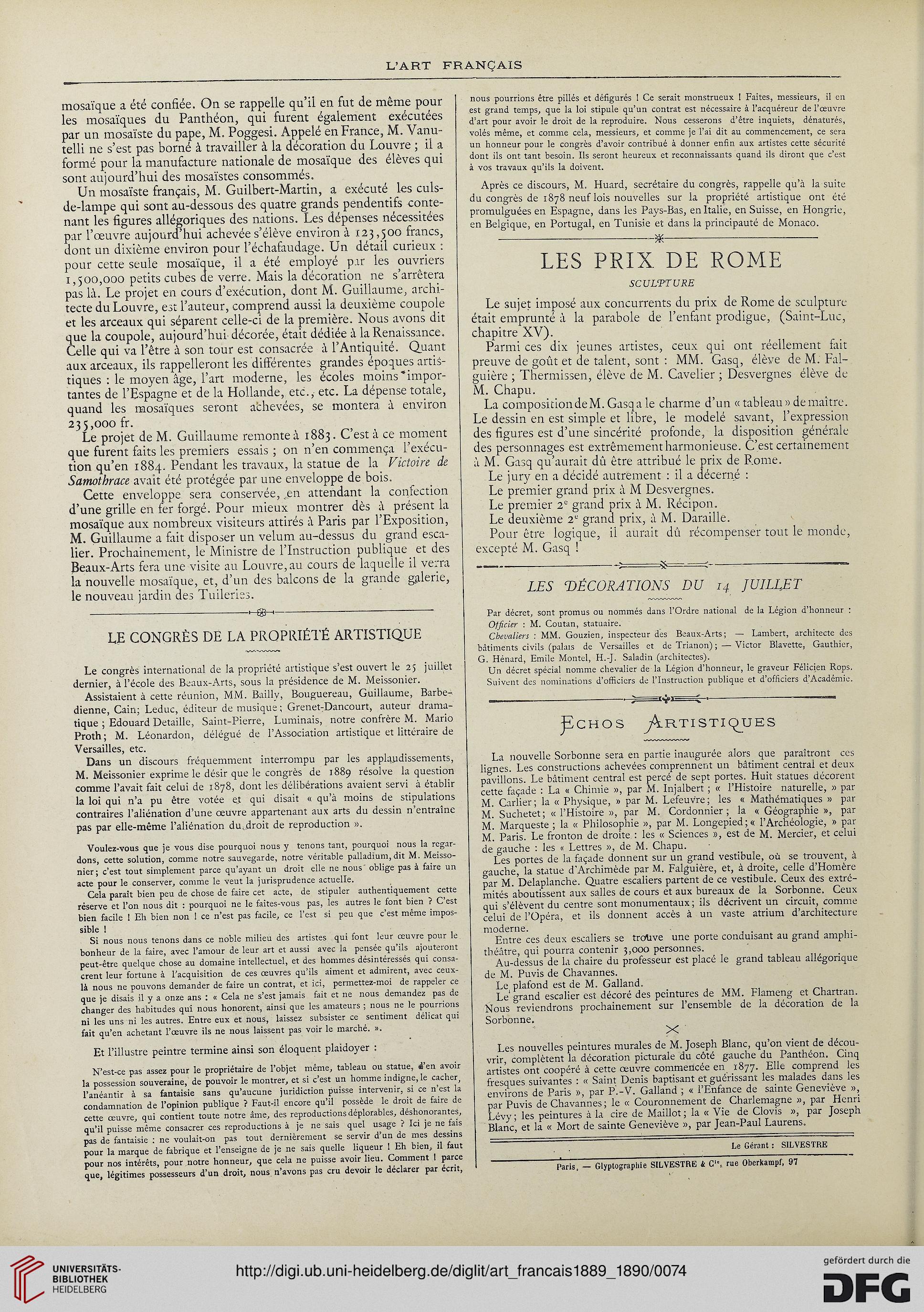L’ART FRANÇAIS
mosaïque a été confiée. On se rappelle qu’il en fut de même pour
les mosaïques du Panthéon, qui furent également exécutées
par un mosaïste du pape, M. Poggesi. Appelé en France, M. Vanu-
telli ne s’est pas borné à travailler à la décoration du Louvre ; il a
formé pour la manufacture nationale de mosaïque des élèves qui
sont aujourd’hui des mosaïstes consommés.
Un mosaïste français, M. Guilbert-Martin, a exécuté les culs-
de-lampe qui sont au-dessous des quatre grands pendentifs conte-
nant les figures allégoriques des nations. Les dépenses nécessitées
par l’œuvre aujourd’hui achevée s’élève environ à 123,500 francs,
dont un dixième environ pour l’échafaudage. Un détail curieux :
pour cette seule mosaïque, il a été employé par les ouvriers
1.500.000 petits cubes de verre. xMais la décoration ne s’arrêtera
pas là. Le projet en cours d’exécution, dont M. Guillaume, archi-
tecte du Louvre, est l’auteur, comprend aussi la deuxième coupole
et les arceaux qui séparent celle-ci de la première. Nous avons dit
que la coupole, aujourd’hui décorée, était dédiée à la Renaissance.
Celle qui va l’être à son tour est consacrée à l’Antiquité. Quant
aux arceaux, ils rappelleront les différentes grandes époques artis-
tiques : le moyen âge, l’art moderne, les écoles moins “impor-
tantes de l’Espagne et de la Hollande, etc., etc. La dépense totale,
quand les mosaïques seront achevées, se montera à environ
235.000 fr.
Le projet de M. Guillaume remonte à 1883. C’est à ce moment
que furent faits les premiers essais ; on n’en commença l’exécu-
tion qu’en 1884. Pendant les travaux, la statue de la Victoire de
Samothrace avait été protégée par une enveloppe de bois.
Cette enveloppe sera conservée, cen attendant la confection
d’une grille en fer forgé. Pour mieux montrer dès à présent la
mosaïque aux nombreux visiteurs attirés à Paris par l’Exposition,
M. Guillaume a fait disposer un vélum au-dessus du grand esca-
lier. Prochainement, le Ministre de l’Instruction publique et des
Beaux-Arts fera une visite au Louvre, au cours de laquelle il verra
la nouvelle mosaïque, et, d’un des balcons de la grande galerie,
le nouveau jardin des Tuileries.
--
LE CONGRÈS DE LA PROPRIÉTÉ ARTISTIQUE
Le congrès international de la propriété artistique s’est ouvert le 25 juillet
dernier, à l’école des Beaux-Arts, sous la présidence de M. Meissonier.
Assistaient à cette réunion, MM. Bailly, Bouguereau, Guillaume, Barbe-
dienne, Cain; Leduc, éditeur de musique; Grenet-Dancourt, auteur drama-
tique ; Edouard Détaillé, Saint-Pierre, Luminais, notre confrère M. Mario
Proth; M. Léonardon, délégué de l’Association artistique et littéraire de
Versailles, etc.
Dans un discours fréquemment interrompu par les applaudissements,
M. Meissonier exprime le désir que le congrès de 1889 résolve la question
comme l’avait fait celui de 1878, dont les délibérations avaient servi à établir
la loi qui n’a pu être votée ej qui disait « qu’à moins de stipulations
contraires l’aliénation d’une œuvre appartenant aux arts du dessin n’entraîne
pas par elle-même l’aliénation du,droit de reproduction ».
Voulez-vous que je vous dise pourquoi nous y tenons tant, pourquoi nous la regar-
dons, cette solution, comme notre sauvegarde, notre véritable palladium,dit M. Meisso-
nier; c’est tout simplement parce qu’ayant un droit elle ne nous' oblige pas à faire un
acte pour le conserver, comme le veut la jurisprudence actuelle.
Cela paraît bien peu de chose de faire cet acte, de stipuler authentiquement cette
réserve et l’on nous dit : pourquoi ne le faites-vous pas, les autres le font bien ? C’est
bien facile ! Eh bien non ! ce n’est pas facile, ce l’est si peu que c’est même impos-
sible !
Si nous nous tenons dans ce noble milieu des artistes qui font leur œuvre pour le
bonheur de la faire, avec l’amour de leur art et aussi avec la pensée qu’ils ajouteront
peut-être quelque chose au domaine intellectuel, et des hommes désintéressés qui consa-
crent leur fortune à l’acquisition de ces œuvres qu’ils aiment et admirent, avec ceux-
là nous ne pouvons demander de faire un contrat, et ici, permettez-moi de rappeler ce
que je disais il y a onze ans : « Cela ne s’est jamais fait et ne nous demandez pas de
changer des habitudes qui nous honorent, ainsi que les amateurs ; nous ne le pourrions
ni les uns ni les autres. Entre eux et nous, laissez subsister ce sentiment délicat qui
fait qu’en achetant l’œuvre ils ne nous laissent pas voir le marché. ».
Et l’illustre peintre termine ainsi son éloquent plaidoyer :
N’est-ce pas assez pour le propriétaire de l’objet même, tableau ou statue, d’en avoir
la possession souveraine, de pouvoir le montrer, et si c’est un homme indigne, le cacher,
l’anéantir à sa fantaisie sans qu’aucune juridiction puisse intervenir, si ce n’est la
condamnation de l’opinion publique ? Faut-il encore qu’il possède le droit de faire de
cette œuvre, qui contient toute notre âme, des reproductions déplorables, déshonorantes,
qu’il puisse même consacrer ces reproductions à je ne sais quel usage ? Ici je ne fais
pas de fantaisie : ne voulait-on pas tout dernièrement se servir d’un de mes dessins
pour la marque de fabrique et l’enseigne de je ne sais quelle liqueur 1 Eh bien, il faut
pour nos intérêts, pour notre honneur, que cela ne puisse avoir lieu. Comment 1 parce
que, légitimes possesseurs d’un droit, nous n’avons pas cru devoir le déclarer par écrit,
nous pourrions être pillés et défigurés ! Ce serait monstrueux ! Faites, messieurs, il en
est grand temps, que la loi stipule qu’un contrat est nécessaire à l’acquéreur de l’œuvre
d'art pour avoir le droit de la reproduire. Nous cesserons d’être inquiets, dénaturés,
volés même, et comme cela, messieurs, et comme je l’ai dit au commencement, ce sera
un honneur pour le congrès d’avoir contribué à donner enfin aux artistes cette sécurité
dont ils ont tant besoin. Ils seront heureux et reconnaissants quand ils diront que c’est
à vos travaux qu’ils la doivent.
Après ce discours, M. Huard, secrétaire du congrès, rappelle qu’à la suite
du congrès de 1878 neuf lois nouvelles sur la propriété artistique ont été
promulguées en Espagne, dans les Pays-Bas, en Italie, en Suisse, en Hongrie,
en Belgique, en Portugal, en Tunisie et dans la principauté de Monaco.
-^-.
LES PRIX DE ROME
SCUUPTURE
Le sujet imposé aux concurrents du prix de Rome de sculpture
était emprunté à la parabole de l’enfant nrodigue, (Saint-Luc,
chapitre XV).
Parmi ces dix jeunes artistes, ceux qui ont réellement fait
preuve de goût et de talent, sont : MM. Gasq, élève de M. Fal-
guière ; Thermissen, élève de M. Cavelier ; Desvergnes élève de
M. Chapu.
La compositiondeM. Gasq a le charme d’un « tableau » de maître.
Le dessin en est simple et libre, le modelé savant, l’expression
des figures est d’une sincérité profonde, la disposition générale
des personnages est extrêmement harmonieuse. C’est certainement
à M. Gasq qu’aurait dû être attribué le prix de Rome.
Le jury en a décidé autrement : il a décerné :
Le premier grand prix à M Desvergnes.
Le premier 2e grand prix à M. Récipon.
Le deuxième 2e grand prix, à M. Daraille.
Pour être logique, ii aurait dû récompenser tout le monde,
excepté M. Gasq !
LES DÉCORATIONS DU 14 JUILLET
Par décret, sont promus ou nommés dans l’Ordre national de la Légion d’honneur :
Officier : M. Coutan, statuaire.
Chevaliers : MM. Gouzien, inspecteur des Beaux-Arts; — Lambert, architecte des
bâtiments civils (palais de Versailles et de Trianon) ; — Victor Blavette, Gauthier,
G. Hénard, Emile Montel, H.-J. Saladin (architectes).
Un décret spécial nomme chevalier de la Légion d’honneur, le graveur Félicien Rops.
Suivent des nominations d’officiers de l’Instruction publique et d’officiers d’Académie.
-----■——
^chos ^Artistiques
La nouvelle Sorbonne sera en partie inaugurée alors que paraîtront ces
lignes. Les constructions achevées comprennent un bâtiment central et deux
pavillons. Le bâtiment central est percé de sept portes. Huit statues décorent
cette façade : La « Chimie », par M. Injalbert ; « l’Histoire naturelle, » par
M. Carlier; la « Physique, » par M. Lefeuvre; les « Mathématiques » par
M. Suchetet; « l’Histoire », par M. Cordonnier; la « Géographie », par
M. Marqueste ; la « Philosophie », par M. Longepied ; « l’Archéologie, » par
M. Paris. Le fronton de droite : les « Sciences », est de M. Mercier, et celui
de gauche : les « Lettres », de M. Chapu.
Les portes de la façade donnent sur un grand vestibule, où se trouvent, à
gauche, la statue d’Archimède par M. Falguière, et, à droite, celle d’Homère
par M. Delaplanche. Quatre escaliers partent de ce vestibule. Ceux des extré-
mités aboutissent aux salles de cours et aux bureaux de la Sorbonne. Ceux
qui s’élèvent du centre sont monumentaux ; ils décrivent un circuit, comme
celui de l’Opéra, et ils donnent accès à un vaste atrium d’architecture
moderne.
Entre ces deux escaliers se trcrtive une porte conduisant au grand amphi-
théâtre, qui pourra contenir 3,000 personnes.
Au-dessus de la chaire du professeur est placé le grand tableau allégorique
de M. Puvis de Chavannes.
Le plafond est de M. Galland.
Le* grand escalier est décoré des peintures de MM. Flameng et Chartran.
Nous reviendrons prochainement sur l’ensemble de la décoration de la
Sorbonne.
X
Les nouvelles peintures murales de M. Joseph Blanc, qu’on vient de décou-
vrir, complètent la décoration picturale du côté gauche du Panthéon. Cinq
artistes ont coopéré à cette œuvre commencée en 1877. Elle comprend les
fresques suivantes : « Saint Denis baptisant et guérissant les malades dans les
environs de Paris », par P.-V. Galland ; « l’Enfance de sainte Geneviève »,
par Puvis de Chavannes; le « Couronnement de Charlemagne », par Henri
Lévy ; les peintures à la cire de Maillot ; la « Vie de Clovis », par Joseph
Blanc, et la « Mort de sainte Geneviève », par Jean-Paul Laurens.
Le Gérant : S1LVESTRE
Paris. — Glyptographie SILVESTRE & C“t rue Obcrkampf, 97
mosaïque a été confiée. On se rappelle qu’il en fut de même pour
les mosaïques du Panthéon, qui furent également exécutées
par un mosaïste du pape, M. Poggesi. Appelé en France, M. Vanu-
telli ne s’est pas borné à travailler à la décoration du Louvre ; il a
formé pour la manufacture nationale de mosaïque des élèves qui
sont aujourd’hui des mosaïstes consommés.
Un mosaïste français, M. Guilbert-Martin, a exécuté les culs-
de-lampe qui sont au-dessous des quatre grands pendentifs conte-
nant les figures allégoriques des nations. Les dépenses nécessitées
par l’œuvre aujourd’hui achevée s’élève environ à 123,500 francs,
dont un dixième environ pour l’échafaudage. Un détail curieux :
pour cette seule mosaïque, il a été employé par les ouvriers
1.500.000 petits cubes de verre. xMais la décoration ne s’arrêtera
pas là. Le projet en cours d’exécution, dont M. Guillaume, archi-
tecte du Louvre, est l’auteur, comprend aussi la deuxième coupole
et les arceaux qui séparent celle-ci de la première. Nous avons dit
que la coupole, aujourd’hui décorée, était dédiée à la Renaissance.
Celle qui va l’être à son tour est consacrée à l’Antiquité. Quant
aux arceaux, ils rappelleront les différentes grandes époques artis-
tiques : le moyen âge, l’art moderne, les écoles moins “impor-
tantes de l’Espagne et de la Hollande, etc., etc. La dépense totale,
quand les mosaïques seront achevées, se montera à environ
235.000 fr.
Le projet de M. Guillaume remonte à 1883. C’est à ce moment
que furent faits les premiers essais ; on n’en commença l’exécu-
tion qu’en 1884. Pendant les travaux, la statue de la Victoire de
Samothrace avait été protégée par une enveloppe de bois.
Cette enveloppe sera conservée, cen attendant la confection
d’une grille en fer forgé. Pour mieux montrer dès à présent la
mosaïque aux nombreux visiteurs attirés à Paris par l’Exposition,
M. Guillaume a fait disposer un vélum au-dessus du grand esca-
lier. Prochainement, le Ministre de l’Instruction publique et des
Beaux-Arts fera une visite au Louvre, au cours de laquelle il verra
la nouvelle mosaïque, et, d’un des balcons de la grande galerie,
le nouveau jardin des Tuileries.
--
LE CONGRÈS DE LA PROPRIÉTÉ ARTISTIQUE
Le congrès international de la propriété artistique s’est ouvert le 25 juillet
dernier, à l’école des Beaux-Arts, sous la présidence de M. Meissonier.
Assistaient à cette réunion, MM. Bailly, Bouguereau, Guillaume, Barbe-
dienne, Cain; Leduc, éditeur de musique; Grenet-Dancourt, auteur drama-
tique ; Edouard Détaillé, Saint-Pierre, Luminais, notre confrère M. Mario
Proth; M. Léonardon, délégué de l’Association artistique et littéraire de
Versailles, etc.
Dans un discours fréquemment interrompu par les applaudissements,
M. Meissonier exprime le désir que le congrès de 1889 résolve la question
comme l’avait fait celui de 1878, dont les délibérations avaient servi à établir
la loi qui n’a pu être votée ej qui disait « qu’à moins de stipulations
contraires l’aliénation d’une œuvre appartenant aux arts du dessin n’entraîne
pas par elle-même l’aliénation du,droit de reproduction ».
Voulez-vous que je vous dise pourquoi nous y tenons tant, pourquoi nous la regar-
dons, cette solution, comme notre sauvegarde, notre véritable palladium,dit M. Meisso-
nier; c’est tout simplement parce qu’ayant un droit elle ne nous' oblige pas à faire un
acte pour le conserver, comme le veut la jurisprudence actuelle.
Cela paraît bien peu de chose de faire cet acte, de stipuler authentiquement cette
réserve et l’on nous dit : pourquoi ne le faites-vous pas, les autres le font bien ? C’est
bien facile ! Eh bien non ! ce n’est pas facile, ce l’est si peu que c’est même impos-
sible !
Si nous nous tenons dans ce noble milieu des artistes qui font leur œuvre pour le
bonheur de la faire, avec l’amour de leur art et aussi avec la pensée qu’ils ajouteront
peut-être quelque chose au domaine intellectuel, et des hommes désintéressés qui consa-
crent leur fortune à l’acquisition de ces œuvres qu’ils aiment et admirent, avec ceux-
là nous ne pouvons demander de faire un contrat, et ici, permettez-moi de rappeler ce
que je disais il y a onze ans : « Cela ne s’est jamais fait et ne nous demandez pas de
changer des habitudes qui nous honorent, ainsi que les amateurs ; nous ne le pourrions
ni les uns ni les autres. Entre eux et nous, laissez subsister ce sentiment délicat qui
fait qu’en achetant l’œuvre ils ne nous laissent pas voir le marché. ».
Et l’illustre peintre termine ainsi son éloquent plaidoyer :
N’est-ce pas assez pour le propriétaire de l’objet même, tableau ou statue, d’en avoir
la possession souveraine, de pouvoir le montrer, et si c’est un homme indigne, le cacher,
l’anéantir à sa fantaisie sans qu’aucune juridiction puisse intervenir, si ce n’est la
condamnation de l’opinion publique ? Faut-il encore qu’il possède le droit de faire de
cette œuvre, qui contient toute notre âme, des reproductions déplorables, déshonorantes,
qu’il puisse même consacrer ces reproductions à je ne sais quel usage ? Ici je ne fais
pas de fantaisie : ne voulait-on pas tout dernièrement se servir d’un de mes dessins
pour la marque de fabrique et l’enseigne de je ne sais quelle liqueur 1 Eh bien, il faut
pour nos intérêts, pour notre honneur, que cela ne puisse avoir lieu. Comment 1 parce
que, légitimes possesseurs d’un droit, nous n’avons pas cru devoir le déclarer par écrit,
nous pourrions être pillés et défigurés ! Ce serait monstrueux ! Faites, messieurs, il en
est grand temps, que la loi stipule qu’un contrat est nécessaire à l’acquéreur de l’œuvre
d'art pour avoir le droit de la reproduire. Nous cesserons d’être inquiets, dénaturés,
volés même, et comme cela, messieurs, et comme je l’ai dit au commencement, ce sera
un honneur pour le congrès d’avoir contribué à donner enfin aux artistes cette sécurité
dont ils ont tant besoin. Ils seront heureux et reconnaissants quand ils diront que c’est
à vos travaux qu’ils la doivent.
Après ce discours, M. Huard, secrétaire du congrès, rappelle qu’à la suite
du congrès de 1878 neuf lois nouvelles sur la propriété artistique ont été
promulguées en Espagne, dans les Pays-Bas, en Italie, en Suisse, en Hongrie,
en Belgique, en Portugal, en Tunisie et dans la principauté de Monaco.
-^-.
LES PRIX DE ROME
SCUUPTURE
Le sujet imposé aux concurrents du prix de Rome de sculpture
était emprunté à la parabole de l’enfant nrodigue, (Saint-Luc,
chapitre XV).
Parmi ces dix jeunes artistes, ceux qui ont réellement fait
preuve de goût et de talent, sont : MM. Gasq, élève de M. Fal-
guière ; Thermissen, élève de M. Cavelier ; Desvergnes élève de
M. Chapu.
La compositiondeM. Gasq a le charme d’un « tableau » de maître.
Le dessin en est simple et libre, le modelé savant, l’expression
des figures est d’une sincérité profonde, la disposition générale
des personnages est extrêmement harmonieuse. C’est certainement
à M. Gasq qu’aurait dû être attribué le prix de Rome.
Le jury en a décidé autrement : il a décerné :
Le premier grand prix à M Desvergnes.
Le premier 2e grand prix à M. Récipon.
Le deuxième 2e grand prix, à M. Daraille.
Pour être logique, ii aurait dû récompenser tout le monde,
excepté M. Gasq !
LES DÉCORATIONS DU 14 JUILLET
Par décret, sont promus ou nommés dans l’Ordre national de la Légion d’honneur :
Officier : M. Coutan, statuaire.
Chevaliers : MM. Gouzien, inspecteur des Beaux-Arts; — Lambert, architecte des
bâtiments civils (palais de Versailles et de Trianon) ; — Victor Blavette, Gauthier,
G. Hénard, Emile Montel, H.-J. Saladin (architectes).
Un décret spécial nomme chevalier de la Légion d’honneur, le graveur Félicien Rops.
Suivent des nominations d’officiers de l’Instruction publique et d’officiers d’Académie.
-----■——
^chos ^Artistiques
La nouvelle Sorbonne sera en partie inaugurée alors que paraîtront ces
lignes. Les constructions achevées comprennent un bâtiment central et deux
pavillons. Le bâtiment central est percé de sept portes. Huit statues décorent
cette façade : La « Chimie », par M. Injalbert ; « l’Histoire naturelle, » par
M. Carlier; la « Physique, » par M. Lefeuvre; les « Mathématiques » par
M. Suchetet; « l’Histoire », par M. Cordonnier; la « Géographie », par
M. Marqueste ; la « Philosophie », par M. Longepied ; « l’Archéologie, » par
M. Paris. Le fronton de droite : les « Sciences », est de M. Mercier, et celui
de gauche : les « Lettres », de M. Chapu.
Les portes de la façade donnent sur un grand vestibule, où se trouvent, à
gauche, la statue d’Archimède par M. Falguière, et, à droite, celle d’Homère
par M. Delaplanche. Quatre escaliers partent de ce vestibule. Ceux des extré-
mités aboutissent aux salles de cours et aux bureaux de la Sorbonne. Ceux
qui s’élèvent du centre sont monumentaux ; ils décrivent un circuit, comme
celui de l’Opéra, et ils donnent accès à un vaste atrium d’architecture
moderne.
Entre ces deux escaliers se trcrtive une porte conduisant au grand amphi-
théâtre, qui pourra contenir 3,000 personnes.
Au-dessus de la chaire du professeur est placé le grand tableau allégorique
de M. Puvis de Chavannes.
Le plafond est de M. Galland.
Le* grand escalier est décoré des peintures de MM. Flameng et Chartran.
Nous reviendrons prochainement sur l’ensemble de la décoration de la
Sorbonne.
X
Les nouvelles peintures murales de M. Joseph Blanc, qu’on vient de décou-
vrir, complètent la décoration picturale du côté gauche du Panthéon. Cinq
artistes ont coopéré à cette œuvre commencée en 1877. Elle comprend les
fresques suivantes : « Saint Denis baptisant et guérissant les malades dans les
environs de Paris », par P.-V. Galland ; « l’Enfance de sainte Geneviève »,
par Puvis de Chavannes; le « Couronnement de Charlemagne », par Henri
Lévy ; les peintures à la cire de Maillot ; la « Vie de Clovis », par Joseph
Blanc, et la « Mort de sainte Geneviève », par Jean-Paul Laurens.
Le Gérant : S1LVESTRE
Paris. — Glyptographie SILVESTRE & C“t rue Obcrkampf, 97