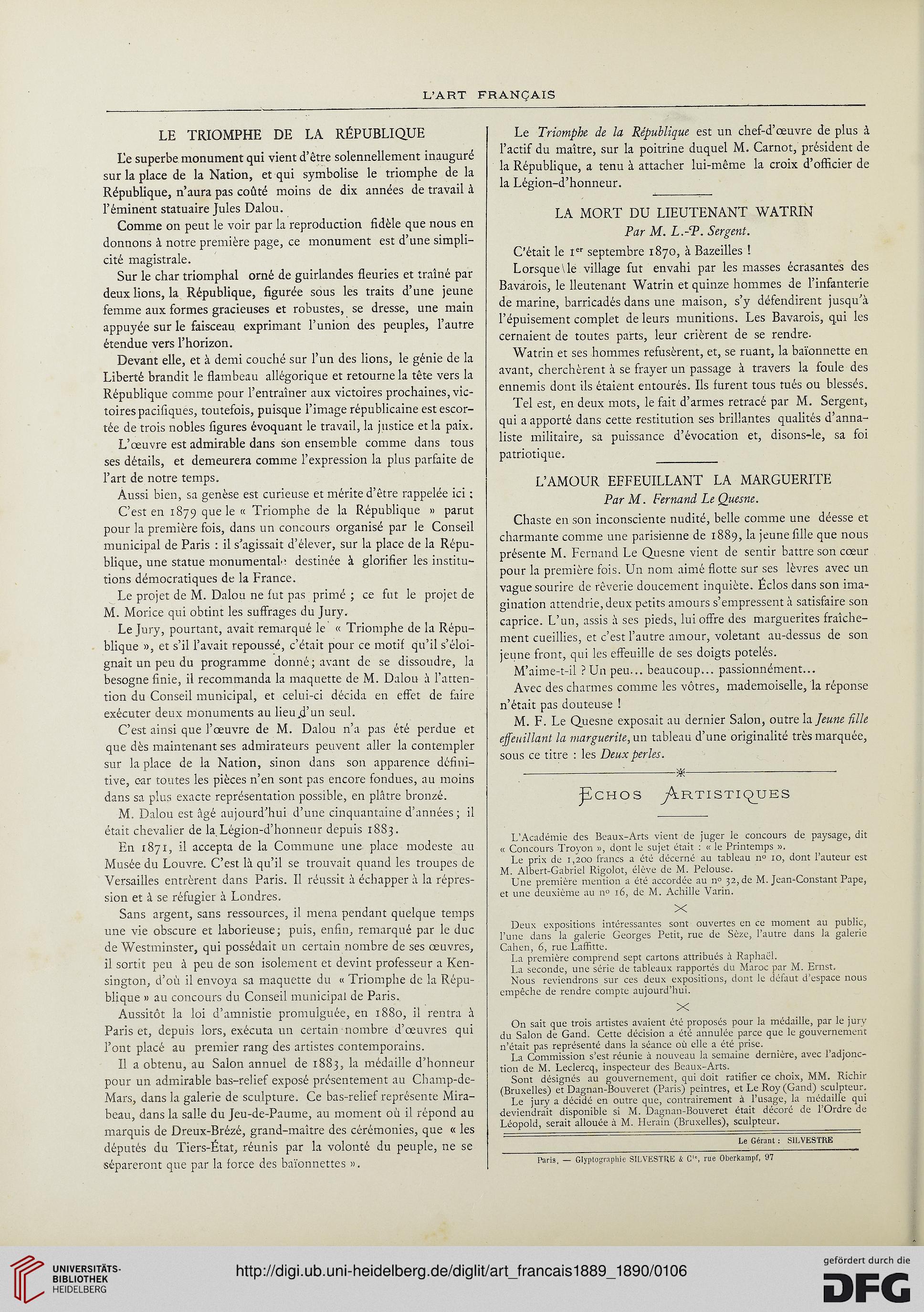L’ART FRANÇAIS
LE TRIOMPHE DE LA RÉPUBLIQUE
Le superbe monument qui vient d’être solennellement inauguré
sur la place de la Nation, et qui symbolise le triomphe de la
République, n’aura pas coûté moins de dix années de travail à
l’éminent statuaire Jules Dalou.
Comme on peut le voir par la reproduction fidèle que nous en
donnons à notre première page, ce monument est d’une simpli-
cité magistrale.
Sur le char triomphal orné de guirlandes fleuries et traîné par
deux lions, la République, figurée sous les traits d’une jeune
femme aux formes gracieuses et robustes, se dresse, une main
appuyée sur le faisceau exprimant l’union des peuples, l’autre
étendue vers l’horizon.
Devant elle, et à demi couché sur l’un des lions, le génie de la
Liberté brandit le flambeau allégorique et retourne la tête vers la
République comme pour l’entraîner aux victoires prochaines, vic-
toires pacifiques, toutefois, puisque l’image républicaine est escor-
tée de trois nobles figures évoquant le travail, la justice et la paix.
L’œuvre est admirable dans son ensemble comme dans tous
ses détails, et demeurera comme l’expression la plus parfaite de
l’art de notre temps.
Aussi bien, sa genèse est curieuse et mérite d’être rappelée ici :
C’est en 1879 que le « Triomphe de la République » parut
pour la première fois, dans un concours organisé par le Conseil
municipal de Paris : il s’agissait d’élever, sur la place de la Répu-
blique, une statue monumentale destinée à glorifier les institu-
tions démocratiques de la France.
Le projet de M. Dalou ne fut pas primé ; ce fut le projet de
M. Morice qui obtint les suffrages du Jury.
Le Jury, pourtant, avait remarqué le « Triomphe de la Répu-
blique », et s’il l’avait repoussé, c’était pour ce motif qu’il s’éloi-
gnait un peu du programme donné; avant de se dissoudre, la
besogne finie, il recommanda la maquette de M. Dalou à l’atten-
tion du Conseil municipal, et celui-ci décida en effet de faire
exécuter deux monuments au lieu .d’un seul.
C’est ainsi que l’œuvre de M. Dalou n’a pas été perdue et
que dès maintenant ses admirateurs peuvent aller la contempler
sur la place de la Nation, sinon dans son apparence defini-
tive, c-ar toutes les pièces n’en sont pas encore fondues, au moins
dans sa plus exacte représentation possible, en plâtre bronzé.
M. Dalou est âgé aujourd’hui d’une cinquantaine d’années ; il
était chevalier de la. Légion-d’honneur depuis 1883.
En 1871, il accepta de la Commune une place modeste au
Musée du Louvre. C’est là qu’il se trouvait quand les troupes de
Versailles entrèrent dans Paris. Il réussit à échapper à la répres-
sion et à se réfugier à Londres.
Sans argent, sans ressources, il mena pendant quelque temps
une vie obscure et laborieuse; puis, enfin, remarqué par le duc
de Westminster, qui possédait un certain nombre de ses œuvres,
il sortit peu à peu de son isolement et devint professeur a Ken-
sington, d’où il envoya sa maquette du « Triomphe de la Répu-
blique » au concours du Conseil municipal de Paris.
Aussitôt la loi d’amnistie promulguée, en 1880, il rentra à
Paris et, depuis lors, exécuta un certain nombre d’œuvres qui
l’ont placé au premier rang des artistes contemporains.
Il a obtenu, au Salon annuel de 1883, la médaille d’honneur
pour un admirable bas-relief exposé présentement au Champ-de-
Mars, dans la galerie de sculpture. Ce bas-relief représente Mira-
beau, dans la salle du Jeu-de-Paume, au moment où il répond au
marquis de Dreux-Brézé, grand-maître des cérémonies, que « les
députés du Tiers-État, réunis par la volonté du peuple, ne se
sépareront que par la force des baïonnettes ».
Le Triomphe de la République est un chef-d’œuvre de plus à
l’actif du maître, sur la poitrine duquel M. Carnot, président de
la République, a tenu à attacher lui-même la croix d’officier de
la Légion-d’honneur.
LA MORT DU LIEUTENANT WATRIN
Par M. L.-T. Sergent.
C'était le Ier septembre 1870, à Bazeilles !
Lorsque\le village fut envahi par les masses écrasantes des
Bavarois, le lieutenant Watrin et quinze hommes de l’infanterie
de marine, barricadés dans une maison, s’y défendirent jusqu’à
l’épuisement complet de leurs munitions. Les Bavarois, qui les
cernaient de toutes parts, leur crièrent de se rendre.
Watrin et ses hommes refusèrent, et, se ruant, la baïonnette en
avant, cherchèrent à se frayer un passage à travers la foule des
ennemis dont ils étaient entourés. Ils furent tous tués ou blessés.
Tel est, en deux mots, le fait d’armes retracé par M. Sergent,
qui a apporté dans cette restitution ses brillantes qualités d’anna-
liste militaire, sa puissance d’évocation et, disons-le, sa foi
patriotique.
L’AMOUR EFFEUILLANT LA MARGUERITE
Par M. Fernand Le Quesne.
Chaste en son inconsciente nudité, belle comme une déesse et
charmante comme une parisienne de 1889, la jeune fille que nous
présente M. Fernand Le Quesne vient de sentir battre son cœur
pour la première fois. Un nom aimé flotte sur ses lèvres avec un
vague sourire de rêverie doucement inquiète. Éclos dans son ima-
gination attendrie, deux petits amours s’empressent à satisfaire son
caprice. L’un, assis à ses pieds, lui offre des marguerites fraîche-
ment cueillies, et c’est l’autre amour, voletant au-dessus de son
jeune front, qui les effeuille de ses doigts potelés.
M’aime-t-il ? Un peu... beaucoup... passionnément...
Avec des charmes comme les vôtres, mademoiselle, la réponse
n’était pas douteuse !
M. F. Le Quesne exposait au dernier Salon, outre la Jeune fille
effeuillant la marguerite, un tableau d’une originalité très marquée,
sous ce titre : les Deux perles.
-:--■
^chos Artistiques
L’Académie des Beaux-Arts vient de juger le concours de paysage, dit
« Concours Troyon », dont le sujet était : « le Printemps ».
Le prix de 1,200 francs a été décerné au tableau n° 10, dont l’auteur est
M. Albert-Gabriel Rigolot, élève de M. Pelouse.
Une première mention a été accordée au n° 32, de M. JeamConstant Pape,
et une deuxième au n° 16, de M. Achille Varin.
X
Deux expositions intéressantes sont ouvertes en ce moment au public,
l’une dans la galerie Georges Petit, rue de Sèze, l’autre dans la galerie
Cahen, 6, rue Laffitte.
La première comprend sept cartons attribués à Raphaël.
La seconde, une série de tableaux rapportés du Maroc par M. Ernst.
Nous reviendrons sur ces deux expositions, dont le défaut d’espace nous
empêche de rendre compte aujourd’hui.
X
On sait que trois artistes avaient été proposés pour la médaille, par le jury
du Salon de Gand. Cette décision a été annulée parce que le gouvernement
n’était pas représenté dans la séance où elle a été prise.
La Commission s’est réunie à nouveau la semaine dernière, avec l’adjonc-
tion de M. Leclercq, inspecteur des Beaux-Arts.
Sont désignés au gouvernement, qui doit ratifier ce choix, MM. Richir
(Bruxelles) et Dagnan-Bouveret (Paris) peintres, et Le Roy (Gand) sculpteur.
Le jury a décidé en outre que, contrairement à l’usage, la médaille qui
deviendrait disponible si M. Dagnan-Bouveret était décoré de l’Ordre de
Léopold, serait allouée à M. Herain (Bruxelles), sculpteur.
Le Gérant : SILVESTRE
Paris, — Glyptograpiiie SILVESTRE & C", rue Obcrkampf, 97
LE TRIOMPHE DE LA RÉPUBLIQUE
Le superbe monument qui vient d’être solennellement inauguré
sur la place de la Nation, et qui symbolise le triomphe de la
République, n’aura pas coûté moins de dix années de travail à
l’éminent statuaire Jules Dalou.
Comme on peut le voir par la reproduction fidèle que nous en
donnons à notre première page, ce monument est d’une simpli-
cité magistrale.
Sur le char triomphal orné de guirlandes fleuries et traîné par
deux lions, la République, figurée sous les traits d’une jeune
femme aux formes gracieuses et robustes, se dresse, une main
appuyée sur le faisceau exprimant l’union des peuples, l’autre
étendue vers l’horizon.
Devant elle, et à demi couché sur l’un des lions, le génie de la
Liberté brandit le flambeau allégorique et retourne la tête vers la
République comme pour l’entraîner aux victoires prochaines, vic-
toires pacifiques, toutefois, puisque l’image républicaine est escor-
tée de trois nobles figures évoquant le travail, la justice et la paix.
L’œuvre est admirable dans son ensemble comme dans tous
ses détails, et demeurera comme l’expression la plus parfaite de
l’art de notre temps.
Aussi bien, sa genèse est curieuse et mérite d’être rappelée ici :
C’est en 1879 que le « Triomphe de la République » parut
pour la première fois, dans un concours organisé par le Conseil
municipal de Paris : il s’agissait d’élever, sur la place de la Répu-
blique, une statue monumentale destinée à glorifier les institu-
tions démocratiques de la France.
Le projet de M. Dalou ne fut pas primé ; ce fut le projet de
M. Morice qui obtint les suffrages du Jury.
Le Jury, pourtant, avait remarqué le « Triomphe de la Répu-
blique », et s’il l’avait repoussé, c’était pour ce motif qu’il s’éloi-
gnait un peu du programme donné; avant de se dissoudre, la
besogne finie, il recommanda la maquette de M. Dalou à l’atten-
tion du Conseil municipal, et celui-ci décida en effet de faire
exécuter deux monuments au lieu .d’un seul.
C’est ainsi que l’œuvre de M. Dalou n’a pas été perdue et
que dès maintenant ses admirateurs peuvent aller la contempler
sur la place de la Nation, sinon dans son apparence defini-
tive, c-ar toutes les pièces n’en sont pas encore fondues, au moins
dans sa plus exacte représentation possible, en plâtre bronzé.
M. Dalou est âgé aujourd’hui d’une cinquantaine d’années ; il
était chevalier de la. Légion-d’honneur depuis 1883.
En 1871, il accepta de la Commune une place modeste au
Musée du Louvre. C’est là qu’il se trouvait quand les troupes de
Versailles entrèrent dans Paris. Il réussit à échapper à la répres-
sion et à se réfugier à Londres.
Sans argent, sans ressources, il mena pendant quelque temps
une vie obscure et laborieuse; puis, enfin, remarqué par le duc
de Westminster, qui possédait un certain nombre de ses œuvres,
il sortit peu à peu de son isolement et devint professeur a Ken-
sington, d’où il envoya sa maquette du « Triomphe de la Répu-
blique » au concours du Conseil municipal de Paris.
Aussitôt la loi d’amnistie promulguée, en 1880, il rentra à
Paris et, depuis lors, exécuta un certain nombre d’œuvres qui
l’ont placé au premier rang des artistes contemporains.
Il a obtenu, au Salon annuel de 1883, la médaille d’honneur
pour un admirable bas-relief exposé présentement au Champ-de-
Mars, dans la galerie de sculpture. Ce bas-relief représente Mira-
beau, dans la salle du Jeu-de-Paume, au moment où il répond au
marquis de Dreux-Brézé, grand-maître des cérémonies, que « les
députés du Tiers-État, réunis par la volonté du peuple, ne se
sépareront que par la force des baïonnettes ».
Le Triomphe de la République est un chef-d’œuvre de plus à
l’actif du maître, sur la poitrine duquel M. Carnot, président de
la République, a tenu à attacher lui-même la croix d’officier de
la Légion-d’honneur.
LA MORT DU LIEUTENANT WATRIN
Par M. L.-T. Sergent.
C'était le Ier septembre 1870, à Bazeilles !
Lorsque\le village fut envahi par les masses écrasantes des
Bavarois, le lieutenant Watrin et quinze hommes de l’infanterie
de marine, barricadés dans une maison, s’y défendirent jusqu’à
l’épuisement complet de leurs munitions. Les Bavarois, qui les
cernaient de toutes parts, leur crièrent de se rendre.
Watrin et ses hommes refusèrent, et, se ruant, la baïonnette en
avant, cherchèrent à se frayer un passage à travers la foule des
ennemis dont ils étaient entourés. Ils furent tous tués ou blessés.
Tel est, en deux mots, le fait d’armes retracé par M. Sergent,
qui a apporté dans cette restitution ses brillantes qualités d’anna-
liste militaire, sa puissance d’évocation et, disons-le, sa foi
patriotique.
L’AMOUR EFFEUILLANT LA MARGUERITE
Par M. Fernand Le Quesne.
Chaste en son inconsciente nudité, belle comme une déesse et
charmante comme une parisienne de 1889, la jeune fille que nous
présente M. Fernand Le Quesne vient de sentir battre son cœur
pour la première fois. Un nom aimé flotte sur ses lèvres avec un
vague sourire de rêverie doucement inquiète. Éclos dans son ima-
gination attendrie, deux petits amours s’empressent à satisfaire son
caprice. L’un, assis à ses pieds, lui offre des marguerites fraîche-
ment cueillies, et c’est l’autre amour, voletant au-dessus de son
jeune front, qui les effeuille de ses doigts potelés.
M’aime-t-il ? Un peu... beaucoup... passionnément...
Avec des charmes comme les vôtres, mademoiselle, la réponse
n’était pas douteuse !
M. F. Le Quesne exposait au dernier Salon, outre la Jeune fille
effeuillant la marguerite, un tableau d’une originalité très marquée,
sous ce titre : les Deux perles.
-:--■
^chos Artistiques
L’Académie des Beaux-Arts vient de juger le concours de paysage, dit
« Concours Troyon », dont le sujet était : « le Printemps ».
Le prix de 1,200 francs a été décerné au tableau n° 10, dont l’auteur est
M. Albert-Gabriel Rigolot, élève de M. Pelouse.
Une première mention a été accordée au n° 32, de M. JeamConstant Pape,
et une deuxième au n° 16, de M. Achille Varin.
X
Deux expositions intéressantes sont ouvertes en ce moment au public,
l’une dans la galerie Georges Petit, rue de Sèze, l’autre dans la galerie
Cahen, 6, rue Laffitte.
La première comprend sept cartons attribués à Raphaël.
La seconde, une série de tableaux rapportés du Maroc par M. Ernst.
Nous reviendrons sur ces deux expositions, dont le défaut d’espace nous
empêche de rendre compte aujourd’hui.
X
On sait que trois artistes avaient été proposés pour la médaille, par le jury
du Salon de Gand. Cette décision a été annulée parce que le gouvernement
n’était pas représenté dans la séance où elle a été prise.
La Commission s’est réunie à nouveau la semaine dernière, avec l’adjonc-
tion de M. Leclercq, inspecteur des Beaux-Arts.
Sont désignés au gouvernement, qui doit ratifier ce choix, MM. Richir
(Bruxelles) et Dagnan-Bouveret (Paris) peintres, et Le Roy (Gand) sculpteur.
Le jury a décidé en outre que, contrairement à l’usage, la médaille qui
deviendrait disponible si M. Dagnan-Bouveret était décoré de l’Ordre de
Léopold, serait allouée à M. Herain (Bruxelles), sculpteur.
Le Gérant : SILVESTRE
Paris, — Glyptograpiiie SILVESTRE & C", rue Obcrkampf, 97