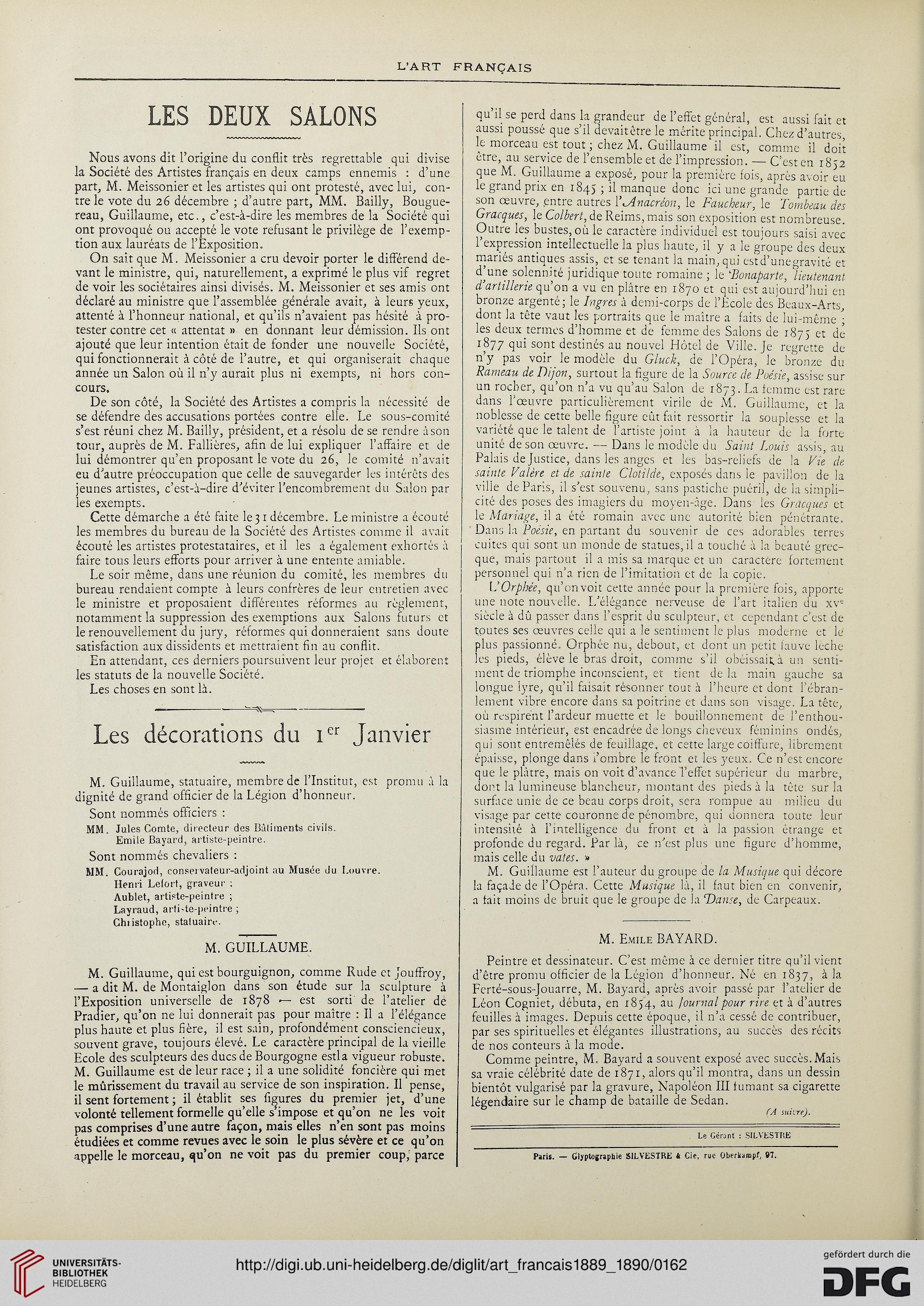L’ART FRANÇAIS
LES DEUX SALONS
Nous avons dit l’origine du conflit très regrettable qui divise
la Société des Artistes français en deux camps ennemis : d’une
part, M. Meissonier et les artistes qui ont protesté, avec lui, con-
tre le vote du 26 décembre ; d’autre part, MM. Bailly, Bougue-
reau, Guillaume, etc., c’est-à-dire les membres de la Société qui
ont provoqué ou accepté le vote refusant le privilège de l’exemp-
tion aux lauréats de l’Exposition.
On sait que M. Meissonier a cru devoir porter le différend de-
vant le ministre, qui, naturellement, a exprimé le plus vif regret
de voir les sociétaires ainsi divisés. M. Meissonier et ses amis ont
déclaré au ministre que l’assemblée générale avait, à leurs yeux,
attenté à l’honneur national, et qu’ils n’avaient pas hésité à pro-
tester contre cet « attentat » en donnant leur démission. Ils ont
ajouté que leur intention était de fonder une nouvelle Société,
qui fonctionnerait à côté de l’autre, et qui organiserait chaque
année un Salon où il n’y aurait plus ni exempts, ni hors con-
cours.
De son côté, la Société des Artistes a compris la nécessité de
se défendre des accusations portées contre elle. Le sous-comité
s’est réuni chez M. Bailly, président, et a résolu de se rendre à son
tour, auprès de M. Fallières, afin de lui expliquer l’affaire et de
lui démontrer qu’en proposant le vote du 26, le comité n’avait
eu d’autre préoccupation que celle de sauvegarder les intérêts des
jeunes artistes, c’est-à-dire d’éviter l’encombrement du Salon par
les exempts.
Cette démarche a été faite le3 1 décembre. Le ministre a écouté
les membres du bureau de la Société des Artistes comme il avait
écouté les artistes protestataires, et il les a également exhortés à
faire tous leurs efforts pour arriver à une entente amiable.
Le soir même, dans une réunion du comité, les membres du
bureau rendaient compte à leurs confrères de leur entretien avec
le ministre et proposaient différentes réformes au règlement,
notamment la suppression des exemptions aux Salons futurs et
le renouvellement du jury, réformes qui donneraient sans doute
satisfaction aux dissidents et mettraient fin au conflit.
En attendant, ces derniers poursuivent leur projet et élaborent
les statuts de la nouvelle Société.
Les choses en sont là.
Les décorations du icr Janvier
M. Guillaume, statuaire, membre de l’Institut, est promu à la
dignité de grand officier de la Légion d’honneur.
Sont nommés officiers :
MM. Jules Comte, directeur des Bâtiments civils.
Emile Bayard, artiste-peintre.
Sont nommés chevaliers :
MM. Courajod, conservateur-adjoint au Musée du Louvre.
Henri Leiort, graveur ;
Aublet, artiste-peintre ;
Layraud, arti-te-peintre ;
Ghiistophe, statuaire.
M. GUILLAUME.
M. Guillaume, qui est bourguignon, comme Rude et jouffroy,
— a dit M. de Montaiglon dans son étude sur la sculpture à
l’Exposition universelle de 1878 — est sorti de l’atelier de
Prauier, qu’on ne lui donnerait pas pour maître : Il a l’élégance
plus haute et plus fière, il est sain, profondément consciencieux,
souvent grave, toujours élevé. Le caractère principal de la vieille
Ecole des sculpteurs des ducs de Bourgogne estla vigueur robuste.
M. Guillaume est de leur race ; il a une solidité foncière qui met
le mûrissement du travail au service de son inspiration. Il pense,
il sent fortement ; il établit ses figures du premier jet, d’une
volonté tellement formelle qu’elle s impose et qu’on ne les voit
pas comprises d’une autre façon, mais elles n’en sont pas moins
étudiées et comme revues avec le soin le plus sévère et ce qu’on
appelle le morceau, qu’on ne voit pas du premier coup, parce
qu’il se perd dans la grandeur de l’effet général, est aussi fait et
aussi poussé que s’il devaitètre le mérite principal. Chez d’autres,
le morceau est tout ; chez M. Guillaume il est, comme il doit
être, au service de l’ensemble et de l’impression. — C’est en 1852
que M. Guillaume a exposé, pour la première fois, après avoir eu
le grand prix en 1845 ; il manque donc ici une grande partie de
son œuvre, entre autres WAnacréon, le Faucheur, le Tombeau des
Gracques, le Colbert, de Reims, mais son exposition est nombreuse.
Outre les bustes, où le caractère individuel est toujours saisi avec
l’expression intellectuelle la plus haute, il y a le groupe des deux
mariés antiques assis, et se tenant la main, qui estd’unegravité et
d’une solennité juridique toute romaine ; le ‘Bonaparte, lieutenant
d’artillerie qu’on a vu en plâtre en 1870 et qui est aujourd’hui en
bronze argenté; le Ingres à demi-corps de l’Ecole des Beaux-Arts,
dont la tête vaut les portraits que le maître a faits de lui-même ;
les deux termes d’homme et de femme des Salons de 1875 et de
1877 qui sont destinés au nouvel Hôtel de Ville. Je regrette de
n’y pas voir, le modèle du Gluck, de l’Opéra, le bronze du
Rameau de Dijon, surtout la figure de la Source de Poésie, assise sur
un rocher, qu’on n’a vu qu’au Salon de 1873.femme est rare
dans fœuvre particulièrement virile de M. Guillaume, et la
noblesse de cette belle figure eût fait ressortir la souplesse et la
variété que le talent de l’artiste joint à la hauteur de la forte
unité de son œuvre. — Dans le modèle du Saint Louis assis, au
Palais de Justice, dans les anges et les bas-reliefs de la Vie de
sainte Valère et de sainte Clotiide, exposés dans le pavillon de la
ville de Paris, il s’est souvenu, sans pastiche puéril, de la simpli-
cité des poses des imagiers du moyen-âge. Dans les Gracques et
le Mariage, il a été romain avec une autorité bien pénétrante.
Dans la Poésie, en partant du souvenir de ces adorables terres
cuites qui sont un monde de statues, il a touché à la beauté grec-
que, mais partout il a mis sa marque et un caractère fortement
personnel qui n’a rien de l’imitation et de ia copie.
U Orphée, qu’on voit cette année pour la première fois, apporte
une note nouvelle. L’élégance nerveuse de l’art italien du xve
siècle à dû passer dans l’esprit du sculpteur, et cependant c’est de
toutes ses œuvres celle qui a le sentiment le plus moderne et le
plus passionné. Orphée nu, debout, et dont un petit fauve lèche
les pieds, élève le bras droit, comme s’il obéissait.à un senti-
ment de triomphe inconscient, et tient de la main gauche sa
longue lyre, qu’il faisait résonner tout à l’heure et dont l’ébran-
lement vibre encore dans sa poitrine et dans son visage. La tête,
où respirent l’ardeur muette et le bouillonnement de l’enthou-
siasme intérieur, est encadrée de longs cheveux féminins ondes,
qui sont entremêlés de feuillage, et cette large coiffure, librement
épaisse, plonge dans f ombre le front et les yeux. Ce n’est encore
que le plâtre, mais on voit d’avance l’effet supérieur du marbre,
dont la lumineuse blancheur, montant des pieds à la tète sur la
surface unie de ce beau corps droit, sera rompue au milieu du
visage par cette couronne de pénombre, qui donnera toute leur
intensité à l’intelligence du front et à la passion étrange et
profonde du regard. Par là, ce n’est plus une figure d’homme,
mais celle du vates. >*
M. Guillaume est l’auteur du groupe de la Musique qui décore
la façade de l’Opéra. Cette Musique là, il faut bien en convenir,
a fait moins de bruit que le groupe de la Danse, de Carpeaux.
M. Emile BAYARD.
Peintre et dessinateur. C’est même à ce dernier titre qu’il vient
d’être promu officier de la Légion d’honneur. Né en 1837, à la
Fcrté-sous-Jouarre, M. Bayard, après avoir passé par l’atelier de
Léon Cogniet, débuta, en 1854, au journal pour rire et à d’autres
feuilles à images. Depuis cette époque, il n’a cessé de contribuer,
par ses spirituelles et élégantes illustrations, au succès des récits
de nos conteurs à la mode.
Comme peintre, M. Bayard a souvent exposé avec succès. Mais
sa vraie célébrité date de 1871, alors qu’il montra, dans un dessin
bientôt vulgarisé par la gravure, Napoléon III fumant sa cigarette
légendaire sur le champ de bataille de Sedan.
(A suivre).
Le Gérant : SILVESTRE
Paris. — Glj'ptograptiie SILVESTRE t Cie, rue Oberkampf, 97.
LES DEUX SALONS
Nous avons dit l’origine du conflit très regrettable qui divise
la Société des Artistes français en deux camps ennemis : d’une
part, M. Meissonier et les artistes qui ont protesté, avec lui, con-
tre le vote du 26 décembre ; d’autre part, MM. Bailly, Bougue-
reau, Guillaume, etc., c’est-à-dire les membres de la Société qui
ont provoqué ou accepté le vote refusant le privilège de l’exemp-
tion aux lauréats de l’Exposition.
On sait que M. Meissonier a cru devoir porter le différend de-
vant le ministre, qui, naturellement, a exprimé le plus vif regret
de voir les sociétaires ainsi divisés. M. Meissonier et ses amis ont
déclaré au ministre que l’assemblée générale avait, à leurs yeux,
attenté à l’honneur national, et qu’ils n’avaient pas hésité à pro-
tester contre cet « attentat » en donnant leur démission. Ils ont
ajouté que leur intention était de fonder une nouvelle Société,
qui fonctionnerait à côté de l’autre, et qui organiserait chaque
année un Salon où il n’y aurait plus ni exempts, ni hors con-
cours.
De son côté, la Société des Artistes a compris la nécessité de
se défendre des accusations portées contre elle. Le sous-comité
s’est réuni chez M. Bailly, président, et a résolu de se rendre à son
tour, auprès de M. Fallières, afin de lui expliquer l’affaire et de
lui démontrer qu’en proposant le vote du 26, le comité n’avait
eu d’autre préoccupation que celle de sauvegarder les intérêts des
jeunes artistes, c’est-à-dire d’éviter l’encombrement du Salon par
les exempts.
Cette démarche a été faite le3 1 décembre. Le ministre a écouté
les membres du bureau de la Société des Artistes comme il avait
écouté les artistes protestataires, et il les a également exhortés à
faire tous leurs efforts pour arriver à une entente amiable.
Le soir même, dans une réunion du comité, les membres du
bureau rendaient compte à leurs confrères de leur entretien avec
le ministre et proposaient différentes réformes au règlement,
notamment la suppression des exemptions aux Salons futurs et
le renouvellement du jury, réformes qui donneraient sans doute
satisfaction aux dissidents et mettraient fin au conflit.
En attendant, ces derniers poursuivent leur projet et élaborent
les statuts de la nouvelle Société.
Les choses en sont là.
Les décorations du icr Janvier
M. Guillaume, statuaire, membre de l’Institut, est promu à la
dignité de grand officier de la Légion d’honneur.
Sont nommés officiers :
MM. Jules Comte, directeur des Bâtiments civils.
Emile Bayard, artiste-peintre.
Sont nommés chevaliers :
MM. Courajod, conservateur-adjoint au Musée du Louvre.
Henri Leiort, graveur ;
Aublet, artiste-peintre ;
Layraud, arti-te-peintre ;
Ghiistophe, statuaire.
M. GUILLAUME.
M. Guillaume, qui est bourguignon, comme Rude et jouffroy,
— a dit M. de Montaiglon dans son étude sur la sculpture à
l’Exposition universelle de 1878 — est sorti de l’atelier de
Prauier, qu’on ne lui donnerait pas pour maître : Il a l’élégance
plus haute et plus fière, il est sain, profondément consciencieux,
souvent grave, toujours élevé. Le caractère principal de la vieille
Ecole des sculpteurs des ducs de Bourgogne estla vigueur robuste.
M. Guillaume est de leur race ; il a une solidité foncière qui met
le mûrissement du travail au service de son inspiration. Il pense,
il sent fortement ; il établit ses figures du premier jet, d’une
volonté tellement formelle qu’elle s impose et qu’on ne les voit
pas comprises d’une autre façon, mais elles n’en sont pas moins
étudiées et comme revues avec le soin le plus sévère et ce qu’on
appelle le morceau, qu’on ne voit pas du premier coup, parce
qu’il se perd dans la grandeur de l’effet général, est aussi fait et
aussi poussé que s’il devaitètre le mérite principal. Chez d’autres,
le morceau est tout ; chez M. Guillaume il est, comme il doit
être, au service de l’ensemble et de l’impression. — C’est en 1852
que M. Guillaume a exposé, pour la première fois, après avoir eu
le grand prix en 1845 ; il manque donc ici une grande partie de
son œuvre, entre autres WAnacréon, le Faucheur, le Tombeau des
Gracques, le Colbert, de Reims, mais son exposition est nombreuse.
Outre les bustes, où le caractère individuel est toujours saisi avec
l’expression intellectuelle la plus haute, il y a le groupe des deux
mariés antiques assis, et se tenant la main, qui estd’unegravité et
d’une solennité juridique toute romaine ; le ‘Bonaparte, lieutenant
d’artillerie qu’on a vu en plâtre en 1870 et qui est aujourd’hui en
bronze argenté; le Ingres à demi-corps de l’Ecole des Beaux-Arts,
dont la tête vaut les portraits que le maître a faits de lui-même ;
les deux termes d’homme et de femme des Salons de 1875 et de
1877 qui sont destinés au nouvel Hôtel de Ville. Je regrette de
n’y pas voir, le modèle du Gluck, de l’Opéra, le bronze du
Rameau de Dijon, surtout la figure de la Source de Poésie, assise sur
un rocher, qu’on n’a vu qu’au Salon de 1873.femme est rare
dans fœuvre particulièrement virile de M. Guillaume, et la
noblesse de cette belle figure eût fait ressortir la souplesse et la
variété que le talent de l’artiste joint à la hauteur de la forte
unité de son œuvre. — Dans le modèle du Saint Louis assis, au
Palais de Justice, dans les anges et les bas-reliefs de la Vie de
sainte Valère et de sainte Clotiide, exposés dans le pavillon de la
ville de Paris, il s’est souvenu, sans pastiche puéril, de la simpli-
cité des poses des imagiers du moyen-âge. Dans les Gracques et
le Mariage, il a été romain avec une autorité bien pénétrante.
Dans la Poésie, en partant du souvenir de ces adorables terres
cuites qui sont un monde de statues, il a touché à la beauté grec-
que, mais partout il a mis sa marque et un caractère fortement
personnel qui n’a rien de l’imitation et de ia copie.
U Orphée, qu’on voit cette année pour la première fois, apporte
une note nouvelle. L’élégance nerveuse de l’art italien du xve
siècle à dû passer dans l’esprit du sculpteur, et cependant c’est de
toutes ses œuvres celle qui a le sentiment le plus moderne et le
plus passionné. Orphée nu, debout, et dont un petit fauve lèche
les pieds, élève le bras droit, comme s’il obéissait.à un senti-
ment de triomphe inconscient, et tient de la main gauche sa
longue lyre, qu’il faisait résonner tout à l’heure et dont l’ébran-
lement vibre encore dans sa poitrine et dans son visage. La tête,
où respirent l’ardeur muette et le bouillonnement de l’enthou-
siasme intérieur, est encadrée de longs cheveux féminins ondes,
qui sont entremêlés de feuillage, et cette large coiffure, librement
épaisse, plonge dans f ombre le front et les yeux. Ce n’est encore
que le plâtre, mais on voit d’avance l’effet supérieur du marbre,
dont la lumineuse blancheur, montant des pieds à la tète sur la
surface unie de ce beau corps droit, sera rompue au milieu du
visage par cette couronne de pénombre, qui donnera toute leur
intensité à l’intelligence du front et à la passion étrange et
profonde du regard. Par là, ce n’est plus une figure d’homme,
mais celle du vates. >*
M. Guillaume est l’auteur du groupe de la Musique qui décore
la façade de l’Opéra. Cette Musique là, il faut bien en convenir,
a fait moins de bruit que le groupe de la Danse, de Carpeaux.
M. Emile BAYARD.
Peintre et dessinateur. C’est même à ce dernier titre qu’il vient
d’être promu officier de la Légion d’honneur. Né en 1837, à la
Fcrté-sous-Jouarre, M. Bayard, après avoir passé par l’atelier de
Léon Cogniet, débuta, en 1854, au journal pour rire et à d’autres
feuilles à images. Depuis cette époque, il n’a cessé de contribuer,
par ses spirituelles et élégantes illustrations, au succès des récits
de nos conteurs à la mode.
Comme peintre, M. Bayard a souvent exposé avec succès. Mais
sa vraie célébrité date de 1871, alors qu’il montra, dans un dessin
bientôt vulgarisé par la gravure, Napoléon III fumant sa cigarette
légendaire sur le champ de bataille de Sedan.
(A suivre).
Le Gérant : SILVESTRE
Paris. — Glj'ptograptiie SILVESTRE t Cie, rue Oberkampf, 97.