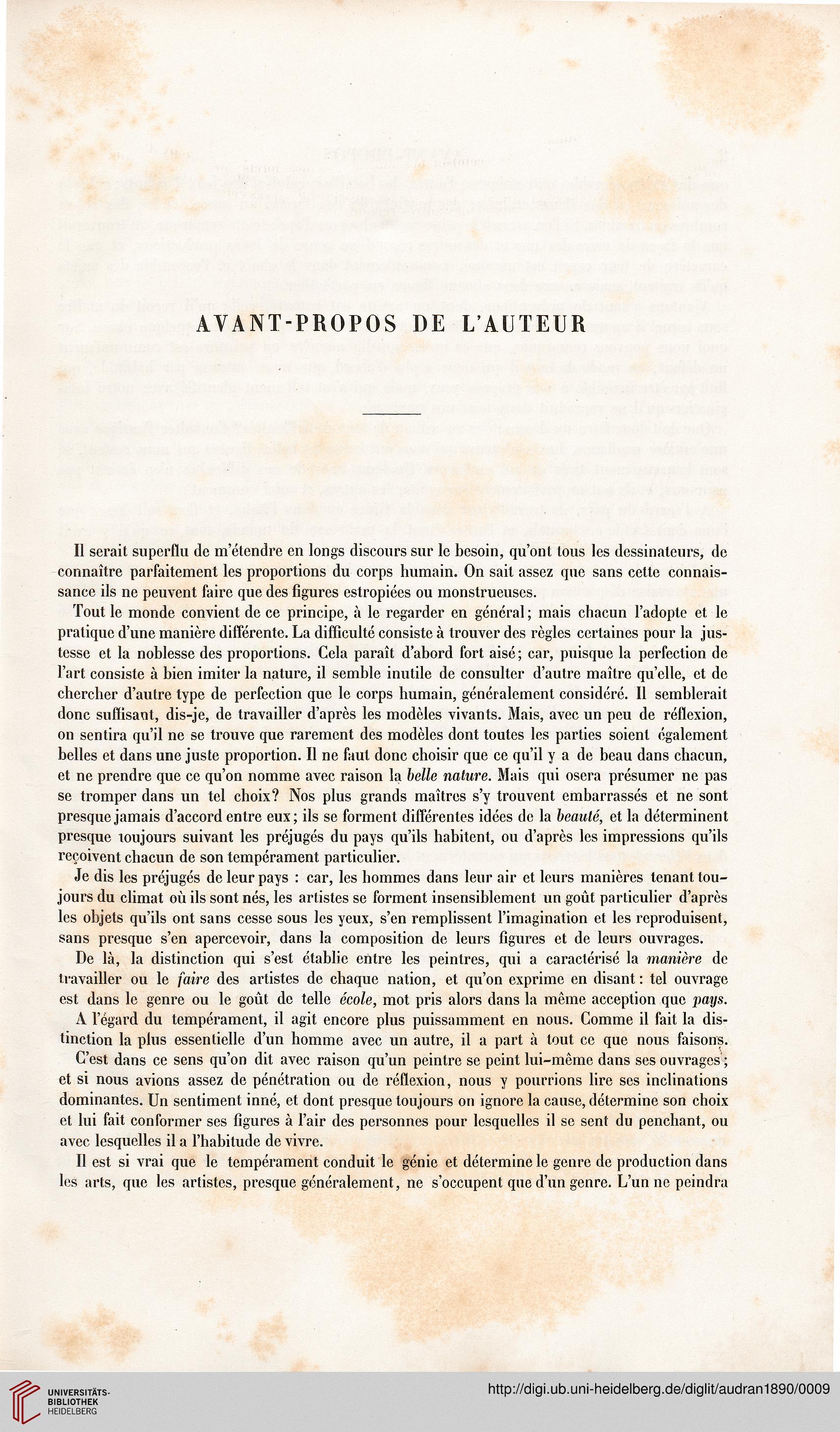AYANT-PROPOS DE L'AUTEUR
Il serait superflu de m'étendre en longs discours sur le besoin, qu'ont tous les dessinateurs, de
connaître parfaitement les proportions du corps humain. On sait assez que sans cette connais-
sance ils ne peuvent faire que des figures estropiées ou monstrueuses.
Tout le monde convient de ce principe, à le regarder en général ; mais chacun l'adopte et le
pratique d'une manière différente. La difficulté consiste à trouver des règles certaines pour la jus-
tesse et la noblesse des proportions. Cela paraît d'abord fort aisé; car, puisque la perfection de
l'art consiste à bien imiter la nature, il semble inutile de consulter d'autre maître qu'elle, et de
chercher d'autre type de perfection que le corps humain, généralement considéré. Il semblerait
donc suffisant, dis-je, de travailler d'après les modèles vivants. Mais, avec un peu de réflexion,
on sentira qu'il ne se trouve que rarement des modèles dont toutes les parties soient également
belles et dans une juste proportion. Il ne faut donc choisir que ce qu'il y a de beau dans chacun,
et ne prendre que ce qu'on nomme avec raison la belle nature. Mais qui osera présumer ne pas
se tromper dans un tel choix? Nos plus grands maîtres s'y trouvent embarrassés et ne sont
presque jamais d'accord entre eux; ils se forment différentes idées de la beauté, et la déterminent
presque toujours suivant les préjugés du pays qu'ils habitent, ou d'après les impressions qu'ils
reçoivent chacun de son tempérament particulier.
Je dis les préjugés de leur pays : car, les hommes dans leur air et leurs manières tenant tou-
jours du climat où ils sont nés, les artistes se forment insensiblement un goût particulier d'après
les objets qu'ils ont sans cesse sous les yeux, s'en remplissent l'imagination et les reproduisent,
sans presque s'en apercevoir, dans la composition de leurs figures et de leurs ouvrages.
De là, la distinction qui s'est établie entre les peintres, qui a caractérisé la manière de
travailler ou le faire des artistes de chaque nation, et qu'on exprime en disant : tel ouvrage
est dans le genre ou le goût de telle école, mot pris alors dans la même acception que pays.
A l'égard du tempérament, il agit encore plus puissamment en nous. Gomme il fait la dis-
tinction la plus essentielle d'un homme avec un autre, il a part à tout ce que nous faisons.
C'est dans ce sens qu'on dit avec raison qu'un peintre se peint lui-même dans ses ouvrages ;
et si nous avions assez de pénétration ou de réflexion, nous y pourrions lire ses inclinations
dominantes. Un sentiment inné, et dont presque toujours on ignore la cause, détermine son choix
et lui fait conformer ses figures à l'air des personnes pour lesquelles il se sent du penchant, ou
avec lesquelles il a l'habitude de vivre.
Il est si vrai que le tempérament conduit le génie et détermine le genre de production dans
les arts, que les artistes, presque généralement, ne s'occupent que d'un genre. L'un ne peindra
Il serait superflu de m'étendre en longs discours sur le besoin, qu'ont tous les dessinateurs, de
connaître parfaitement les proportions du corps humain. On sait assez que sans cette connais-
sance ils ne peuvent faire que des figures estropiées ou monstrueuses.
Tout le monde convient de ce principe, à le regarder en général ; mais chacun l'adopte et le
pratique d'une manière différente. La difficulté consiste à trouver des règles certaines pour la jus-
tesse et la noblesse des proportions. Cela paraît d'abord fort aisé; car, puisque la perfection de
l'art consiste à bien imiter la nature, il semble inutile de consulter d'autre maître qu'elle, et de
chercher d'autre type de perfection que le corps humain, généralement considéré. Il semblerait
donc suffisant, dis-je, de travailler d'après les modèles vivants. Mais, avec un peu de réflexion,
on sentira qu'il ne se trouve que rarement des modèles dont toutes les parties soient également
belles et dans une juste proportion. Il ne faut donc choisir que ce qu'il y a de beau dans chacun,
et ne prendre que ce qu'on nomme avec raison la belle nature. Mais qui osera présumer ne pas
se tromper dans un tel choix? Nos plus grands maîtres s'y trouvent embarrassés et ne sont
presque jamais d'accord entre eux; ils se forment différentes idées de la beauté, et la déterminent
presque toujours suivant les préjugés du pays qu'ils habitent, ou d'après les impressions qu'ils
reçoivent chacun de son tempérament particulier.
Je dis les préjugés de leur pays : car, les hommes dans leur air et leurs manières tenant tou-
jours du climat où ils sont nés, les artistes se forment insensiblement un goût particulier d'après
les objets qu'ils ont sans cesse sous les yeux, s'en remplissent l'imagination et les reproduisent,
sans presque s'en apercevoir, dans la composition de leurs figures et de leurs ouvrages.
De là, la distinction qui s'est établie entre les peintres, qui a caractérisé la manière de
travailler ou le faire des artistes de chaque nation, et qu'on exprime en disant : tel ouvrage
est dans le genre ou le goût de telle école, mot pris alors dans la même acception que pays.
A l'égard du tempérament, il agit encore plus puissamment en nous. Gomme il fait la dis-
tinction la plus essentielle d'un homme avec un autre, il a part à tout ce que nous faisons.
C'est dans ce sens qu'on dit avec raison qu'un peintre se peint lui-même dans ses ouvrages ;
et si nous avions assez de pénétration ou de réflexion, nous y pourrions lire ses inclinations
dominantes. Un sentiment inné, et dont presque toujours on ignore la cause, détermine son choix
et lui fait conformer ses figures à l'air des personnes pour lesquelles il se sent du penchant, ou
avec lesquelles il a l'habitude de vivre.
Il est si vrai que le tempérament conduit le génie et détermine le genre de production dans
les arts, que les artistes, presque généralement, ne s'occupent que d'un genre. L'un ne peindra