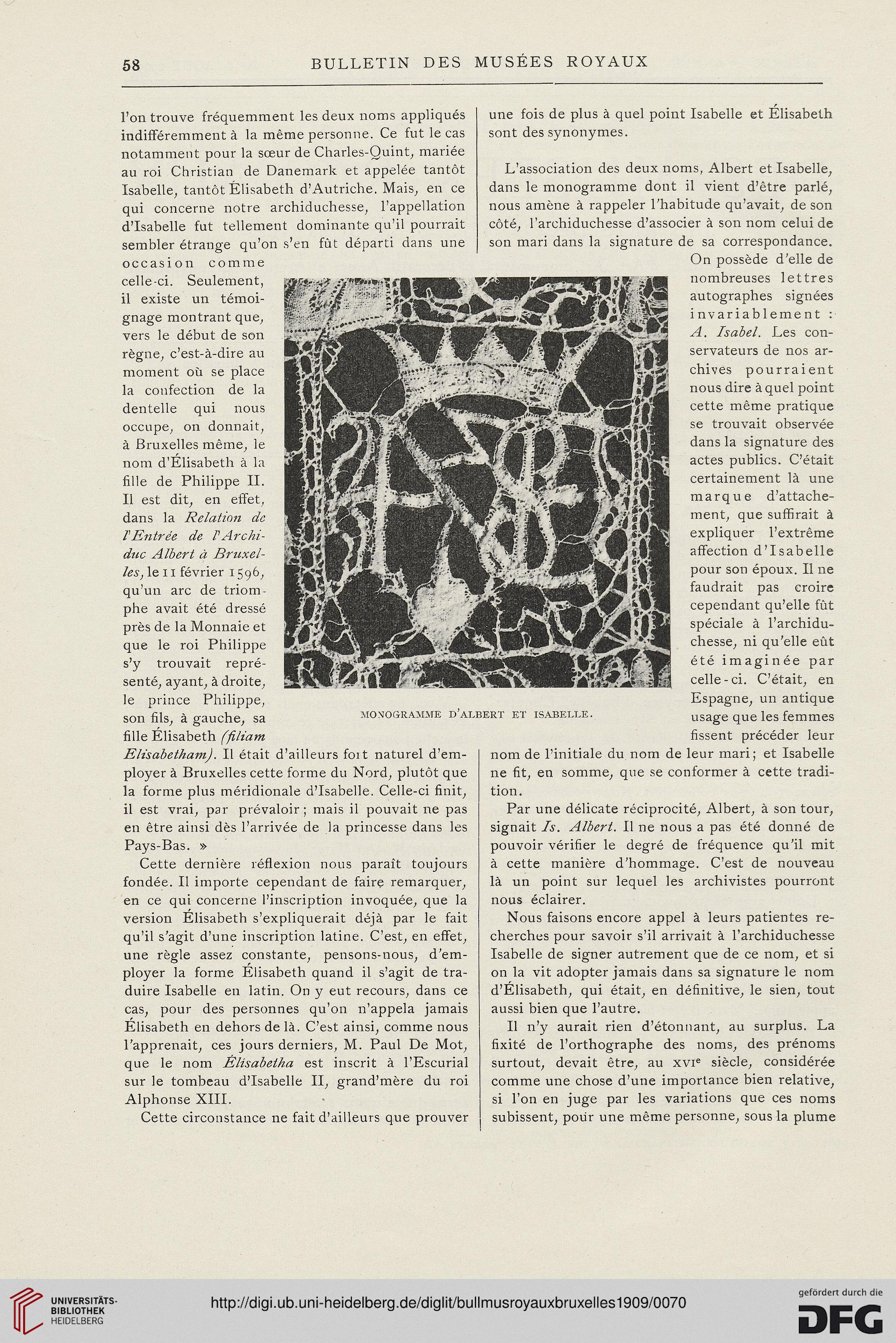58
BULLETIN DES MUSEES ROYAUX
l’on trouve fréquemment les deux noms appliqués
indifféremment à la même personne. Ce fut le cas
notamment pour la sœur de Charles-Quint, mariée
au roi Christian de Danemark et appelée tantôt
Isabelle, tantôt Élisabeth d’Autriche. Mais, en ce
qui concerne notre archiduchesse, l’appellation
d’Isabelle fut tellement dominante qu’il pourrait
sembler étrange qu’on s’en fût départi dans une
occasion comme
celle-ci. Seulement,
il existe un témoi-
gnage montrant que,
vers le début de son
règne, c’est-à-dire au
moment où se place
la confection de la
dentelle qui nous
occupe, on donnait,
à Bruxelles même, le
nom d'Elisabeth à la
fille de Philippe IL
Il est dit, en effet,
dans la Relation de
l'Entrée de l'Archi-
duc Albert à Bruxel-
les, le 11 février 1596,
qu’un arc de triom-
phe avait été dressé
près de la Monnaie et
que le roi Philippe
s’y trouvait repré-
senté, ayant, à droite,
le prince Philippe,
son fils, à gauche, sa
fille Elisabeth (filiam
Elisabetham). Il était d’ailleurs foit naturel d’em-
ployer à Bruxelles cette forme du Nord, plutôt que
la forme plus méridionale d’Isabelle. Celle-ci finit,
il est vrai, par prévaloir ; mais il pouvait ne pas
en être ainsi dès l’arrivée de la princesse dans les
Pays-Bas. »
Cette dernière réflexion nous paraît toujours
fondée. Il importe cependant de faire remarquer,
en ce qui concerne l’inscription invoquée, que la
version Élisabeth s’expliquerait déjà par le fait
qu’il s'agit d’une inscription latine. C’est, en effet,
une règle assez constante, pensons-nous, d’em-
ployer la forme Elisabeth quand il s’agit de tra-
duire Isabelle en latin. On y eut recours, dans ce
cas, pour des personnes qu’on n’appela jamais
Elisabeth en dehors de là. C’est ainsi, comme nous
l’apprenait, ces jours derniers, M. Paul De Mot,
que le nom Èlisabetha est inscrit à l’Escurial
sur le tombeau d’Isabelle II, grand’mère du roi
Alphonse XIII.
Cette circonstance ne fait d’ailleurs que prouver
une fois de plus à quel point Isabelle et Élisabeth
sont des synonymes.
L’association des deux noms, Albert et Isabelle,
dans le monogramme dont il vient d’être parlé,
nous amène à rappeler l’habitude qu’avait, de son
côté, l’archiduchesse d’associer à son nom celui de
son mari dans la signature de sa correspondance.
On possède d’elle de
nombreuses lettres
autographes signées
invariablement :
A. Isabel. Les con-
servateurs de nos ar-
chives pourraient
nous dire à quel point
cette même pratique
se trouvait observée
dans la signature des
actes publics. C’était
certainement là une
marque d’attache-
ment, que suffirait à
expliquer l’extrême
affection d’Isabelle
pour son époux. Il ne
faudrait pas croire
cependant qu’elle fût
spéciale à l’archidu-
chesse, ni qu’elle eût
été imaginée par
celle-ci. C’était, en
Espagne, un antique
usage que les femmes
fissent précéder leur
nom de l’initiale du nom de leur mari; et Isabelle
ne fit, en somme, que se conformer à cette tradi-
tion .
Par une délicate réciprocité, Albert, à son tour,
signait Is. Albert. Il ne nous a pas été donné de
pouvoir vérifier le degré de fréquence qu’il mit
à cette manière d'hommage. C’est de nouveau
là un point sur lequel les archivistes pourront
nous éclairer.
Nous faisons encore appel à leurs patientes re-
cherches pour savoir s’il arrivait à l’archiduchesse
Isabelle de signer autrement que de ce nom, et si
on la vit adopter jamais dans sa signature le nom
d’Élisabeth, qui était, en définitive, le sien, tout
aussi bien que l’autre.
Il n’y aurait rien d’étonnant, au surplus. La
fixité de l’orthographe des noms, des prénoms
surtout, devait être, au xvie siècle, considérée
comme une chose d’une importance bien relative,
si l’on en juge par les variations que ces noms
subissent, pour une même personne, sous la plume
BULLETIN DES MUSEES ROYAUX
l’on trouve fréquemment les deux noms appliqués
indifféremment à la même personne. Ce fut le cas
notamment pour la sœur de Charles-Quint, mariée
au roi Christian de Danemark et appelée tantôt
Isabelle, tantôt Élisabeth d’Autriche. Mais, en ce
qui concerne notre archiduchesse, l’appellation
d’Isabelle fut tellement dominante qu’il pourrait
sembler étrange qu’on s’en fût départi dans une
occasion comme
celle-ci. Seulement,
il existe un témoi-
gnage montrant que,
vers le début de son
règne, c’est-à-dire au
moment où se place
la confection de la
dentelle qui nous
occupe, on donnait,
à Bruxelles même, le
nom d'Elisabeth à la
fille de Philippe IL
Il est dit, en effet,
dans la Relation de
l'Entrée de l'Archi-
duc Albert à Bruxel-
les, le 11 février 1596,
qu’un arc de triom-
phe avait été dressé
près de la Monnaie et
que le roi Philippe
s’y trouvait repré-
senté, ayant, à droite,
le prince Philippe,
son fils, à gauche, sa
fille Elisabeth (filiam
Elisabetham). Il était d’ailleurs foit naturel d’em-
ployer à Bruxelles cette forme du Nord, plutôt que
la forme plus méridionale d’Isabelle. Celle-ci finit,
il est vrai, par prévaloir ; mais il pouvait ne pas
en être ainsi dès l’arrivée de la princesse dans les
Pays-Bas. »
Cette dernière réflexion nous paraît toujours
fondée. Il importe cependant de faire remarquer,
en ce qui concerne l’inscription invoquée, que la
version Élisabeth s’expliquerait déjà par le fait
qu’il s'agit d’une inscription latine. C’est, en effet,
une règle assez constante, pensons-nous, d’em-
ployer la forme Elisabeth quand il s’agit de tra-
duire Isabelle en latin. On y eut recours, dans ce
cas, pour des personnes qu’on n’appela jamais
Elisabeth en dehors de là. C’est ainsi, comme nous
l’apprenait, ces jours derniers, M. Paul De Mot,
que le nom Èlisabetha est inscrit à l’Escurial
sur le tombeau d’Isabelle II, grand’mère du roi
Alphonse XIII.
Cette circonstance ne fait d’ailleurs que prouver
une fois de plus à quel point Isabelle et Élisabeth
sont des synonymes.
L’association des deux noms, Albert et Isabelle,
dans le monogramme dont il vient d’être parlé,
nous amène à rappeler l’habitude qu’avait, de son
côté, l’archiduchesse d’associer à son nom celui de
son mari dans la signature de sa correspondance.
On possède d’elle de
nombreuses lettres
autographes signées
invariablement :
A. Isabel. Les con-
servateurs de nos ar-
chives pourraient
nous dire à quel point
cette même pratique
se trouvait observée
dans la signature des
actes publics. C’était
certainement là une
marque d’attache-
ment, que suffirait à
expliquer l’extrême
affection d’Isabelle
pour son époux. Il ne
faudrait pas croire
cependant qu’elle fût
spéciale à l’archidu-
chesse, ni qu’elle eût
été imaginée par
celle-ci. C’était, en
Espagne, un antique
usage que les femmes
fissent précéder leur
nom de l’initiale du nom de leur mari; et Isabelle
ne fit, en somme, que se conformer à cette tradi-
tion .
Par une délicate réciprocité, Albert, à son tour,
signait Is. Albert. Il ne nous a pas été donné de
pouvoir vérifier le degré de fréquence qu’il mit
à cette manière d'hommage. C’est de nouveau
là un point sur lequel les archivistes pourront
nous éclairer.
Nous faisons encore appel à leurs patientes re-
cherches pour savoir s’il arrivait à l’archiduchesse
Isabelle de signer autrement que de ce nom, et si
on la vit adopter jamais dans sa signature le nom
d’Élisabeth, qui était, en définitive, le sien, tout
aussi bien que l’autre.
Il n’y aurait rien d’étonnant, au surplus. La
fixité de l’orthographe des noms, des prénoms
surtout, devait être, au xvie siècle, considérée
comme une chose d’une importance bien relative,
si l’on en juge par les variations que ces noms
subissent, pour une même personne, sous la plume