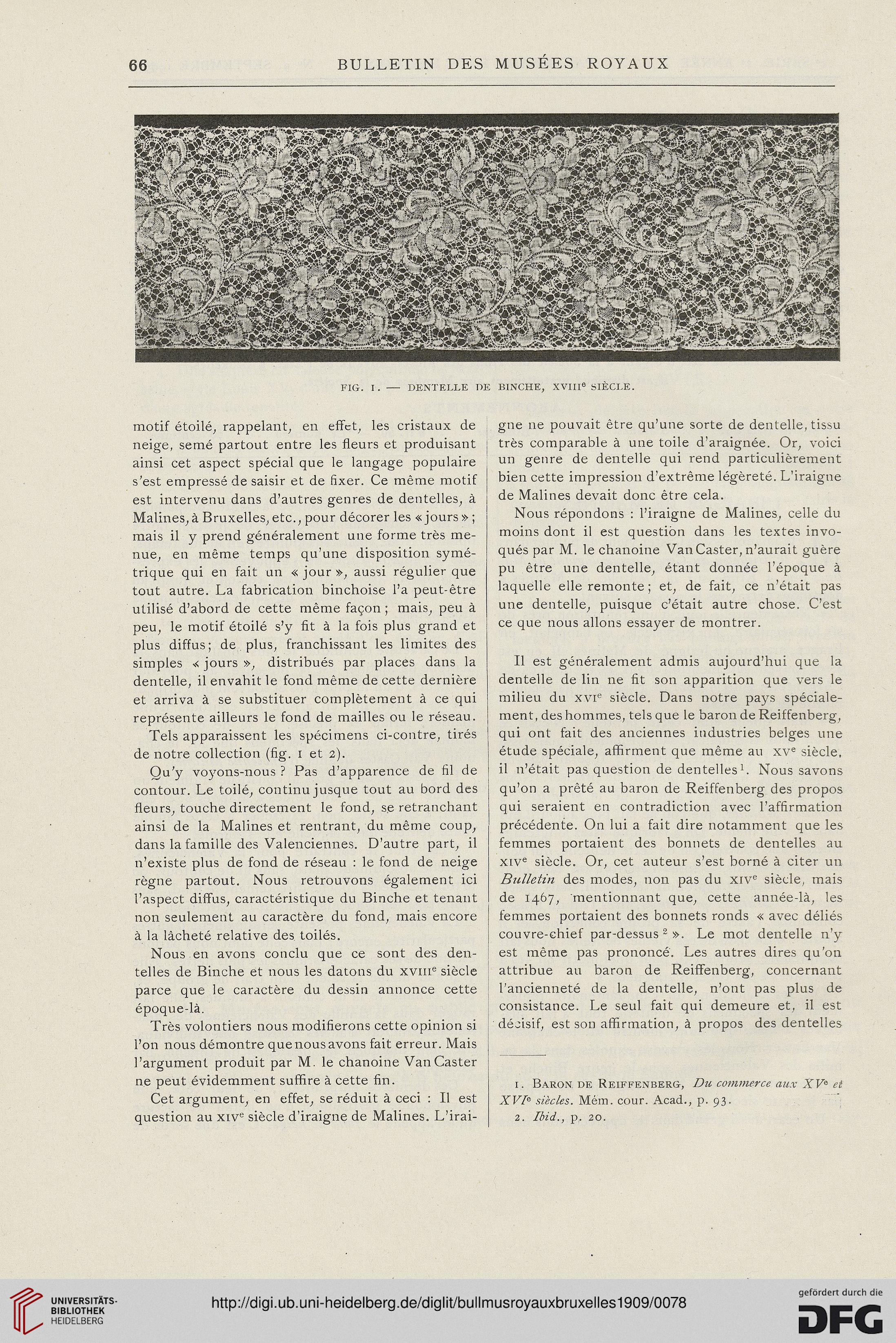66
BULLETIN DES MUSÉES ROYAUX
FIG. I. - DENTELLE DE BINCHE, XVIIIe SIÈCLE.
motif étoilé, rappelant, en effet, les cristaux de
neige, semé partout entre les fleurs et produisant
ainsi cet aspect spécial que le langage populaire
s’est empressé de saisir et de fixer. Ce même motif
est intervenu dans d’autres genres de dentelles, à
Malines,à Bruxelles, etc., pour décorer les «jours » ;
mais il y prend généralement une forme très me-
nue, en même temps qu’une disposition symé-
trique qui en fait un « jour », aussi régulier que
tout autre. La fabrication binchoise l’a peut-être
utilisé d’abord de cette même façon ; mais, peu à
peu, le motif étoilé s’y fit à la fois plus grand et
plus diffus; de plus, franchissant les limites des
simples « jours », distribués par places dans la
dentelle, il envahit le fond même de cette dernière
et arriva à se substituer complètement à ce qui
représente ailleurs le fond de mailles ou le réseau.
Tels apparaissent les spécimens ci-contre, tirés
de notre collection (fig. i et 2).
Qu'y voyons-nous ? Pas d’apparence de fil de
contour. Le toilé, continu jusque tout au bord des
fleurs, touche directement le fond, se retranchant
ainsi de la Malines et rentrant, du même coup,
dans la famille des Valenciennes. D’autre part, il
n’existe plus de fond de réseau : le fond de neige
règne partout. Nous retrouvons également ici
l’aspect diffus, caractéristique du Binche et tenant
non seulement au caractère du fond, mais encore
à la lâcheté relative des toilés.
Nous en avons conclu que ce sont des den-
telles de Binche et nous les datons du xvme siècle
parce que le caractère du dessin annonce cette
époque-là.
Très volontiers nous modifierons cette opinion si
l’on nous démontre que nous avons fait erreur. Mais
l’argument produit par M. le chanoine VanCaster
ne peut évidemment suffire à cette fin.
Cet argument, en effet, se réduit à ceci : Il est
question au xive siècle d’iraigne de Malines. L’irai-
gne ne pouvait être qu’une sorte de dentelle, tissu
très comparable à une toile d’araignée. Or, voici
un genre de dentelle qui rend particulièrement
bien cette impression d’extrême légèreté. L’iraigne
de Malines devait donc être cela.
Nous répondons : l’iraigne de Malines, celle du
moins dont il est question dans les textes invo-
qués par M. le chanoine VanCaster, n’aurait guère
pu être une dentelle, étant donnée l’époque à
laquelle elle remonte ; et, de fait, ce n’était pas
une dentelle, puisque c’était autre chose. C’est
ce que nous allons essayer de montrer.
Il est généralement admis aujourd’hui que la
dentelle de lin ne fit son apparition que vers le
milieu du xvie siècle. Dans notre pays spéciale-
ment, des hommes, tels que le baron de Reiffenberg,
qui ont fait des anciennes industries belges une
étude spéciale, affirment que même au xve siècle,
il n’était pas question de dentelles1. Nous savons
qu’on a prêté au baron de Reiffenberg des propos
qui seraient en contradiction avec l’affirmation
précédente. On lui a fait dire notamment que les
femmes portaient des bonnets de dentelles au
xive siècle. Or, cet auteur s’est borné à citer un
Bulletin des modes, non pas du xive siècle, mais
de 1467, mentionnant que, cette année-là, les
femmes portaient des bonnets ronds « avec déliés
couvre-chief par-dessus2». Le mot dentelle n’y
est même pas prononcé. Les autres dires qu’on
attribue au baron de Reiffenberg, concernant
l’ancienneté de la dentelle, n’ont pas plus de
consistance. Le seul fait qui demeure et, il est
décisif, est son affirmation, à propos des dentelles
1. Baron, de Reiffenberg, Du commerce aux XVe et
XVIe siècles. Mèm. cour. Acad., p. 93.
2. Ibid.., p. 20.
BULLETIN DES MUSÉES ROYAUX
FIG. I. - DENTELLE DE BINCHE, XVIIIe SIÈCLE.
motif étoilé, rappelant, en effet, les cristaux de
neige, semé partout entre les fleurs et produisant
ainsi cet aspect spécial que le langage populaire
s’est empressé de saisir et de fixer. Ce même motif
est intervenu dans d’autres genres de dentelles, à
Malines,à Bruxelles, etc., pour décorer les «jours » ;
mais il y prend généralement une forme très me-
nue, en même temps qu’une disposition symé-
trique qui en fait un « jour », aussi régulier que
tout autre. La fabrication binchoise l’a peut-être
utilisé d’abord de cette même façon ; mais, peu à
peu, le motif étoilé s’y fit à la fois plus grand et
plus diffus; de plus, franchissant les limites des
simples « jours », distribués par places dans la
dentelle, il envahit le fond même de cette dernière
et arriva à se substituer complètement à ce qui
représente ailleurs le fond de mailles ou le réseau.
Tels apparaissent les spécimens ci-contre, tirés
de notre collection (fig. i et 2).
Qu'y voyons-nous ? Pas d’apparence de fil de
contour. Le toilé, continu jusque tout au bord des
fleurs, touche directement le fond, se retranchant
ainsi de la Malines et rentrant, du même coup,
dans la famille des Valenciennes. D’autre part, il
n’existe plus de fond de réseau : le fond de neige
règne partout. Nous retrouvons également ici
l’aspect diffus, caractéristique du Binche et tenant
non seulement au caractère du fond, mais encore
à la lâcheté relative des toilés.
Nous en avons conclu que ce sont des den-
telles de Binche et nous les datons du xvme siècle
parce que le caractère du dessin annonce cette
époque-là.
Très volontiers nous modifierons cette opinion si
l’on nous démontre que nous avons fait erreur. Mais
l’argument produit par M. le chanoine VanCaster
ne peut évidemment suffire à cette fin.
Cet argument, en effet, se réduit à ceci : Il est
question au xive siècle d’iraigne de Malines. L’irai-
gne ne pouvait être qu’une sorte de dentelle, tissu
très comparable à une toile d’araignée. Or, voici
un genre de dentelle qui rend particulièrement
bien cette impression d’extrême légèreté. L’iraigne
de Malines devait donc être cela.
Nous répondons : l’iraigne de Malines, celle du
moins dont il est question dans les textes invo-
qués par M. le chanoine VanCaster, n’aurait guère
pu être une dentelle, étant donnée l’époque à
laquelle elle remonte ; et, de fait, ce n’était pas
une dentelle, puisque c’était autre chose. C’est
ce que nous allons essayer de montrer.
Il est généralement admis aujourd’hui que la
dentelle de lin ne fit son apparition que vers le
milieu du xvie siècle. Dans notre pays spéciale-
ment, des hommes, tels que le baron de Reiffenberg,
qui ont fait des anciennes industries belges une
étude spéciale, affirment que même au xve siècle,
il n’était pas question de dentelles1. Nous savons
qu’on a prêté au baron de Reiffenberg des propos
qui seraient en contradiction avec l’affirmation
précédente. On lui a fait dire notamment que les
femmes portaient des bonnets de dentelles au
xive siècle. Or, cet auteur s’est borné à citer un
Bulletin des modes, non pas du xive siècle, mais
de 1467, mentionnant que, cette année-là, les
femmes portaient des bonnets ronds « avec déliés
couvre-chief par-dessus2». Le mot dentelle n’y
est même pas prononcé. Les autres dires qu’on
attribue au baron de Reiffenberg, concernant
l’ancienneté de la dentelle, n’ont pas plus de
consistance. Le seul fait qui demeure et, il est
décisif, est son affirmation, à propos des dentelles
1. Baron, de Reiffenberg, Du commerce aux XVe et
XVIe siècles. Mèm. cour. Acad., p. 93.
2. Ibid.., p. 20.