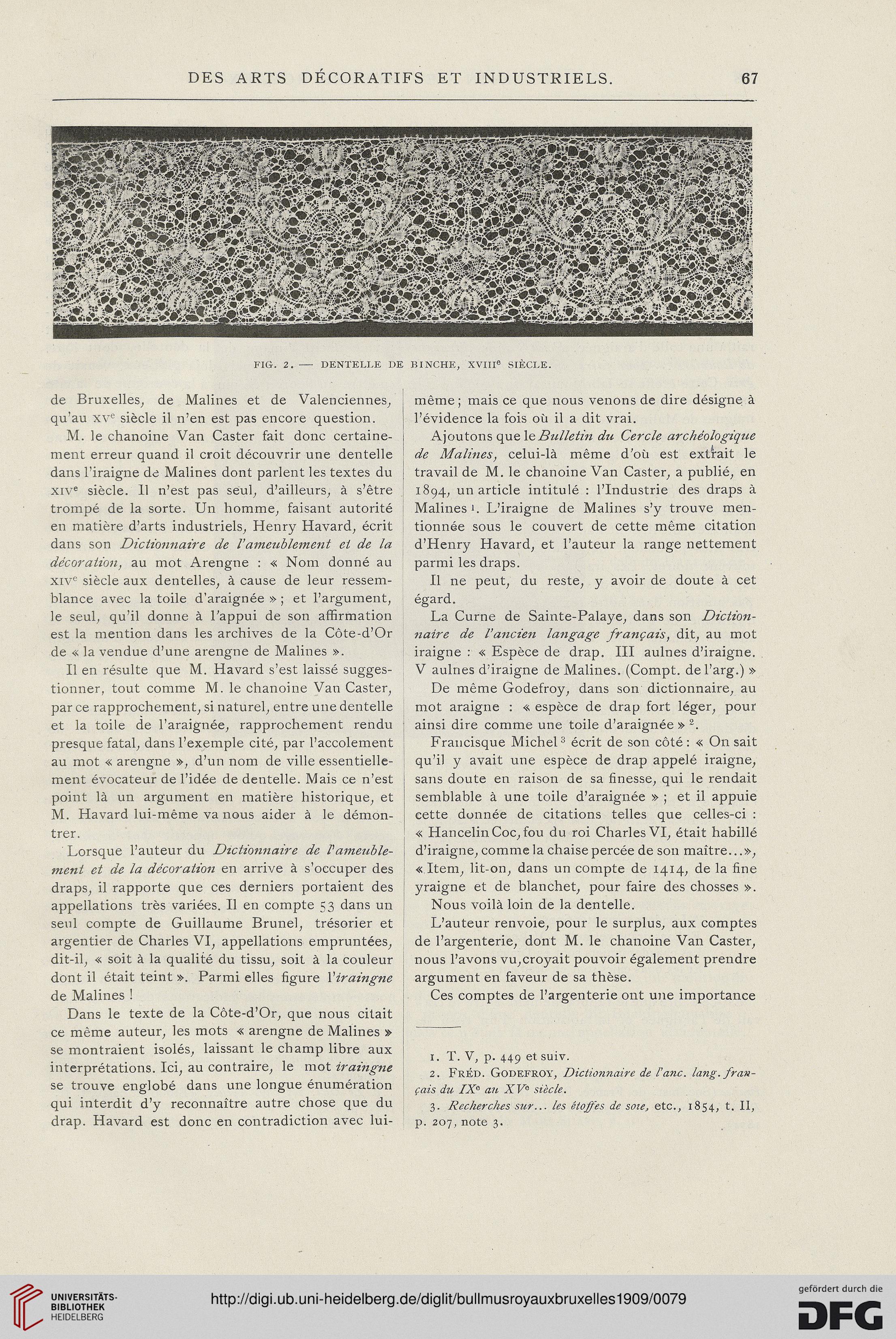DES ARTS DÉCORATIFS ET INDUSTRIELS.
67
-v< »•«•>•»*..%•
ràâ^jmfâjXlKiiâSbt#.
ÏP^Zk
FIG. 2. - DENTELLE DE BINCHE, XVIIIe SIÈCLE.
de Bruxelles, de Malines et de Valenciennes,
qu’au xve siècle il n’en est pas encore question.
M. le chanoine Van Caster fait donc certaine-
ment erreur quand il croit découvrir une dentelle
dans l’iraigne de Malines dont parlent les textes du
xive siècle. 11 n’est pas seul, d’ailleurs, à s’être
trompé de la sorte. Un homme, faisant autorité
en matière d’arts industriels, Henry Havard, écrit
dans son Dictionnaire de l’ameublement et de la
décoration, au mot Arengne : « Nom donné au
xive siècle aux dentelles, à cause de leur ressem-
blance avec la toile d'araignée » ; et l’argument,
le seul, qu’il donne à l’appui de son affirmation
est la mention dans les archives de la Côte-d’Or
de « la vendue d’une arengne de Malines ».
Il en résulte que M. Havard s’est laissé sugges-
tionner, tout comme M. le chanoine Van Caster,
par ce rapprochement, si naturel, entre une dentelle
et la toile de l’araignée, rapprochement rendu
presque fatal, dans l’exemple cité, par l’accolement
au mot « arengne », d’un nom de ville essentielle-
ment évocateur de l’idée de dentelle. Mais ce n’est
point là un argument en matière historique, et
M. Havard lui-même va nous aider à le démon-
trer.
Lorsque l’auteur du Dictionnaire de /’ameuble-
ment et de la décoration en arrive à s’occuper des
draps, il rapporte que ces derniers portaient des
appellations très variées. Il en compte 53 dans un
seul compte de Guillaume Brunei, trésorier et
argentier de Charles VI, appellations empruntées,
dit-il, « soit à la qualité du tissu, soit à la couleur
dont il était teint ». Parmi elles figure l'iraingne
de Malines !
Dans le texte de la Côte-d’Or, que nous citait
ce même auteur, les mots « arengne de Malines »
se montraient isolés, laissant le champ libre aux
interprétations. Ici, au contraire, le mot iraingne
se trouve englobé dans une longue énumération
qui interdit d’y reconnaître autre chose que du
drap. Havard est donc en contradiction avec lui-
même ; mais ce que nous venons de dire désigne à
l’évidence la fois où il a dit vrai.
Ajoutons quel ^Bulletin du Cercle archéologique
de Malines, celui-là même d’où est extrait le
travail de M. le chanoine Van Caster, a publié, en
1894, un article intitulé : l’Industrie des draps à
Malines 1. L’iraigne de Malines s’y trouve men-
tionnée sous le couvert de cette même citation
d’Henry Havard, et l’auteur la range nettement
parmi les draps.
Il ne peut, du reste, y avoir de doute à cet
égard.
La Curne de Sainte-Palaye, dans son Diction-
naire de l’ancien langage français, dit, au mot
iraigne : « Espèce de drap. III aulnes d’iraigne.
V aulnes d’iraigne de Malines. (Compt. del’arg.) »
De même Godefroy, dans son dictionnaire, au
mot araigne : « espèce de drap fort léger, pour
ainsi dire comme une toile d’araignée » 2.
Francisque Michel3 écrit de son côté: « On sait
qu’il y avait une espèce de drap appelé iraigne,
sans doute en raison de sa finesse, qui le rendait
semblable à une toile d’araignée » ; et il appuie
cette donnée de citations telles que celles-ci :
« HancelinCoc, fou du roi Charles VI, était habillé
d’iraigne, comme la chaise percée de son maître..
« Item, lit-on, dans un compte de 1414, de la fine
yraigne et de blanchet, pour faire des chosses ».
Nous voilà loin de la dentelle.
L’auteur renvoie, pour le surplus, aux comptes
de l’argenterie, dont M. le chanoine Van Caster,
nous l’avons vu,croyait pouvoir également prendre
argument en faveur de sa thèse.
Ces comptes de l’argenterie ont une importance
1. T. V, p. 449 et suiv.
2. Fréd. Godefroy, Dictionnaire de l’anc. long. fran-
çais du IXe au XVe siècle.
3. Recherches sur... les étoffes de soie, etc., 1854, t. II,
p. 207, note 3.
67
-v< »•«•>•»*..%•
ràâ^jmfâjXlKiiâSbt#.
ÏP^Zk
FIG. 2. - DENTELLE DE BINCHE, XVIIIe SIÈCLE.
de Bruxelles, de Malines et de Valenciennes,
qu’au xve siècle il n’en est pas encore question.
M. le chanoine Van Caster fait donc certaine-
ment erreur quand il croit découvrir une dentelle
dans l’iraigne de Malines dont parlent les textes du
xive siècle. 11 n’est pas seul, d’ailleurs, à s’être
trompé de la sorte. Un homme, faisant autorité
en matière d’arts industriels, Henry Havard, écrit
dans son Dictionnaire de l’ameublement et de la
décoration, au mot Arengne : « Nom donné au
xive siècle aux dentelles, à cause de leur ressem-
blance avec la toile d'araignée » ; et l’argument,
le seul, qu’il donne à l’appui de son affirmation
est la mention dans les archives de la Côte-d’Or
de « la vendue d’une arengne de Malines ».
Il en résulte que M. Havard s’est laissé sugges-
tionner, tout comme M. le chanoine Van Caster,
par ce rapprochement, si naturel, entre une dentelle
et la toile de l’araignée, rapprochement rendu
presque fatal, dans l’exemple cité, par l’accolement
au mot « arengne », d’un nom de ville essentielle-
ment évocateur de l’idée de dentelle. Mais ce n’est
point là un argument en matière historique, et
M. Havard lui-même va nous aider à le démon-
trer.
Lorsque l’auteur du Dictionnaire de /’ameuble-
ment et de la décoration en arrive à s’occuper des
draps, il rapporte que ces derniers portaient des
appellations très variées. Il en compte 53 dans un
seul compte de Guillaume Brunei, trésorier et
argentier de Charles VI, appellations empruntées,
dit-il, « soit à la qualité du tissu, soit à la couleur
dont il était teint ». Parmi elles figure l'iraingne
de Malines !
Dans le texte de la Côte-d’Or, que nous citait
ce même auteur, les mots « arengne de Malines »
se montraient isolés, laissant le champ libre aux
interprétations. Ici, au contraire, le mot iraingne
se trouve englobé dans une longue énumération
qui interdit d’y reconnaître autre chose que du
drap. Havard est donc en contradiction avec lui-
même ; mais ce que nous venons de dire désigne à
l’évidence la fois où il a dit vrai.
Ajoutons quel ^Bulletin du Cercle archéologique
de Malines, celui-là même d’où est extrait le
travail de M. le chanoine Van Caster, a publié, en
1894, un article intitulé : l’Industrie des draps à
Malines 1. L’iraigne de Malines s’y trouve men-
tionnée sous le couvert de cette même citation
d’Henry Havard, et l’auteur la range nettement
parmi les draps.
Il ne peut, du reste, y avoir de doute à cet
égard.
La Curne de Sainte-Palaye, dans son Diction-
naire de l’ancien langage français, dit, au mot
iraigne : « Espèce de drap. III aulnes d’iraigne.
V aulnes d’iraigne de Malines. (Compt. del’arg.) »
De même Godefroy, dans son dictionnaire, au
mot araigne : « espèce de drap fort léger, pour
ainsi dire comme une toile d’araignée » 2.
Francisque Michel3 écrit de son côté: « On sait
qu’il y avait une espèce de drap appelé iraigne,
sans doute en raison de sa finesse, qui le rendait
semblable à une toile d’araignée » ; et il appuie
cette donnée de citations telles que celles-ci :
« HancelinCoc, fou du roi Charles VI, était habillé
d’iraigne, comme la chaise percée de son maître..
« Item, lit-on, dans un compte de 1414, de la fine
yraigne et de blanchet, pour faire des chosses ».
Nous voilà loin de la dentelle.
L’auteur renvoie, pour le surplus, aux comptes
de l’argenterie, dont M. le chanoine Van Caster,
nous l’avons vu,croyait pouvoir également prendre
argument en faveur de sa thèse.
Ces comptes de l’argenterie ont une importance
1. T. V, p. 449 et suiv.
2. Fréd. Godefroy, Dictionnaire de l’anc. long. fran-
çais du IXe au XVe siècle.
3. Recherches sur... les étoffes de soie, etc., 1854, t. II,
p. 207, note 3.