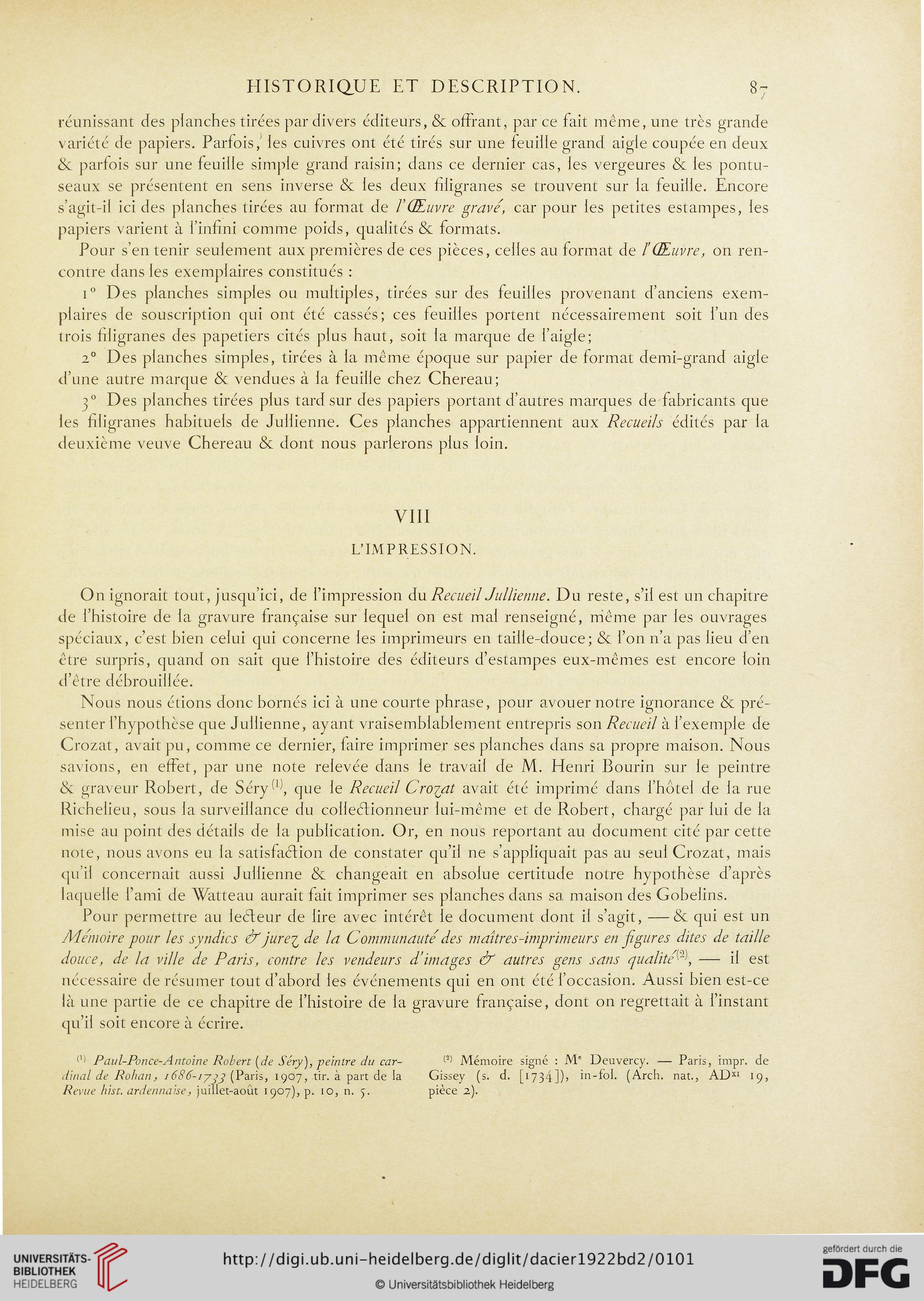HISTORIQUE ET DESCRIPTION.
87
réunissant des planches tirées par divers éditeurs, & offrant, par ce fait même, une très grande
variété de papiers. Parfois, les cuivres ont été tirés sur une feuille grand aigle coupée en deux
& parfois sur une feuille simple grand raisin; dans ce dernier cas, les vergeures & les pontu-
seaux se présentent en sens inverse & les deux filigranes se trouvent sur la feuille. Encore
s’agit-il ici des planches tirées au format de l’Œuvre grave, car pour les petites estampes, les
papiers varient à l’infini comme poids, qualités & formats.
Pour s’en tenir seulement aux premières de ces pièces, celles au format de l’Œuvre, on ren-
contre dans les exemplaires constitués :
i° Des planches simples ou multiples, tirées sur des feuilles provenant d’anciens exem-
plaires de souscription qui ont été cassés; ces feuilles portent nécessairement soit l’un des
trois filigranes des papetiers cités plus haut, soit la marque de l’aigle;
20 Des planches simples, tirées à la même époque sur papier de format demi-grand aigle
d’une autre marque & vendues à la feuille chez Chereau;
30 Des planches tirées plus tard sur des papiers portant d’autres marques de fabricants que
les filigranes habituels de Jullienne. Ces planches appartiennent aux Recueils édités par la
deuxième veuve Chereau & dont nous parlerons plus loin.
VIII
L’IMPRESSION.
On ignorait tout, jusqu’ici, de l’impression du Recueil Jullienne. Du reste, s’il est un chapitre
de l’histoire de la gravure française sur lequel on est mal renseigné, même par les ouvrages
spéciaux, c’est bien celui qui concerne les imprimeurs en taille-douce; & l’on n’a pas lieu d’en
être surpris, quand on sait que l’histoire des éditeurs d’estampes eux-mêmes est encore loin
d’être débrouillée.
Nous nous étions donc bornés ici à une courte phrase, pour avouer notre ignorance «Se pré-
senter l’hypothèse que Jullienne, ayant vraisemblablement entrepris son Recueil à l’exemple de
Crozat, avait pu, comme ce dernier, faire imprimer ses planches dans sa propre maison. Nous
savions, en effet, par une note relevée dans le travail de M. Henri Bourin sur le peintre
& graveur Robert, de SéryT, que le Recueil Crozat avait été imprimé dans l’hôtel de la rue
Richelieu, sous la surveillance du colleétionneur lui-même et de Robert, chargé par lui de la
mise au point des détails de la publication. Or, en nous reportant au document cité par cette
note, nous avons eu la satisfaction de constater qu’il ne s’appliquait pas au seul Crozat, mais
qu’il concernait aussi Jullienne & changeait en absolue certitude notre hypothèse d’après
laquelle l’ami de Watteau aurait fait imprimer ses planches dans sa maison des Gobeiins.
Pour permettre au iedteur de lire avec intérêt le document dont il s’agit, —& qui est un
/Mémoire pour les syndics & jure£ de la Cdmmunaute des maîtres-imprimeurs en figures dites de taille
douce, de la ville de Paris, contre les vendeurs d’images & autres gens sans qualité^, — il est
nécessaire de résumer tout d’abord les événements qui en ont été l’occasion. Aussi bien est-ce
là une partie de ce chapitre de l’histoire de la gravure française, dont on regrettait à l’instant
qu’il soit encore à écrire.
(1) Paul-Ponce-Antoine Robert (de Séry), -peintre du car-
dinal de Rohan, 1686-1703 (Paris, 1907, tir. à part de la
Revue hist. ardennaise, juillet-août 1907), p. 10, n. 5.
Mémoire signé : M' Deuvercy. — Paris, intpr. de
Gissey (s. d. [1734]), in-fol. (Arch. nat., ADXI 19,
pièce 2).
87
réunissant des planches tirées par divers éditeurs, & offrant, par ce fait même, une très grande
variété de papiers. Parfois, les cuivres ont été tirés sur une feuille grand aigle coupée en deux
& parfois sur une feuille simple grand raisin; dans ce dernier cas, les vergeures & les pontu-
seaux se présentent en sens inverse & les deux filigranes se trouvent sur la feuille. Encore
s’agit-il ici des planches tirées au format de l’Œuvre grave, car pour les petites estampes, les
papiers varient à l’infini comme poids, qualités & formats.
Pour s’en tenir seulement aux premières de ces pièces, celles au format de l’Œuvre, on ren-
contre dans les exemplaires constitués :
i° Des planches simples ou multiples, tirées sur des feuilles provenant d’anciens exem-
plaires de souscription qui ont été cassés; ces feuilles portent nécessairement soit l’un des
trois filigranes des papetiers cités plus haut, soit la marque de l’aigle;
20 Des planches simples, tirées à la même époque sur papier de format demi-grand aigle
d’une autre marque & vendues à la feuille chez Chereau;
30 Des planches tirées plus tard sur des papiers portant d’autres marques de fabricants que
les filigranes habituels de Jullienne. Ces planches appartiennent aux Recueils édités par la
deuxième veuve Chereau & dont nous parlerons plus loin.
VIII
L’IMPRESSION.
On ignorait tout, jusqu’ici, de l’impression du Recueil Jullienne. Du reste, s’il est un chapitre
de l’histoire de la gravure française sur lequel on est mal renseigné, même par les ouvrages
spéciaux, c’est bien celui qui concerne les imprimeurs en taille-douce; & l’on n’a pas lieu d’en
être surpris, quand on sait que l’histoire des éditeurs d’estampes eux-mêmes est encore loin
d’être débrouillée.
Nous nous étions donc bornés ici à une courte phrase, pour avouer notre ignorance «Se pré-
senter l’hypothèse que Jullienne, ayant vraisemblablement entrepris son Recueil à l’exemple de
Crozat, avait pu, comme ce dernier, faire imprimer ses planches dans sa propre maison. Nous
savions, en effet, par une note relevée dans le travail de M. Henri Bourin sur le peintre
& graveur Robert, de SéryT, que le Recueil Crozat avait été imprimé dans l’hôtel de la rue
Richelieu, sous la surveillance du colleétionneur lui-même et de Robert, chargé par lui de la
mise au point des détails de la publication. Or, en nous reportant au document cité par cette
note, nous avons eu la satisfaction de constater qu’il ne s’appliquait pas au seul Crozat, mais
qu’il concernait aussi Jullienne & changeait en absolue certitude notre hypothèse d’après
laquelle l’ami de Watteau aurait fait imprimer ses planches dans sa maison des Gobeiins.
Pour permettre au iedteur de lire avec intérêt le document dont il s’agit, —& qui est un
/Mémoire pour les syndics & jure£ de la Cdmmunaute des maîtres-imprimeurs en figures dites de taille
douce, de la ville de Paris, contre les vendeurs d’images & autres gens sans qualité^, — il est
nécessaire de résumer tout d’abord les événements qui en ont été l’occasion. Aussi bien est-ce
là une partie de ce chapitre de l’histoire de la gravure française, dont on regrettait à l’instant
qu’il soit encore à écrire.
(1) Paul-Ponce-Antoine Robert (de Séry), -peintre du car-
dinal de Rohan, 1686-1703 (Paris, 1907, tir. à part de la
Revue hist. ardennaise, juillet-août 1907), p. 10, n. 5.
Mémoire signé : M' Deuvercy. — Paris, intpr. de
Gissey (s. d. [1734]), in-fol. (Arch. nat., ADXI 19,
pièce 2).