Note: This is an additional scan to display the colour reference chart and scalebar.
0.5
1 cm
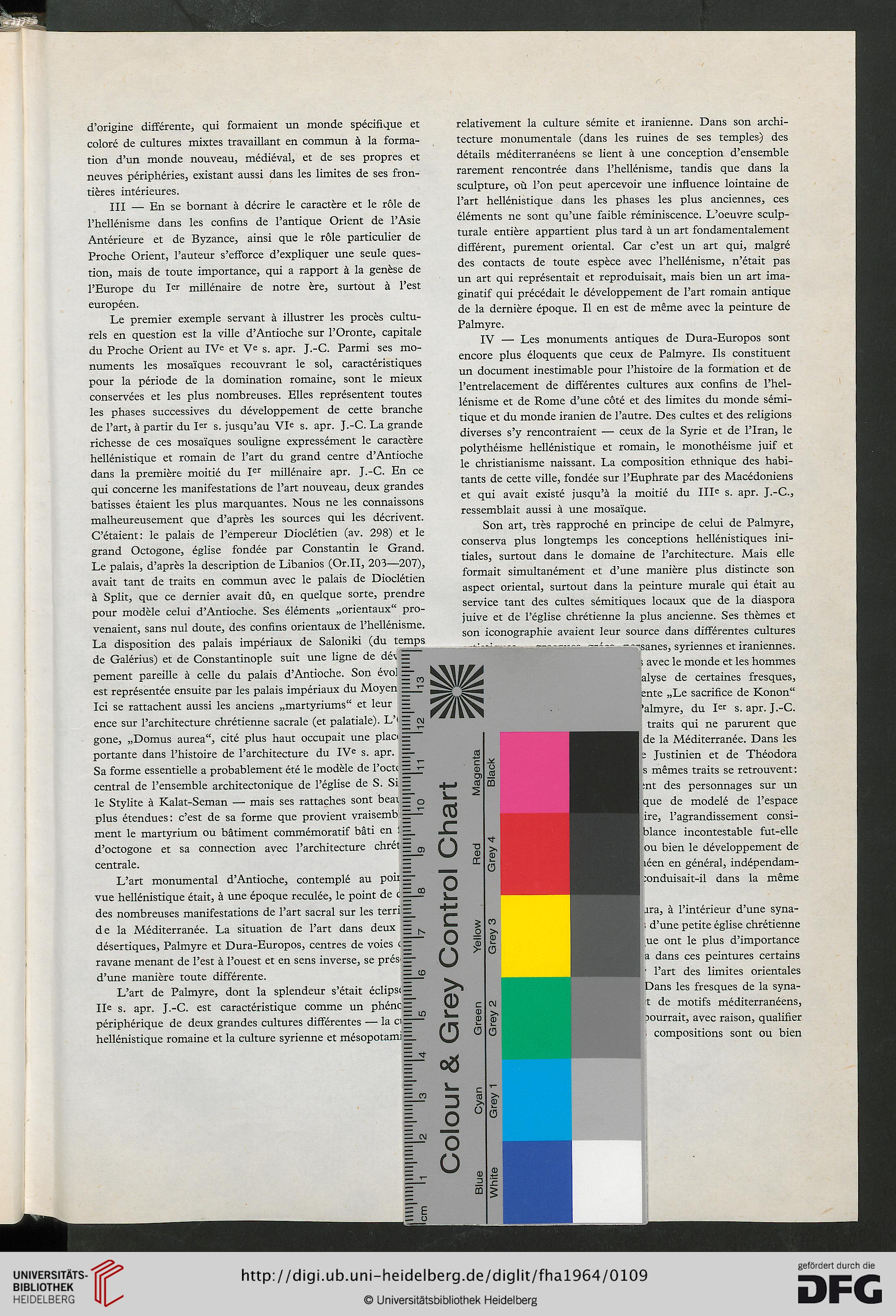
cTorigine differente, qui formaient un monde specifiąue et relativement la culture semite et iranienne. Dans son archi-
colore de cultures mixtes travaillant en commun a la forma- tecture monumentale (dans les ruines de ses temples) des
tion d'un monde nouveau, medieval, et de ses propres et details mediterraneens se lient a une conception d'ensemble
neuves peripheries, existant aussi dans les limites de ses fron- rarement rencontree dans Phellenisme, tandis que dans la
tieres interieures. sculpture, ou 1'on peut apercevoir une influence lointaine de
III — En se bornant a decrire le caractere et le róle de l'art hellenistiąue dans les phases les plus anciennes, ces
Phellenisme dans les confins de l'antique Orient de l'Asie elements ne sont qu'une faible reminiscence. L'oeuvre sculp-
Anterieure et de Byzance, ainsi que le róle particulier de turale entifere appartient plus tard a un art fondamentalement
Proche Orient, 1'auteur s'efforce d'expliquer une seule ques- different, purement oriental. Car c'est un art qui5 malgre
. , . . . , , . , des contacts de toute espece avec Phellenisme, n'etait pas
tion, mais de toute importance, qui a rapport a la genese de *
.„, . - , , ,, un art qui representait et reproduisait, mais bien un art rma-
PEurope du Ier millenaire de notre ere, surtout a lest . i ,
ginanf qui precedait le developpement de Part romam antique
europeen.
Le premier exemple servant a illustrer les proces cultu-
rels en question est la ville d'Antioche sur POronte, capitale
, „ , „ . t^Tir t^t,- IV — Les monuments antiques de Dura-Europos sont
du Proche Orient au IVe et Ve s. apr. J.-C. Parmi ses mo- .
de la derniere epoque. II en est de meme avec la peinture de
Palmy re.
numents les mosaiques recouvrant le sol, caractćristiques
pour la periode de la domination romaine, sont le mieux
conservees et les plus nombreuses. Elles representent toutes
les phases successives du developpement de cette branche
de Part, a partir du Ier s. jusqu'au VIe s. apr. J.-C. La grandę
richesse de ces mosa'iques souligne expressement le caractere
hellenistique et romain de Part du grand centrę d'Antioche
dans la premierę moitie du Ier millenaire apr. J.-C. En ce
qui concerne les manifestations de Part nouveau, deux grandes
batisses etaient les plus marquantes. Nous ne les connaissons
malheureusement que d'apres les sources qui les decrivent.
Cetaient: le palais de Pempereur Diocletien (av. 298) et le
,,. .. ,, „•<' < „ , conserva plus longtemps les conceptions hellemstiques mi-
grand Octogone, eghse fondee par Constantin le Grand. . , ^ , , , . , „ , . .
, . , , , . . « t m. •//-> tt ™-> tiales, surtout dans le domaine de 1 arcmtecture. Mais elle
Le palais, d apres la description de Libamos (Or.il, 203—207),
formait simultanement et d une manierę plus distincte son
encore plus eloquents que ceux de Palmyre. Ils constituent
un document inestimable pour Phistoire de la formation et de
Pentrelacement de differentes cultures aux confins de Phel-
lenisme et de Rome d'une cóte et des limites du monde semi-
tique et du monde iranien de Pautre. Des cultes et des religions
diverses s'y rencontraient — ceux de la Syrie et de Piran, le
polytheisme hellenistique et romain, le monotheisme juif et
le christianisme naissant. La composition ethnique des habi-
tants de cette ville, fondee sur PEuphrate par des Macedoniens
et qui avait existe jusqu'a la moitie du IIIe s. apr. J.-C,
ressemblait aussi a une mosa'ique.
Son art, tres rapproche en principe de celui de Palmyre,
avait tant de traits en commun avec le palais de Diocletien
a Split, que ce dernier avait du, en quelque sorte, prendre
pour modele celui d'Antioche. Ses elements „orientaux" pro-
venaient, sans nul doute, des confins orientaux de Phellenisme.
La disposition des palais imperiaux de Saloniki (du temps
de Galerius) et de Constantinople suit une ligne de de\ -
pement pareille a celle du palais dAntiochc. Son evo] ^n S\|^V alvsc dc certaincs fresqueS)
est representee ensuite par les palais imperiaux du Moyen ^jt g, J£ ent£ ^ dg Konon„
lei se rattachent aussi les anciens „martyrmms" et leur 'almyre, du I« s. apr. J.-C.
ence sur Parchitecture chretienne sacrale (et palatiale). L'i = w
gone, „Domus aurea", cite plus haut occupait une płaci -
portante dans Phistoire de Parchitecture du IVe s. apr. =- a
aspect oriental, surtout dans la peinture murale qui etait au
service tant des cultes semitiques locaux que de la diaspora
juive et de Peglise chretienne la plus ancienne. Ses themes et
son iconographie avaient leur source dans differentes cultures
•sanes, syriennes et iraniennes.
i avec le monde et les hommes
Sa formę essentielle a probablement ete le modele de Poctc — r- ^
central de Pensemble architectonique de Peglise de S. Si -
i-
05
le Stylite a Kalat-Seman — mais ses rattaches sont beai;
plus etendues: c'est de sa formę que provient vraisemb. r
ment le martyrium ou batiment commemoratif bati en ) ^_
d'octogone et sa connection avec Parchitecture chret = ro -g
centrale. = £E
L'art monumental d'Antioche, contemple au poii=- q
vue hellenistique etait, a une epoque reculee, le point de c
des nombreuses manifestations de Part sacral sur les terri =_
de la Mediterranee. La situation de Part dans deux = K TT |
desertiques, Palmyre et Dura-Europos, centres de voies <.= ^
ravane menant de Pest a Pouest et en sens inverse, se pres ;
d'une manierę toute differente. -
L'art de Palmyre, dont la splendeur s'etait eclips<E_
IIe s. apr. J.-C. est caracteristique comme un phenc= ^ u/ c
peripherique de deux grandes cultures differentes — la ci:
hellenistique romaine et la culture syrienne et mesopotami:
O
CD
= i—
i 2
^ o
i- O
(D
= E
traits qui ne parurent que
I de la Mediterranee. Dans les
s Justinien et de Theodora
s memes traits se retrouvent:
:nt des personnages sur un
|que de modele de Pespace
I ire, Pagrandissement consi-
blance incontestable fut-elle
ou bien le developpement de
leen en generał, independam-
:onduisait-il dans la meme
ara, a Pinterieur d'une syna-
i d'une petite eglise chretienne
ue ont le plus d'importance
a dans ces peintures certains
' Part des limites orientales
Dans les fresques de la syna-
|t de motifs mediterraneens,
pourrait, avec raison, qualifier
. compositions sont ou bien
colore de cultures mixtes travaillant en commun a la forma- tecture monumentale (dans les ruines de ses temples) des
tion d'un monde nouveau, medieval, et de ses propres et details mediterraneens se lient a une conception d'ensemble
neuves peripheries, existant aussi dans les limites de ses fron- rarement rencontree dans Phellenisme, tandis que dans la
tieres interieures. sculpture, ou 1'on peut apercevoir une influence lointaine de
III — En se bornant a decrire le caractere et le róle de l'art hellenistiąue dans les phases les plus anciennes, ces
Phellenisme dans les confins de l'antique Orient de l'Asie elements ne sont qu'une faible reminiscence. L'oeuvre sculp-
Anterieure et de Byzance, ainsi que le róle particulier de turale entifere appartient plus tard a un art fondamentalement
Proche Orient, 1'auteur s'efforce d'expliquer une seule ques- different, purement oriental. Car c'est un art qui5 malgre
. , . . . , , . , des contacts de toute espece avec Phellenisme, n'etait pas
tion, mais de toute importance, qui a rapport a la genese de *
.„, . - , , ,, un art qui representait et reproduisait, mais bien un art rma-
PEurope du Ier millenaire de notre ere, surtout a lest . i ,
ginanf qui precedait le developpement de Part romam antique
europeen.
Le premier exemple servant a illustrer les proces cultu-
rels en question est la ville d'Antioche sur POronte, capitale
, „ , „ . t^Tir t^t,- IV — Les monuments antiques de Dura-Europos sont
du Proche Orient au IVe et Ve s. apr. J.-C. Parmi ses mo- .
de la derniere epoque. II en est de meme avec la peinture de
Palmy re.
numents les mosaiques recouvrant le sol, caractćristiques
pour la periode de la domination romaine, sont le mieux
conservees et les plus nombreuses. Elles representent toutes
les phases successives du developpement de cette branche
de Part, a partir du Ier s. jusqu'au VIe s. apr. J.-C. La grandę
richesse de ces mosa'iques souligne expressement le caractere
hellenistique et romain de Part du grand centrę d'Antioche
dans la premierę moitie du Ier millenaire apr. J.-C. En ce
qui concerne les manifestations de Part nouveau, deux grandes
batisses etaient les plus marquantes. Nous ne les connaissons
malheureusement que d'apres les sources qui les decrivent.
Cetaient: le palais de Pempereur Diocletien (av. 298) et le
,,. .. ,, „•<' < „ , conserva plus longtemps les conceptions hellemstiques mi-
grand Octogone, eghse fondee par Constantin le Grand. . , ^ , , , . , „ , . .
, . , , , . . « t m. •//-> tt ™-> tiales, surtout dans le domaine de 1 arcmtecture. Mais elle
Le palais, d apres la description de Libamos (Or.il, 203—207),
formait simultanement et d une manierę plus distincte son
encore plus eloquents que ceux de Palmyre. Ils constituent
un document inestimable pour Phistoire de la formation et de
Pentrelacement de differentes cultures aux confins de Phel-
lenisme et de Rome d'une cóte et des limites du monde semi-
tique et du monde iranien de Pautre. Des cultes et des religions
diverses s'y rencontraient — ceux de la Syrie et de Piran, le
polytheisme hellenistique et romain, le monotheisme juif et
le christianisme naissant. La composition ethnique des habi-
tants de cette ville, fondee sur PEuphrate par des Macedoniens
et qui avait existe jusqu'a la moitie du IIIe s. apr. J.-C,
ressemblait aussi a une mosa'ique.
Son art, tres rapproche en principe de celui de Palmyre,
avait tant de traits en commun avec le palais de Diocletien
a Split, que ce dernier avait du, en quelque sorte, prendre
pour modele celui d'Antioche. Ses elements „orientaux" pro-
venaient, sans nul doute, des confins orientaux de Phellenisme.
La disposition des palais imperiaux de Saloniki (du temps
de Galerius) et de Constantinople suit une ligne de de\ -
pement pareille a celle du palais dAntiochc. Son evo] ^n S\|^V alvsc dc certaincs fresqueS)
est representee ensuite par les palais imperiaux du Moyen ^jt g, J£ ent£ ^ dg Konon„
lei se rattachent aussi les anciens „martyrmms" et leur 'almyre, du I« s. apr. J.-C.
ence sur Parchitecture chretienne sacrale (et palatiale). L'i = w
gone, „Domus aurea", cite plus haut occupait une płaci -
portante dans Phistoire de Parchitecture du IVe s. apr. =- a
aspect oriental, surtout dans la peinture murale qui etait au
service tant des cultes semitiques locaux que de la diaspora
juive et de Peglise chretienne la plus ancienne. Ses themes et
son iconographie avaient leur source dans differentes cultures
•sanes, syriennes et iraniennes.
i avec le monde et les hommes
Sa formę essentielle a probablement ete le modele de Poctc — r- ^
central de Pensemble architectonique de Peglise de S. Si -
i-
05
le Stylite a Kalat-Seman — mais ses rattaches sont beai;
plus etendues: c'est de sa formę que provient vraisemb. r
ment le martyrium ou batiment commemoratif bati en ) ^_
d'octogone et sa connection avec Parchitecture chret = ro -g
centrale. = £E
L'art monumental d'Antioche, contemple au poii=- q
vue hellenistique etait, a une epoque reculee, le point de c
des nombreuses manifestations de Part sacral sur les terri =_
de la Mediterranee. La situation de Part dans deux = K TT |
desertiques, Palmyre et Dura-Europos, centres de voies <.= ^
ravane menant de Pest a Pouest et en sens inverse, se pres ;
d'une manierę toute differente. -
L'art de Palmyre, dont la splendeur s'etait eclips<E_
IIe s. apr. J.-C. est caracteristique comme un phenc= ^ u/ c
peripherique de deux grandes cultures differentes — la ci:
hellenistique romaine et la culture syrienne et mesopotami:
O
CD
= i—
i 2
^ o
i- O
(D
= E
traits qui ne parurent que
I de la Mediterranee. Dans les
s Justinien et de Theodora
s memes traits se retrouvent:
:nt des personnages sur un
|que de modele de Pespace
I ire, Pagrandissement consi-
blance incontestable fut-elle
ou bien le developpement de
leen en generał, independam-
:onduisait-il dans la meme
ara, a Pinterieur d'une syna-
i d'une petite eglise chretienne
ue ont le plus d'importance
a dans ces peintures certains
' Part des limites orientales
Dans les fresques de la syna-
|t de motifs mediterraneens,
pourrait, avec raison, qualifier
. compositions sont ou bien



