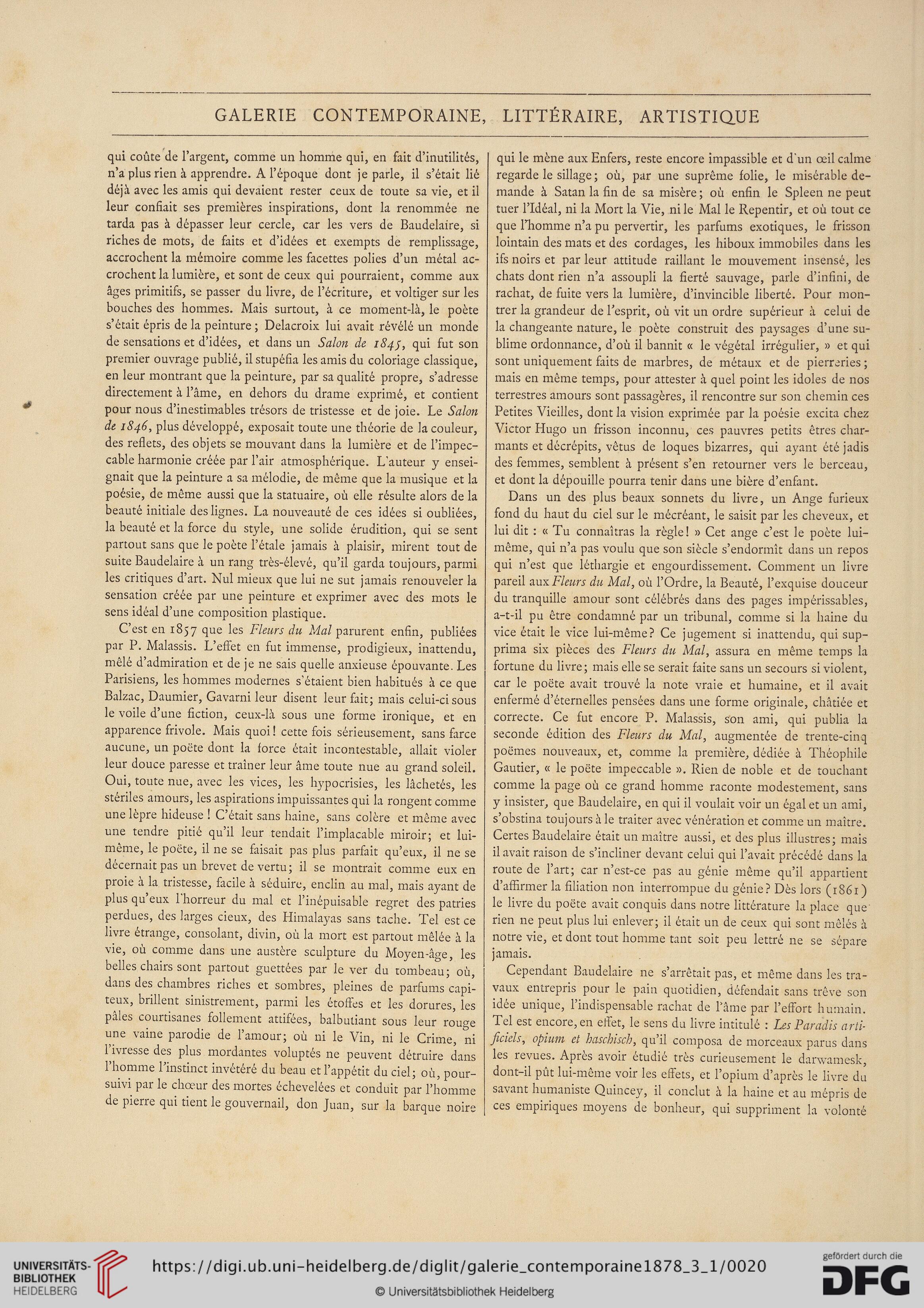GALERIE CONTEMPORAINE, LITTÉRAIRE, ARTISTIQUE
qui coûte de l’argent, comme un homme qui, en fait d’inutilités,
n’a plus rien à apprendre. A l’époque dont je parle, il s’était lié
déjà avec les amis qui devaient rester ceux de toute sa vie, et il
leur confiait ses premières inspirations, dont la renommée ne
tarda pas à dépasser leur cercle, car les vers de Baudelaire, si
riches de mots, de faits et d’idées et exempts de remplissage,
accrochent la mémoire comme les facettes polies d’un métal ac-
crochent la lumière, et sont de ceux qui pourraient, comme aux
âges primitifs, se passer du livre, de l’écriture, et voltiger sur les
bouches des hommes. Mais surtout, à ce moment-là, le poète
s’était épris de la peinture ; Delacroix lui avait révélé un monde
de sensations et d’idées, et dans un Salon de 1845, qui fut son
premier ouvrage publié, il stupéfia les amis du coloriage classique,
en leur montrant que la peinture, par sa qualité propre, s’adresse
directement à l’âme, en dehors du drame exprimé, et contient
pour nous d’inestimables trésors de tristesse et de joie. Le Salon
de 1846, plus développé, exposait toute une théorie de la couleur,
des reflets, des objets se mouvant dans la lumière et de l’impec-
cable harmonie créée par l’air atmosphérique. L’auteur y ensei-
gnait que la peinture a sa mélodie, de même que la musique et la
poésie, de même aussi que la statuaire, où elle résulte alors de la
beauté initiale des lignes. La nouveauté de ces idées si oubliées,
la beauté et la force du style, une solide érudition, qui se sent
partout sans que le poète l’étale jamais à plaisir, mirent tout de
suite Baudelaire à un rang très-élevé, qu’il garda toujours, parmi
les critiques d’art. Nul mieux que lui ne sut jamais renouveler la
sensation créée par une peinture et exprimer avec des mots le
sens idéal d’une composition plastique.
C’est en 1857 que les Fleurs du Mal parurent enfin, publiées
par P. Malassis. L’effet en fut immense, prodigieux, inattendu,
mêlé d’admiration et de je ne sais quelle anxieuse épouvante. Les
Parisiens, les hommes modernes s’étaient bien habitués à ce que
Balzac, Daumier, Gavarni leur disent leur fait; mais celui-ci sous
le voile d’une fiction, ceux-là sous une forme ironique, et en
apparence frivole. Mais quoi ! cette fois sérieusement, sans farce
aucune, un poète dont la force était incontestable, allait violer
leur douce paresse et traîner leur âme toute nue au grand soleil.
Oui, toute nue, avec les vices, les hypocrisies, les lâchetés, les
stériles amours, les aspirations impuissantes qui la rongent comme
une lèpre hideuse ! C’était sans haine, sans colère et même avec
une tendre pitié qu’il leur tendait l’implacable miroir; et lui-
même, le poète, il ne se faisait pas plus parfait qu’eux, il ne se
décernait pas un brevet de vertu ; il se montrait comme eux en
proie à la tristesse, facile à séduire, enclin au mal, mais ayant de
plus qu’eux l'horreur du mal et l’inépuisable regret des patries
perdues, des larges cieux, des Himalayas sans tache. Tel est ce
livre étrange, consolant, divin, où la mort est partout mêlée à la
vie, où comme dans une austère sculpture du Moyen-âge, les
belles chairs sont partout guettées par le ver du tombeau; où,
dans des chambres riches et sombres, pleines de parfums capi-
teux, brillent sinistrement, parmi les étoffes et les dorures, les
pâles courtisanes follement attifées, balbutiant sous leur rouge
une vaine parodie de l’amour; où ni le Vin, ni le Crime, ni
l’ivresse des plus mordantes voluptés ne peuvent détruire dans
l’homme l’instinct invétéré du beau et l’appétit du ciel; où, pour-
suivi par le chœur des mortes échevelées et conduit par l’homme
de pierre qui tient le gouvernail, don Juan, sur la barque noire
qui le mène aux Enfers, reste encore impassible et d'un œil calme
regarde le sillage ; où, par une suprême folie, le misérable de-
mande à Satan la fin de sa misère ; où enfin le Spleen ne peut
tuer l’idéal, ni la Mort la Vie, ni le Mal le Repentir, et où tout ce
que l’homme n’a pu pervertir, les parfums exotiques, le frisson
lointain des mats et des cordages, les hiboux immobiles dans les
ifs noirs et par leur attitude raillant le mouvement insensé, les
chats dont rien n’a assoupli la fierté sauvage, parle d’infini, de
rachat, de fuite vers la lumière, d’invincible liberté. Pour mon-
trer la grandeur de l’esprit, où vit un ordre supérieur à celui de
la changeante nature, le poète construit des paysages d’une su-
blime ordonnance, d’où il bannit « le végétal irrégulier, » et qui
sont uniquement faits de marbres, de métaux et de pierreries ;
mais en même temps, pour attester à quel point les idoles de nos
terrestres amours sont passagères, il rencontre sur son chemin ces
Petites Vieilles, dont la vision exprimée par la poésie excita chez
Victor Hugo un frisson inconnu, ces pauvres petits êtres char-
mants et décrépits, vêtus de loques bizarres, qui ayant été jadis
des femmes, semblent à présent s’en retourner vers le berceau,
et dont la dépouille pourra tenir dans une bière d’enfant.
Dans un des plus beaux sonnets du livre, un Ange furieux
fond du haut du ciel sur le mécréant, le saisit par les cheveux, et
lui dit : « Tu connaîtras la règle! » Cet ange c’est le poète lui-
même, qui n’a pas voulu que son siècle s’endormît dans un repos
qui n’est que léthargie et engourdissement. Comment un livre
pareil aux Fleurs du Mal, où l’Ordre, la Beauté, l’exquise douceur
du tranquille amour sont célébrés dans des pages impérissables,
a-t-il pu être condamné par un tribunal, comme si la haine du
vice était le vice lui-même? Ce jugement si inattendu, qui sup-
prima six pièces des Fleurs du Mal, assura en même temps la
fortune du livre; mais elle se serait faite sans un secours si violent,
car le poète avait trouvé la note vraie et humaine, et il avait
enfermé d’éternelles pensées dans une forme originale, châtiée et
correcte. Ce fut encore P. Malassis, son ami, qui publia la
seconde édition des Fleurs du Mal, augmentée de trente-cinq
poèmes nouveaux, et, comme la première, dédiée à Théophile
Gautier, « le poète impeccable ». Rien de noble et de touchant
comme la page où ce grand homme raconte modestement, sans
y insister, que Baudelaire, en qui il voulait voir un égal et un ami,
s’obstina toujours à le traiter avec vénération et comme un maître.
Certes Baudelaire était un maître aussi, et des plus illustres; mais
il avait raison de s’incliner devant celui qui l’avait précédé dans la
route de l’art; car n’est-ce pas au génie même qu’il appartient
d’affirmer la filiation non interrompue du génie? Dès lors (1861)
le livre du poète avait conquis dans notre littérature la place que'
rien ne peut plus lui enlever; il était un de ceux qui sont mêlés à
notre vie, et dont tout homme tant soit peu lettré ne se sépare
jamais.
Cependant Baudelaire ne s’arrêtait pas, et même dans les tra-
vaux entrepris pour le pain quotidien, défendait sans trêve son
idée unique, l’indispensable rachat de l’âme par l’effort humain.
Tel est encore, en effet, le sens du livre intitulé : Les Paradis a rti-
ficiels, opium et haschisch, qu’il composa de morceaux parus dans
les revues. Après avoir étudié très curieusement le darwamesk,
dont-il pût lui-même voir les effets, et l’opium d’après le livre du
savant humaniste Quincey, il conclut à la haine et au mépris de
ces empiriques moyens de bonheur, qui suppriment la volonté
qui coûte de l’argent, comme un homme qui, en fait d’inutilités,
n’a plus rien à apprendre. A l’époque dont je parle, il s’était lié
déjà avec les amis qui devaient rester ceux de toute sa vie, et il
leur confiait ses premières inspirations, dont la renommée ne
tarda pas à dépasser leur cercle, car les vers de Baudelaire, si
riches de mots, de faits et d’idées et exempts de remplissage,
accrochent la mémoire comme les facettes polies d’un métal ac-
crochent la lumière, et sont de ceux qui pourraient, comme aux
âges primitifs, se passer du livre, de l’écriture, et voltiger sur les
bouches des hommes. Mais surtout, à ce moment-là, le poète
s’était épris de la peinture ; Delacroix lui avait révélé un monde
de sensations et d’idées, et dans un Salon de 1845, qui fut son
premier ouvrage publié, il stupéfia les amis du coloriage classique,
en leur montrant que la peinture, par sa qualité propre, s’adresse
directement à l’âme, en dehors du drame exprimé, et contient
pour nous d’inestimables trésors de tristesse et de joie. Le Salon
de 1846, plus développé, exposait toute une théorie de la couleur,
des reflets, des objets se mouvant dans la lumière et de l’impec-
cable harmonie créée par l’air atmosphérique. L’auteur y ensei-
gnait que la peinture a sa mélodie, de même que la musique et la
poésie, de même aussi que la statuaire, où elle résulte alors de la
beauté initiale des lignes. La nouveauté de ces idées si oubliées,
la beauté et la force du style, une solide érudition, qui se sent
partout sans que le poète l’étale jamais à plaisir, mirent tout de
suite Baudelaire à un rang très-élevé, qu’il garda toujours, parmi
les critiques d’art. Nul mieux que lui ne sut jamais renouveler la
sensation créée par une peinture et exprimer avec des mots le
sens idéal d’une composition plastique.
C’est en 1857 que les Fleurs du Mal parurent enfin, publiées
par P. Malassis. L’effet en fut immense, prodigieux, inattendu,
mêlé d’admiration et de je ne sais quelle anxieuse épouvante. Les
Parisiens, les hommes modernes s’étaient bien habitués à ce que
Balzac, Daumier, Gavarni leur disent leur fait; mais celui-ci sous
le voile d’une fiction, ceux-là sous une forme ironique, et en
apparence frivole. Mais quoi ! cette fois sérieusement, sans farce
aucune, un poète dont la force était incontestable, allait violer
leur douce paresse et traîner leur âme toute nue au grand soleil.
Oui, toute nue, avec les vices, les hypocrisies, les lâchetés, les
stériles amours, les aspirations impuissantes qui la rongent comme
une lèpre hideuse ! C’était sans haine, sans colère et même avec
une tendre pitié qu’il leur tendait l’implacable miroir; et lui-
même, le poète, il ne se faisait pas plus parfait qu’eux, il ne se
décernait pas un brevet de vertu ; il se montrait comme eux en
proie à la tristesse, facile à séduire, enclin au mal, mais ayant de
plus qu’eux l'horreur du mal et l’inépuisable regret des patries
perdues, des larges cieux, des Himalayas sans tache. Tel est ce
livre étrange, consolant, divin, où la mort est partout mêlée à la
vie, où comme dans une austère sculpture du Moyen-âge, les
belles chairs sont partout guettées par le ver du tombeau; où,
dans des chambres riches et sombres, pleines de parfums capi-
teux, brillent sinistrement, parmi les étoffes et les dorures, les
pâles courtisanes follement attifées, balbutiant sous leur rouge
une vaine parodie de l’amour; où ni le Vin, ni le Crime, ni
l’ivresse des plus mordantes voluptés ne peuvent détruire dans
l’homme l’instinct invétéré du beau et l’appétit du ciel; où, pour-
suivi par le chœur des mortes échevelées et conduit par l’homme
de pierre qui tient le gouvernail, don Juan, sur la barque noire
qui le mène aux Enfers, reste encore impassible et d'un œil calme
regarde le sillage ; où, par une suprême folie, le misérable de-
mande à Satan la fin de sa misère ; où enfin le Spleen ne peut
tuer l’idéal, ni la Mort la Vie, ni le Mal le Repentir, et où tout ce
que l’homme n’a pu pervertir, les parfums exotiques, le frisson
lointain des mats et des cordages, les hiboux immobiles dans les
ifs noirs et par leur attitude raillant le mouvement insensé, les
chats dont rien n’a assoupli la fierté sauvage, parle d’infini, de
rachat, de fuite vers la lumière, d’invincible liberté. Pour mon-
trer la grandeur de l’esprit, où vit un ordre supérieur à celui de
la changeante nature, le poète construit des paysages d’une su-
blime ordonnance, d’où il bannit « le végétal irrégulier, » et qui
sont uniquement faits de marbres, de métaux et de pierreries ;
mais en même temps, pour attester à quel point les idoles de nos
terrestres amours sont passagères, il rencontre sur son chemin ces
Petites Vieilles, dont la vision exprimée par la poésie excita chez
Victor Hugo un frisson inconnu, ces pauvres petits êtres char-
mants et décrépits, vêtus de loques bizarres, qui ayant été jadis
des femmes, semblent à présent s’en retourner vers le berceau,
et dont la dépouille pourra tenir dans une bière d’enfant.
Dans un des plus beaux sonnets du livre, un Ange furieux
fond du haut du ciel sur le mécréant, le saisit par les cheveux, et
lui dit : « Tu connaîtras la règle! » Cet ange c’est le poète lui-
même, qui n’a pas voulu que son siècle s’endormît dans un repos
qui n’est que léthargie et engourdissement. Comment un livre
pareil aux Fleurs du Mal, où l’Ordre, la Beauté, l’exquise douceur
du tranquille amour sont célébrés dans des pages impérissables,
a-t-il pu être condamné par un tribunal, comme si la haine du
vice était le vice lui-même? Ce jugement si inattendu, qui sup-
prima six pièces des Fleurs du Mal, assura en même temps la
fortune du livre; mais elle se serait faite sans un secours si violent,
car le poète avait trouvé la note vraie et humaine, et il avait
enfermé d’éternelles pensées dans une forme originale, châtiée et
correcte. Ce fut encore P. Malassis, son ami, qui publia la
seconde édition des Fleurs du Mal, augmentée de trente-cinq
poèmes nouveaux, et, comme la première, dédiée à Théophile
Gautier, « le poète impeccable ». Rien de noble et de touchant
comme la page où ce grand homme raconte modestement, sans
y insister, que Baudelaire, en qui il voulait voir un égal et un ami,
s’obstina toujours à le traiter avec vénération et comme un maître.
Certes Baudelaire était un maître aussi, et des plus illustres; mais
il avait raison de s’incliner devant celui qui l’avait précédé dans la
route de l’art; car n’est-ce pas au génie même qu’il appartient
d’affirmer la filiation non interrompue du génie? Dès lors (1861)
le livre du poète avait conquis dans notre littérature la place que'
rien ne peut plus lui enlever; il était un de ceux qui sont mêlés à
notre vie, et dont tout homme tant soit peu lettré ne se sépare
jamais.
Cependant Baudelaire ne s’arrêtait pas, et même dans les tra-
vaux entrepris pour le pain quotidien, défendait sans trêve son
idée unique, l’indispensable rachat de l’âme par l’effort humain.
Tel est encore, en effet, le sens du livre intitulé : Les Paradis a rti-
ficiels, opium et haschisch, qu’il composa de morceaux parus dans
les revues. Après avoir étudié très curieusement le darwamesk,
dont-il pût lui-même voir les effets, et l’opium d’après le livre du
savant humaniste Quincey, il conclut à la haine et au mépris de
ces empiriques moyens de bonheur, qui suppriment la volonté