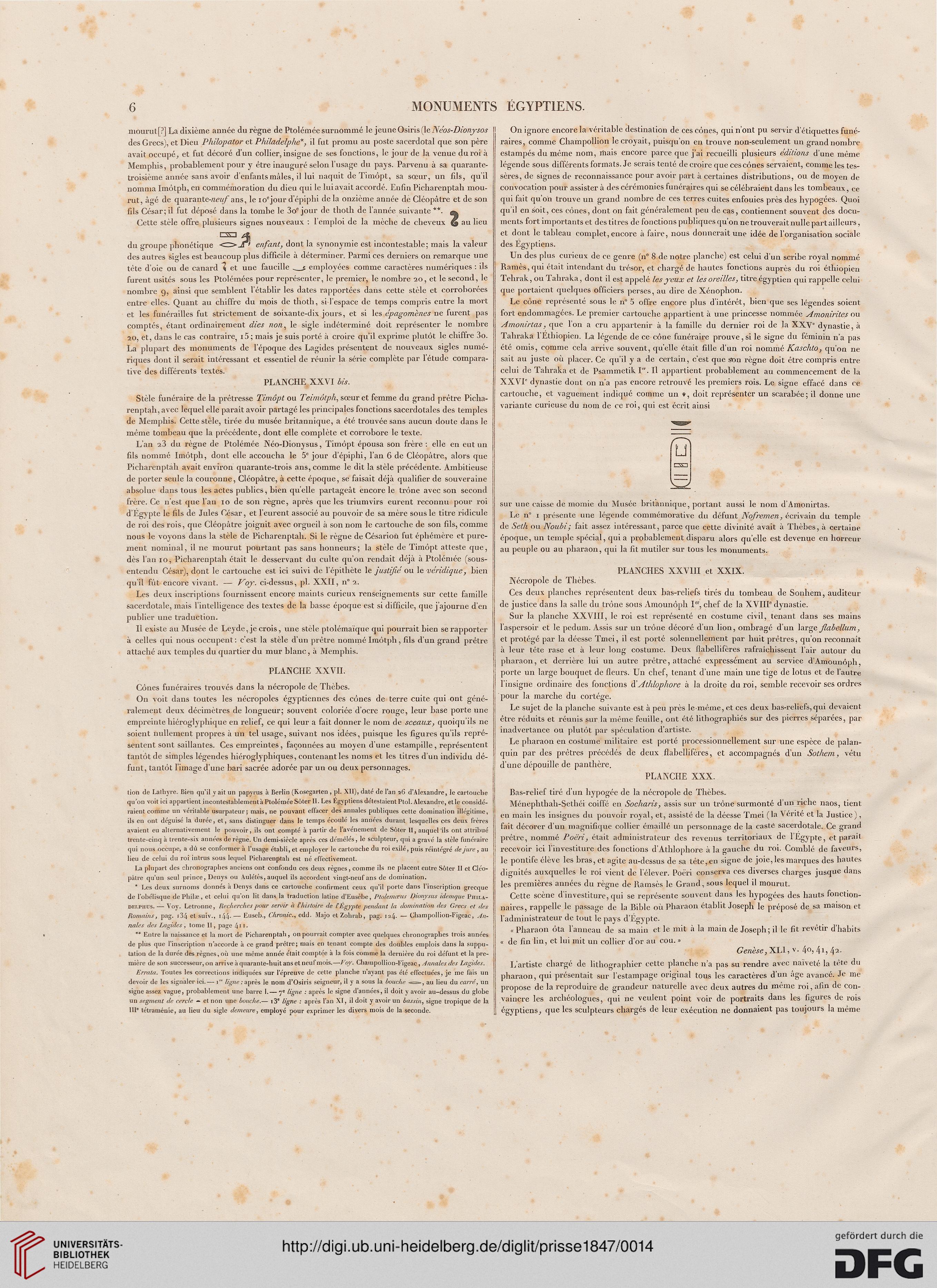6
MONUMENTS ÉGYPTIENS.
mourut[?] La dixième année du règne de Ptolémée surnommé le jeune Osiris (le Néos-Dionysos
des Grecs), et Dieu Philopator et Philadelphë*, il fut promu au poste sacerdotal que son père
avait occupé, et fut décoré d'un collier, insigne de ses fonctions, le jour de la venue du roi à
Memphis, probablement pour y être inauguré selon l'usage du pays. Parvenu à sa quarante-
troisième année sans avoir d'enfants mâles, il lui naquit de Timôpt, sa sœur, un fils, qu'il
nomma Imôtph, en commémoration du dieu qui le lui avait accordé. Enfin Picharenptah mou-
rut, âgé de quarante-neufans, le ioejour d'épiphi delà onzième année de Cléopâtre et de son
■k*
fils César;il fut déposé dans la tombe le 3oe jour de thoth de l'année suivante . ^
Cette stèle offre plusieurs signes nouveaux : l'emploi de la mèche de cheveux £ au neu
du groupe phonétique <Z>JP enfant, dont la synonymie est incontestable; mais la valeur
des autres sigles est beaucoup plus difficile à déterminer. Parmi ces derniers on remarque une
tête d'oie ou de canard ^ et une faucille ,_5 employées comme caractères numériques : ils
furent usités sous les Ptolémées pour représenter, le premier, le nombre 20, et le second, le
nombre 9, ainsi que semblent l'établir les dates rapportées dans cette stèle et corroborées
entre elles. Quant au chiffre du mois de thoth, si l'espace de temps compris entre la mort
et les funérailles fut strictement de soixante-dix jours, et si les épagomènes ne furent pas
comptés, étant ordinairement dies non, le sigle indéterminé doit représenter le nombre
10, et, dans le cas contraire, i5; mais je suis porté à croire qu'il exprime plutôt le chiffre 3o.
La plupart des monuments de l'époque des Lagides présentent de nouveaux sigles numé-
riques dont il serait intéressant et essentiel de réunir la série complète par l'étude compara-
tive des différents textes.
PLANCHE XXVI bis.
Stèle funéraire de la prêtresse Timôpt ou Teimôtph, sœur et femme du grand prêtre Picha-
renptah, avec lequel elle parait avoir partagé les principales fonctions sacerdotales des temples
de Memphis. Cette stèle, tirée du musée britannique, a été trouvée sans aucun doute dans le
même tombeau que la précédente, dont elle complète et corrobore le texte.
L'an a3 du règne de Ptolémée Néo-Dionysus, Timôpt épousa son frère : elle en eut un
fils nommé Imôtph, dont elle accoucha le 5e jour d'épiphi, l'an 6 de Cléopâtre, alors que
Picharenptah avait environ quarante-trois ans, comme le dit la stèle précédente. Ambitieuse
de porter seule la couronne, Cléopâtre, à cette époque, se faisait déjà qualifier de souveraine
absolue dans tous les actes publics, bien qu'elle partageât encore le trône avec son second
frère. Ce n'est que l'an 10 de son règne, après que les triumvirs eurent reconnu pour roi
d'Egypte le fils de Jules César, et l'eurent associé au pouvoir de sa mère sous le titre ridicule
de roi des rois, que Cléopâtre joignit avec orgueil à son nom le cartouche de son fils, comme
nous le voyons dans la stèle de Picharenptah. Si le règne de Césarion fut éphémère et pure-
ment nominal, il ne mourut pourtant pas sans honneurs; la stèle de Timôpt atteste que,
dès l'an 10, Picharenptah était le desservant du culte qu'on rendait déjà à Ptolémée (sous-
entendu César), dont le cartouche est ici suivi de l'épithète le justifié ou le véiidique, bien
qu'il fût encore vivant. — Voy. ci-dessus, pl. XXII, n° 1.
Les deux inscriptions fournissent encore maints curieux renseignements sur cette famille
sacerdotale, mais l'intelligence des textes de la basse époque est si difficile, que j'ajourne d'en
publier une traduction.
Il existe au Musée de Leyde, je crois, une stèle ptolémaïque qui pourrait bien se rapporter
à celles qui nous occupent : c'est la stèle d'un prêtre nommé Imôtph , fils d'un grand prêtre
attaché aux temples du quartier du mur blanc, à Memphis.
PLANCHE XXVII.
Cônes funéraires trouvés dans la nécropole de Thèbes.
On voit dans toutes les nécropoles égyptiennes des cônes de terre cuite qui ont géné-
ralement deux décimètres de longueur; souvent coloriée d'ocre rouge, leur base porte une
empreinte hiéroglyphique en relief, ce qui leur a fait donner le nom de sceaux, quoiqu'ils ne
soient nullement propres à un tel usage, suivant nos idées, puisque les figures qu'ils repré-
sentent sont saillantes. Ces empreintes, façonnées au moyen d'une estampille, représentent
tantôt de simples légendes hiéroglyphiques, contenant les noms et les titres d'un individu dé-
funt, tantôt l'image d'une bari sacrée adorée par un ou deux personnages.
tion de Lathyre. Bien qu'il y ait un papyrus à Berlin (Kosegarten , pl. XII), daté de l'an 26 d'Alexandre, le cartouche
qu'on voit ici appartient incontestablement à Ptolémée Sôter II. Les Egyptiens détestaient Ptol. Alexandre, etle considé-
raient comme un véritable usurpateur; mais, ne pouvant effacer des annales publiques cette domination illégitime,
ils en ont déguisé la durée, et, sans distinguer dans le temps écoulé les années durant lesquelles ces deux frères
avaient eu alternativement le pouvoir, ils ont compté à partir de l'avènement de Sôter II, auquel "ils ont attribué
trente-cinq à trente-six années de règne. Un demi-siècle après ces démêlés, le sculpteur, qui a gravé la stèle funéraire
qui nous occupe, a dû se conformer à l'usage établi, et employer le cartouche du roi exilé, puis réintégré de jure, au
lieu de celui du roi intrus sous lequel Picharenptah est né effectivement.
La plupart des chronographes anciens ont confondu ces deux règnes, comme ils ne placent entre Sôter II et Cléo-
pâtre qu'un seul prince, Denys ou Aulétès, auquel ils accordent vingt-neuf ans de domination.
* Les deux surnoms donnés à Denys dans ce cartouche confirment ceux qu'il porte dans l'inscription grecque
de l'obélisque dePhilae, et celui qu'on lit dans la traduction latine d'Eusèbe, Ptolemœus Dionjsus idemque Phila-
dei.phus. — Voy. Letronne, Recherches pour servir à l'histoire de lÉgypte pendant la domination des Grecs et des
Romains, pag. 134 et suiv., 144- — Euseb., Chronic, edd. Majo et Zohrab, pag. 124. — Champollion-Figeac, An-
nales des Lagides , tome II, page [\\\.
** Entre la naissance et la mort de Picharenptah, on pourrait compter avec quelques chronographes trois années
de plus que l'inscription n'accorde à ce grand prêtre; mais en tenant compte des doubles emplois dans la suppu-
tation de la durée des règnes, où une même année était comptée à la fois comme la dernière du roi défunt et la pre-
mière de son successeur, on arrive à quarante-huit ans et neuf mois.—Voj. Champollion-Figeac, Annales des Lagides.
Errata. Toutes les corrections indiquées sur l'épreuve de cette planche n'ayant pas été effectuées, je me fais un
devoir de les signaler ici.— 1" ligne : après le nom d'Osiris seigneur, il y a sous la bouche «=>, au lieu du carré, un
signe assez vague, probablement une barre I.— 7e ligne : après le signe d'années, il doit y avoir au-dessus du globe
un segment de cercle — et non une bouche.— i3e ligne : après l'an XI, il doit y avoir un bassin, signe tropique de la
IIIe tétraménie, au lieu du sigle demeure, employé pour exprimer les divers mois de la seconde.
On ignore encore la véritable destination de ces cônes, qui n'ont pu servir d'étiquettes funé-
raires, comme Champollion le croyait, puisqu'on en trouve non-seulement un grand nombre
estampés du même nom, mais encore parce que j'ai recueilli plusieurs éditions d'une même
légende sous différents formats. Je serais tenté de croire que ces cônes servaient, comme les tes-
sères, de signes de reconnaissance pour avoir part à certaines distributions, ou de moyen de
convocation pour assister à des cérémonies funéraires qui se célébraient dans les tombeaux, ce
qui fait qu'on trouve un grand nombre de ces terres cuites enfouies près des hypogées. Quoi
qu'il en soit, ces cônes, dont on fait généralement peu de cas, contiennent souvent des docu-
ments fort importants et des titres de fonctions publiques qu'on ne trouverait nulle part ailleurs,
et dont le tableau complet, encore à faire, nous donnerait une idée de l'organisation sociale
des Egyptiens.
Un des plus curieux de ce genre (n° 8 de notre planche) est celui d'un scribe royal nommé
Ramès,qui était intendant du trésor, et chargé de hautes fonctions auprès du roi éthiopien
Tehrak, ou Tahraka, dont il est appelé les yeux et les oreilles, titre égyptien qui rappelle celu i
que portaient quelques officiers perses, au dire de Xénophon.
Le cône représenté sous le n° 5 offre encore plus d'intérêt, bien que ses légendes soient
fort endommagées. Le premier cartouche appartient à une princesse nommée Amonirites ou
Amonirtas, que l'on a cru appartenir à la famille du dernier roi de la XXVe dynastie, à
Tahraka l'Ethiopien. La légende de ce cône funéraire prouve, si le signe du féminin n'a pas
été omis, comme cela arrive souvent, qu'elle était fille d'un roi nommé Kaschto, qu'on ne
sait au juste où placer. Ce qu'il y a de certain, c'est que son règne doit être compris entre
celui de Tahraka et de Psammetik Ier. Il appartient probablement au commencement de la
XXVIe dynastie dont on n'a pas encore retrouvé les premiers rois. Le signe effacé dans ce
cartouche, et vaguement indiqué comme un doit représenter un scarabée; il donne une
variante curieuse du nom de ce roi, qui est écrit ainsi
1?
sur une caisse de momie du Musée britannique, portant aussi le nom d'Amonirtas.
Le n° 1 présente une légende commémorative du défunt Nofremen, écrivain du temple
de Seth ou Noubi; fait assez intéressant, parce que cette divinité avait à Thèbes, à certaine
époque, un temple spécial, qui a probablement disparu alors qu'elle est devenue en horreur
au peuple ou au pharaon, qui la fit mutiler sur tous les monuments.
PLANCHES XXVIII et XXIX.
Nécropole de Thèbes.
Ces deux planches représentent deux bas-reliefs tirés du tombeau de Sonhem, auditeur
de justice dans la salle du trône sous Amounôph Ier, chef de la XVIIIe dynastie.
Sur la planche XXVIII, le roi est représenté en costume civil, tenant dans ses mains
l'aspersoir et le pedum. Assis sur un trône décoré d'un lion, ombragé d'un large flabellum,
et protégé par la déesse Tmei, il est porté solennellement par huit prêtres, qu'on reconnaît
à leur tête rase et à leur long costume. Deux flabellifères rafraîchissent l'air autour du
pharaon, et derrière lui un autre prêtre, attaché expressément au service d'Amounôph,
porte un large bouquet de fleurs. Un chef, tenant d'une main une tige de lotus et de l'autre
l'insigne ordinaire des fonctions iïAthlophore à la droite du roi. semble recevoir ses ordres
pour la marche du cortège.
Le sujet de la planche suivante est à peu près le même, et ces deux bas-reliefs,qui devaient
être réduits et réunis sur la même feuille, ont été lithographiés sur des pierres séparées, par
inadvertance ou plutôt par spéculation d'artiste.
Le pharaon en costume militaire est porté processionnellement sur une espèce de palan-
quin par des prêtres précédés de deux flabellifères, et accompagnés d'un Sothem, vêtu
d'une dépouille de panthère.
PLANCHE XXX.
Bas-relief tiré d'un hypogée de la nécropole de Thèbes.
Ménephthah-Sethéi coiffé en Socharis, assis sur un trône surmonté d'un riche naos, tient
en main les insignes du pouvoir royal, et, assisté de la déesse Tmei (la Vérité et la Justice),
fait décorer d'un magnifique collier émaillé un personnage de la caste sacerdotale. Ce grand
prêtre, nommé Poëri, était administrateur des revenus territoriaux de l'Egypte, et paraît
recevoir ici l'investiture des fonctions d'Athlophore à la gauche du roi. Comblé de faveurs,
le pontife élève les bras, et agite au-dessus de sa tête, en signe de joie, les marques des hautes
dignités auxquelles le roi vient de l'élever. Poëri conserva ces diverses charges jusque dans
les premières années du règne de Ramsès le Grand, sous lequel il mourut.
Cette scène d'investiture, qui se représente souvent dans les hypogées des hauts fonction-
naires, rappelle le passage de la Bible où Pharaon établit Joseph le préposé de sa maison et
l'administrateur de tout le pays d'Egypte.
« Pharaon ôta l'anneau de sa main et le mit à la main de Joseph; il le fit revêtir d'habits
« de fin lin, et lui mit un collier d'or au cou. »
Genèse, XL1, v. 4«, 4i,
L'artiste chargé de lithographier cette planche n'a pas su rendre avec naïveté la tête du
pharaon, qui présentait sur l'estampage original tous les caractères d'un âge avancé. Je me
propose de la reproduire de grandeur naturelle avec deux autres du même roi, afin de con-
vaincre les archéologues, qui ne veulent point voir de portraits dans les figures de rois
égyptiens, que les sculpteurs chargés de leur exécution ne donnaient pas toujours la même
MONUMENTS ÉGYPTIENS.
mourut[?] La dixième année du règne de Ptolémée surnommé le jeune Osiris (le Néos-Dionysos
des Grecs), et Dieu Philopator et Philadelphë*, il fut promu au poste sacerdotal que son père
avait occupé, et fut décoré d'un collier, insigne de ses fonctions, le jour de la venue du roi à
Memphis, probablement pour y être inauguré selon l'usage du pays. Parvenu à sa quarante-
troisième année sans avoir d'enfants mâles, il lui naquit de Timôpt, sa sœur, un fils, qu'il
nomma Imôtph, en commémoration du dieu qui le lui avait accordé. Enfin Picharenptah mou-
rut, âgé de quarante-neufans, le ioejour d'épiphi delà onzième année de Cléopâtre et de son
■k*
fils César;il fut déposé dans la tombe le 3oe jour de thoth de l'année suivante . ^
Cette stèle offre plusieurs signes nouveaux : l'emploi de la mèche de cheveux £ au neu
du groupe phonétique <Z>JP enfant, dont la synonymie est incontestable; mais la valeur
des autres sigles est beaucoup plus difficile à déterminer. Parmi ces derniers on remarque une
tête d'oie ou de canard ^ et une faucille ,_5 employées comme caractères numériques : ils
furent usités sous les Ptolémées pour représenter, le premier, le nombre 20, et le second, le
nombre 9, ainsi que semblent l'établir les dates rapportées dans cette stèle et corroborées
entre elles. Quant au chiffre du mois de thoth, si l'espace de temps compris entre la mort
et les funérailles fut strictement de soixante-dix jours, et si les épagomènes ne furent pas
comptés, étant ordinairement dies non, le sigle indéterminé doit représenter le nombre
10, et, dans le cas contraire, i5; mais je suis porté à croire qu'il exprime plutôt le chiffre 3o.
La plupart des monuments de l'époque des Lagides présentent de nouveaux sigles numé-
riques dont il serait intéressant et essentiel de réunir la série complète par l'étude compara-
tive des différents textes.
PLANCHE XXVI bis.
Stèle funéraire de la prêtresse Timôpt ou Teimôtph, sœur et femme du grand prêtre Picha-
renptah, avec lequel elle parait avoir partagé les principales fonctions sacerdotales des temples
de Memphis. Cette stèle, tirée du musée britannique, a été trouvée sans aucun doute dans le
même tombeau que la précédente, dont elle complète et corrobore le texte.
L'an a3 du règne de Ptolémée Néo-Dionysus, Timôpt épousa son frère : elle en eut un
fils nommé Imôtph, dont elle accoucha le 5e jour d'épiphi, l'an 6 de Cléopâtre, alors que
Picharenptah avait environ quarante-trois ans, comme le dit la stèle précédente. Ambitieuse
de porter seule la couronne, Cléopâtre, à cette époque, se faisait déjà qualifier de souveraine
absolue dans tous les actes publics, bien qu'elle partageât encore le trône avec son second
frère. Ce n'est que l'an 10 de son règne, après que les triumvirs eurent reconnu pour roi
d'Egypte le fils de Jules César, et l'eurent associé au pouvoir de sa mère sous le titre ridicule
de roi des rois, que Cléopâtre joignit avec orgueil à son nom le cartouche de son fils, comme
nous le voyons dans la stèle de Picharenptah. Si le règne de Césarion fut éphémère et pure-
ment nominal, il ne mourut pourtant pas sans honneurs; la stèle de Timôpt atteste que,
dès l'an 10, Picharenptah était le desservant du culte qu'on rendait déjà à Ptolémée (sous-
entendu César), dont le cartouche est ici suivi de l'épithète le justifié ou le véiidique, bien
qu'il fût encore vivant. — Voy. ci-dessus, pl. XXII, n° 1.
Les deux inscriptions fournissent encore maints curieux renseignements sur cette famille
sacerdotale, mais l'intelligence des textes de la basse époque est si difficile, que j'ajourne d'en
publier une traduction.
Il existe au Musée de Leyde, je crois, une stèle ptolémaïque qui pourrait bien se rapporter
à celles qui nous occupent : c'est la stèle d'un prêtre nommé Imôtph , fils d'un grand prêtre
attaché aux temples du quartier du mur blanc, à Memphis.
PLANCHE XXVII.
Cônes funéraires trouvés dans la nécropole de Thèbes.
On voit dans toutes les nécropoles égyptiennes des cônes de terre cuite qui ont géné-
ralement deux décimètres de longueur; souvent coloriée d'ocre rouge, leur base porte une
empreinte hiéroglyphique en relief, ce qui leur a fait donner le nom de sceaux, quoiqu'ils ne
soient nullement propres à un tel usage, suivant nos idées, puisque les figures qu'ils repré-
sentent sont saillantes. Ces empreintes, façonnées au moyen d'une estampille, représentent
tantôt de simples légendes hiéroglyphiques, contenant les noms et les titres d'un individu dé-
funt, tantôt l'image d'une bari sacrée adorée par un ou deux personnages.
tion de Lathyre. Bien qu'il y ait un papyrus à Berlin (Kosegarten , pl. XII), daté de l'an 26 d'Alexandre, le cartouche
qu'on voit ici appartient incontestablement à Ptolémée Sôter II. Les Egyptiens détestaient Ptol. Alexandre, etle considé-
raient comme un véritable usurpateur; mais, ne pouvant effacer des annales publiques cette domination illégitime,
ils en ont déguisé la durée, et, sans distinguer dans le temps écoulé les années durant lesquelles ces deux frères
avaient eu alternativement le pouvoir, ils ont compté à partir de l'avènement de Sôter II, auquel "ils ont attribué
trente-cinq à trente-six années de règne. Un demi-siècle après ces démêlés, le sculpteur, qui a gravé la stèle funéraire
qui nous occupe, a dû se conformer à l'usage établi, et employer le cartouche du roi exilé, puis réintégré de jure, au
lieu de celui du roi intrus sous lequel Picharenptah est né effectivement.
La plupart des chronographes anciens ont confondu ces deux règnes, comme ils ne placent entre Sôter II et Cléo-
pâtre qu'un seul prince, Denys ou Aulétès, auquel ils accordent vingt-neuf ans de domination.
* Les deux surnoms donnés à Denys dans ce cartouche confirment ceux qu'il porte dans l'inscription grecque
de l'obélisque dePhilae, et celui qu'on lit dans la traduction latine d'Eusèbe, Ptolemœus Dionjsus idemque Phila-
dei.phus. — Voy. Letronne, Recherches pour servir à l'histoire de lÉgypte pendant la domination des Grecs et des
Romains, pag. 134 et suiv., 144- — Euseb., Chronic, edd. Majo et Zohrab, pag. 124. — Champollion-Figeac, An-
nales des Lagides , tome II, page [\\\.
** Entre la naissance et la mort de Picharenptah, on pourrait compter avec quelques chronographes trois années
de plus que l'inscription n'accorde à ce grand prêtre; mais en tenant compte des doubles emplois dans la suppu-
tation de la durée des règnes, où une même année était comptée à la fois comme la dernière du roi défunt et la pre-
mière de son successeur, on arrive à quarante-huit ans et neuf mois.—Voj. Champollion-Figeac, Annales des Lagides.
Errata. Toutes les corrections indiquées sur l'épreuve de cette planche n'ayant pas été effectuées, je me fais un
devoir de les signaler ici.— 1" ligne : après le nom d'Osiris seigneur, il y a sous la bouche «=>, au lieu du carré, un
signe assez vague, probablement une barre I.— 7e ligne : après le signe d'années, il doit y avoir au-dessus du globe
un segment de cercle — et non une bouche.— i3e ligne : après l'an XI, il doit y avoir un bassin, signe tropique de la
IIIe tétraménie, au lieu du sigle demeure, employé pour exprimer les divers mois de la seconde.
On ignore encore la véritable destination de ces cônes, qui n'ont pu servir d'étiquettes funé-
raires, comme Champollion le croyait, puisqu'on en trouve non-seulement un grand nombre
estampés du même nom, mais encore parce que j'ai recueilli plusieurs éditions d'une même
légende sous différents formats. Je serais tenté de croire que ces cônes servaient, comme les tes-
sères, de signes de reconnaissance pour avoir part à certaines distributions, ou de moyen de
convocation pour assister à des cérémonies funéraires qui se célébraient dans les tombeaux, ce
qui fait qu'on trouve un grand nombre de ces terres cuites enfouies près des hypogées. Quoi
qu'il en soit, ces cônes, dont on fait généralement peu de cas, contiennent souvent des docu-
ments fort importants et des titres de fonctions publiques qu'on ne trouverait nulle part ailleurs,
et dont le tableau complet, encore à faire, nous donnerait une idée de l'organisation sociale
des Egyptiens.
Un des plus curieux de ce genre (n° 8 de notre planche) est celui d'un scribe royal nommé
Ramès,qui était intendant du trésor, et chargé de hautes fonctions auprès du roi éthiopien
Tehrak, ou Tahraka, dont il est appelé les yeux et les oreilles, titre égyptien qui rappelle celu i
que portaient quelques officiers perses, au dire de Xénophon.
Le cône représenté sous le n° 5 offre encore plus d'intérêt, bien que ses légendes soient
fort endommagées. Le premier cartouche appartient à une princesse nommée Amonirites ou
Amonirtas, que l'on a cru appartenir à la famille du dernier roi de la XXVe dynastie, à
Tahraka l'Ethiopien. La légende de ce cône funéraire prouve, si le signe du féminin n'a pas
été omis, comme cela arrive souvent, qu'elle était fille d'un roi nommé Kaschto, qu'on ne
sait au juste où placer. Ce qu'il y a de certain, c'est que son règne doit être compris entre
celui de Tahraka et de Psammetik Ier. Il appartient probablement au commencement de la
XXVIe dynastie dont on n'a pas encore retrouvé les premiers rois. Le signe effacé dans ce
cartouche, et vaguement indiqué comme un doit représenter un scarabée; il donne une
variante curieuse du nom de ce roi, qui est écrit ainsi
1?
sur une caisse de momie du Musée britannique, portant aussi le nom d'Amonirtas.
Le n° 1 présente une légende commémorative du défunt Nofremen, écrivain du temple
de Seth ou Noubi; fait assez intéressant, parce que cette divinité avait à Thèbes, à certaine
époque, un temple spécial, qui a probablement disparu alors qu'elle est devenue en horreur
au peuple ou au pharaon, qui la fit mutiler sur tous les monuments.
PLANCHES XXVIII et XXIX.
Nécropole de Thèbes.
Ces deux planches représentent deux bas-reliefs tirés du tombeau de Sonhem, auditeur
de justice dans la salle du trône sous Amounôph Ier, chef de la XVIIIe dynastie.
Sur la planche XXVIII, le roi est représenté en costume civil, tenant dans ses mains
l'aspersoir et le pedum. Assis sur un trône décoré d'un lion, ombragé d'un large flabellum,
et protégé par la déesse Tmei, il est porté solennellement par huit prêtres, qu'on reconnaît
à leur tête rase et à leur long costume. Deux flabellifères rafraîchissent l'air autour du
pharaon, et derrière lui un autre prêtre, attaché expressément au service d'Amounôph,
porte un large bouquet de fleurs. Un chef, tenant d'une main une tige de lotus et de l'autre
l'insigne ordinaire des fonctions iïAthlophore à la droite du roi. semble recevoir ses ordres
pour la marche du cortège.
Le sujet de la planche suivante est à peu près le même, et ces deux bas-reliefs,qui devaient
être réduits et réunis sur la même feuille, ont été lithographiés sur des pierres séparées, par
inadvertance ou plutôt par spéculation d'artiste.
Le pharaon en costume militaire est porté processionnellement sur une espèce de palan-
quin par des prêtres précédés de deux flabellifères, et accompagnés d'un Sothem, vêtu
d'une dépouille de panthère.
PLANCHE XXX.
Bas-relief tiré d'un hypogée de la nécropole de Thèbes.
Ménephthah-Sethéi coiffé en Socharis, assis sur un trône surmonté d'un riche naos, tient
en main les insignes du pouvoir royal, et, assisté de la déesse Tmei (la Vérité et la Justice),
fait décorer d'un magnifique collier émaillé un personnage de la caste sacerdotale. Ce grand
prêtre, nommé Poëri, était administrateur des revenus territoriaux de l'Egypte, et paraît
recevoir ici l'investiture des fonctions d'Athlophore à la gauche du roi. Comblé de faveurs,
le pontife élève les bras, et agite au-dessus de sa tête, en signe de joie, les marques des hautes
dignités auxquelles le roi vient de l'élever. Poëri conserva ces diverses charges jusque dans
les premières années du règne de Ramsès le Grand, sous lequel il mourut.
Cette scène d'investiture, qui se représente souvent dans les hypogées des hauts fonction-
naires, rappelle le passage de la Bible où Pharaon établit Joseph le préposé de sa maison et
l'administrateur de tout le pays d'Egypte.
« Pharaon ôta l'anneau de sa main et le mit à la main de Joseph; il le fit revêtir d'habits
« de fin lin, et lui mit un collier d'or au cou. »
Genèse, XL1, v. 4«, 4i,
L'artiste chargé de lithographier cette planche n'a pas su rendre avec naïveté la tête du
pharaon, qui présentait sur l'estampage original tous les caractères d'un âge avancé. Je me
propose de la reproduire de grandeur naturelle avec deux autres du même roi, afin de con-
vaincre les archéologues, qui ne veulent point voir de portraits dans les figures de rois
égyptiens, que les sculpteurs chargés de leur exécution ne donnaient pas toujours la même