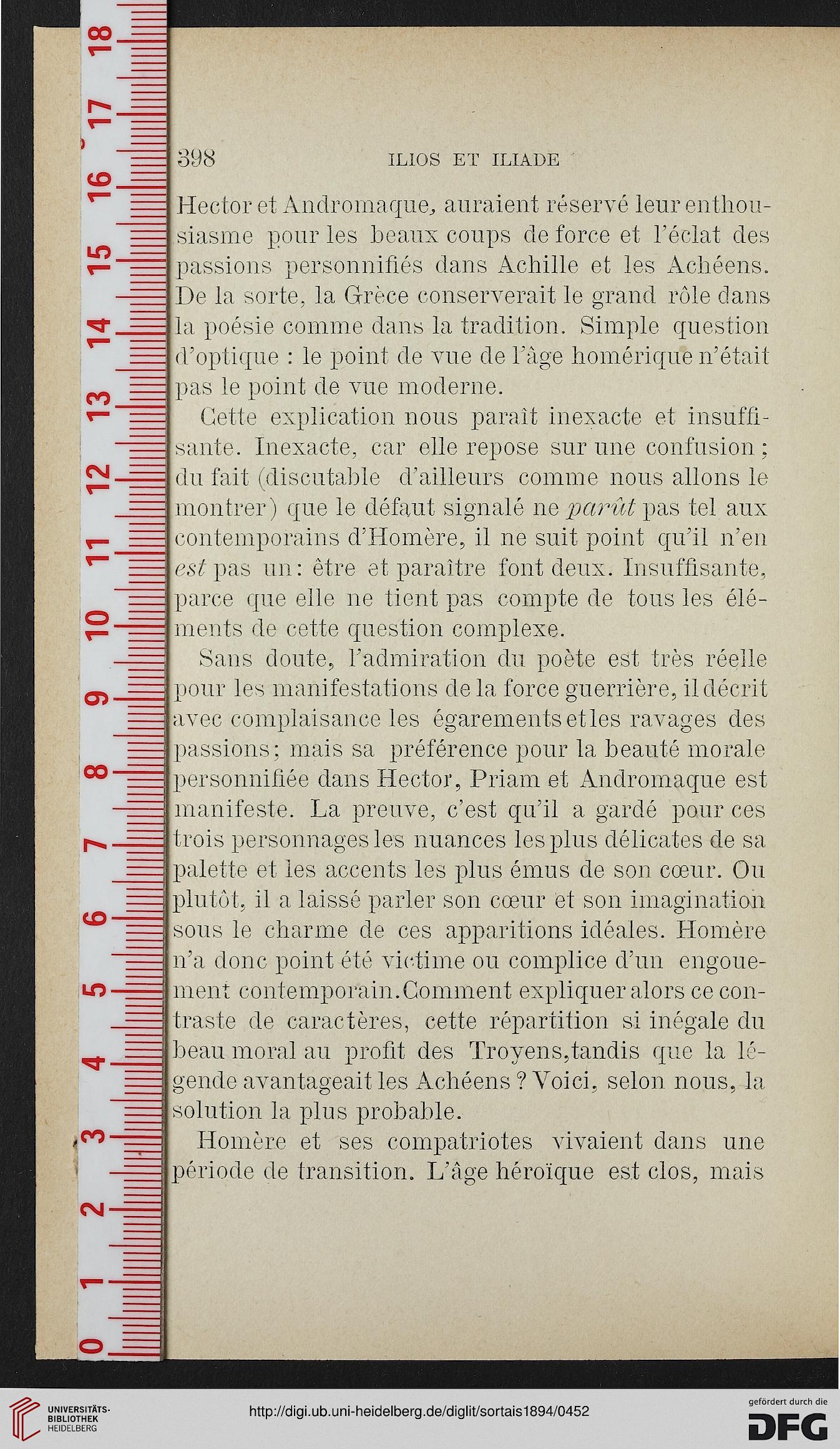398
ILIOS ET ILIADE
Hector et Andromaque^ auraient réservé leur enthou-
siasme pour les beaux coups de force et l'éclat des
passions personnifiés dans Achille et les Achéens.
De la sorte, la Grèce conserverait le grand rôle dans
la poésie comme dans la tradition. Simple question
d'optique : le point de vue de l'âge homérique n'était
pas le point de vue moderne.
Cette explication nous parait inexacte et insuffi-
sante. Inexacte, car elle repose sur une confusion:
du fait (discutable d'ailleurs comme nous allons le
montrer) que le défaut signalé ne parût pas tel aux
contemporains d'Homère, il ne suit point qu'il n'en
es^pas un: être et paraître font deux. Insuffisante,
parce que elle ne tient pas compte de tous les élé-
ments de cette question complexe.
Sans doute, l'admiration du poète est très réelle
pour les manifestations delà force guerrière, il décrit
avec complaisance les égarements et les ravages des
passions; mais sa préférence pour la beauté morale
personnifiée dans Hector, Priam et Andromaque est
manifeste. La preuve, c'est qu'il a gardé pour ces
trois personnages les nuances les plus délicates de sa
palette et les accents les plus émus de son cœur. Ou
plutôt, il a laissé parler son cœur et son imagination
sous le charme de ces apparitions idéales. Homère
n'a clone point été victime ou complice d'un engoue-
ment contemporain.Gomment expliquer alors ce con-
traste de caractères, cette répartition si inégale du
beau moral au profit des ïroyens,tandis que la lé-
gende avantageait les Achéens ? Voici, selon nous, la
solution la plus probable.
Homère et ses compatriotes vivaient dans une
période de transition. L'âge héroïque est clos, mais
ILIOS ET ILIADE
Hector et Andromaque^ auraient réservé leur enthou-
siasme pour les beaux coups de force et l'éclat des
passions personnifiés dans Achille et les Achéens.
De la sorte, la Grèce conserverait le grand rôle dans
la poésie comme dans la tradition. Simple question
d'optique : le point de vue de l'âge homérique n'était
pas le point de vue moderne.
Cette explication nous parait inexacte et insuffi-
sante. Inexacte, car elle repose sur une confusion:
du fait (discutable d'ailleurs comme nous allons le
montrer) que le défaut signalé ne parût pas tel aux
contemporains d'Homère, il ne suit point qu'il n'en
es^pas un: être et paraître font deux. Insuffisante,
parce que elle ne tient pas compte de tous les élé-
ments de cette question complexe.
Sans doute, l'admiration du poète est très réelle
pour les manifestations delà force guerrière, il décrit
avec complaisance les égarements et les ravages des
passions; mais sa préférence pour la beauté morale
personnifiée dans Hector, Priam et Andromaque est
manifeste. La preuve, c'est qu'il a gardé pour ces
trois personnages les nuances les plus délicates de sa
palette et les accents les plus émus de son cœur. Ou
plutôt, il a laissé parler son cœur et son imagination
sous le charme de ces apparitions idéales. Homère
n'a clone point été victime ou complice d'un engoue-
ment contemporain.Gomment expliquer alors ce con-
traste de caractères, cette répartition si inégale du
beau moral au profit des ïroyens,tandis que la lé-
gende avantageait les Achéens ? Voici, selon nous, la
solution la plus probable.
Homère et ses compatriotes vivaient dans une
période de transition. L'âge héroïque est clos, mais