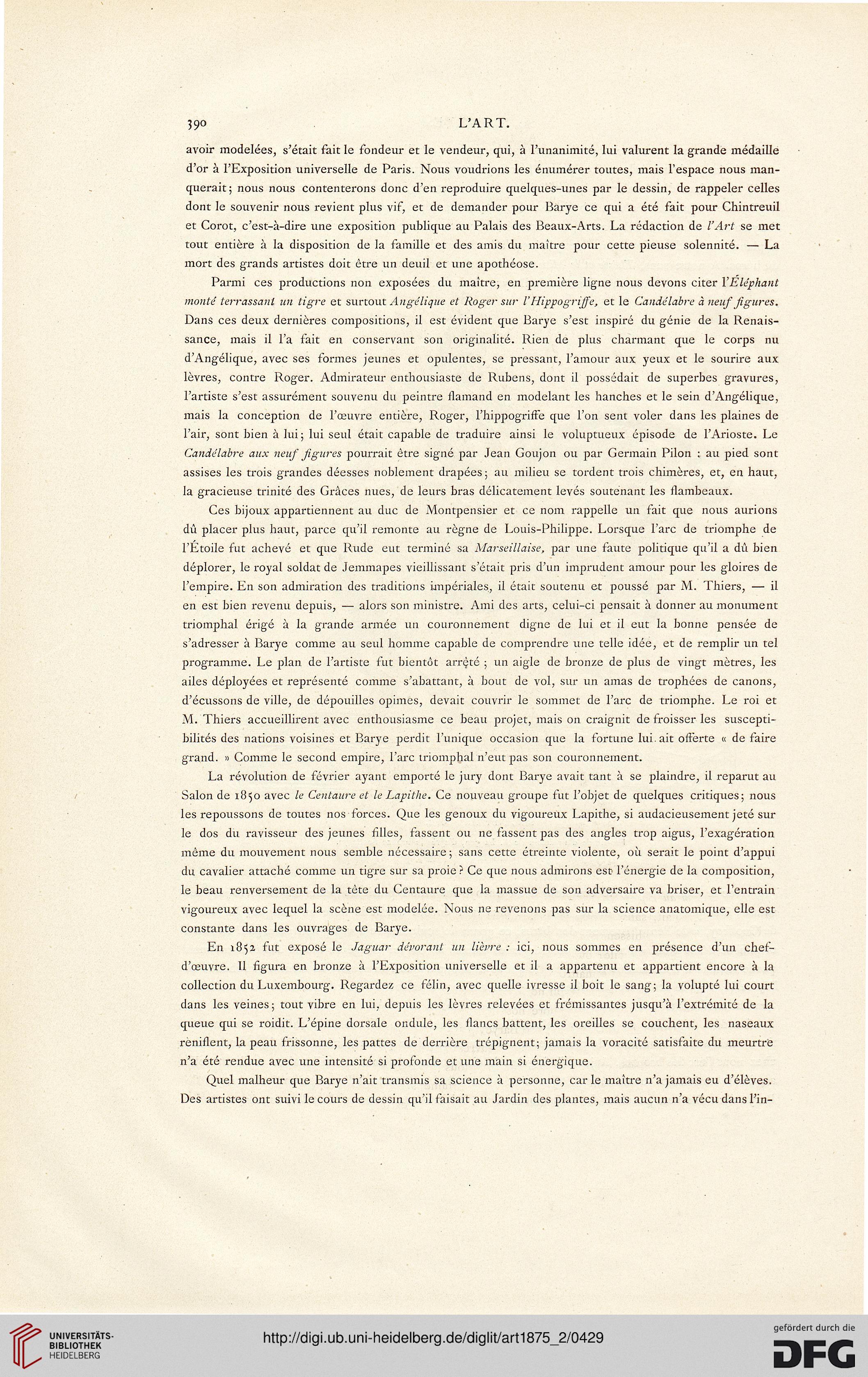39« L'ART.
avoir modelées, s'était fait le fondeur et le vendeur, qui, à l'unanimité, lui valurent la grande médaille
d'or à l'Exposition universelle de Paris. Nous voudrions les énumérer toutes, mais l'espace nous man-
querait; nous nous contenterons donc d'en reproduire quelques-unes par le dessin, de rappeler celles
dont le souvenir nous revient plus vif, et de demander pour Barye ce qui a été fait pour Chintreuil
et Corot, c'est-à-dire une exposition publique au Palais des Beaux-Arts. La rédaction de l'Art se met
tout entière à la disposition de la famille et des amis du maître pour cette pieuse solennité. — La
mort des grands artistes doit être un deuil et une apothéose.
Parmi ces productions non exposées du maître, en première ligne nous devons citer l'Eléphant
monté terrassant un tigre et surtout Angélique et Roger sur l'Hippogriffe, et le Candélabre à neuf figures.
Dans ces deux dernières compositions, il est évident que Barye s'est inspiré du génie de la Renais-
sance, mais il l'a fait en conservant son originalité. Rien de plus charmant que le corps nu
d'Angélique, avec ses formes jeunes et opulentes, se pressant, l'amour aux yeux et le sourire aux
lèvres, contre Roger. Admirateur enthousiaste de Rubens, dont il possédait de superbes gravures,
l'artiste s'est assurément souvenu du peintre flamand en modelant les hanches et le sein d'Angélique,
mais la conception de l'œuvre entière, Roger, l'hippogriffe que l'on sent voler dans les plaines de
l'air, sont bien à lui ; lui seul était capable de traduire ainsi le voluptueux épisode de l'Arioste. Le
Candélabre aux neuf figures pourrait être signé par Jean Goujon ou par Germain Pilon : au pied sont
assises les trois grandes déesses noblement drapées; au milieu se tordent trois chimères, et, en haut,
la gracieuse trinité des Grâces nues, de leurs bras délicatement levés soutenant les flambeaux.
Ces bijoux appartiennent au duc de Montpensier et ce nom rappelle un fait que nous aurions
dû placer plus haut, parce qu'il remonte au règne de Louis-Philippe. Lorsque l'arc de triomphe de
l'Étoile fut achevé et que Rude eut terminé sa Marseillaise, par une faute politique qu'il a dû bien
déplorer, le royal soldat de Jemmapes vieillissant s'était pris d'un imprudent amour pour les gloires de
l'empire. En son admiration des traditions impériales, il était soutenu et poussé par M. Thiers, — il
en est bien revenu depuis, — alors son ministre. Ami des arts, celui-ci pensait à donner au monument
triomphal érigé à la grande armée un couronnement digne de lui et il eut la bonne pensée de
s'adresser à Barye comme au seul homme capable de comprendre une telle idée, et de remplir un tel
programme. Le plan de l'artiste fut bientôt arrçté ; un aigle de bronze de plus de vingt mètres, les
ailes déployées et représenté comme s'abattant, à bout de vol, sur un amas de trophées de canons,
d'écussons de ville, de dépouilles opimes, devait couvrir le sommet de l'arc de triomphe. Le roi et
M. Thiers accueillirent avec enthousiasme ce beau projet, mais on craignit de froisser les suscepti-
bilités des nations voisines et Barye perdit l'unique occasion que la fortune lui. ait offerte « de faire
grand. » Comme le second empire, l'arc triomphal n'eut pas son couronnement.
La révolution de février ayant emporté le jury dont Barye avait tant à se plaindre, il reparut au
Salon de 1850 avec le Centaure et le Lapithe. Ce nouveau groupe fut l'objet de quelques critiques; nous
les repoussons de toutes nos forces. Que les genoux du vigoureux Lapithe, si audacieusement jeté sur
le dos du ravisseur des jeunes filles, fassent ou ne fassent pas des angles trop aigus, l'exagération
même du mouvement nous semble nécessaire; sans cette étreinte violente, où serait le point d'appui
du cavalier attaché comme un tigre sur sa proie ? Ce que nous admirons est l'énergie de la composition,
le beau renversement de la tête du Centaure que la massue de son adversaire va briser, et l'entrain
vigoureux avec lequel la scène est modelée. Nous ne revenons pas sur la science anatomique, elle est
constante dans les ouvrages de Barye.
En 1852 fut exposé le Jaguar dévorant un lièvre : ici, nous sommes en présence d'un chef-
d'œuvre. 11 figura en bronze à l'Exposition universelle et il a appartenu et appartient encore à la
collection du Luxembourg. Regardez ce félin, avec quelle ivresse il boit le sang; la volupté lui court
dans les veines; tout vibre en lui, depuis les lèvres relevées et frémissantes jusqu'à l'extrémité de la
queue qui se roidit. L'épine dorsale ondule, les flancs battent, les oreilles se couchent, les naseaux
reniflent, la peau frissonne, les pattes de derrière trépignent; jamais la voracité satisfaite du meurtre
n'a été rendue avec une intensité si profonde et une main si énergique.
Quel malheur que Barye n'ait transmis sa science à personne, carie maître n'a jamais eu d'élèves.
Des artistes ont suivi le cours de dessin qu'il faisait au Jardin des plantes, mais aucun n'a vécu dans Vin-
avoir modelées, s'était fait le fondeur et le vendeur, qui, à l'unanimité, lui valurent la grande médaille
d'or à l'Exposition universelle de Paris. Nous voudrions les énumérer toutes, mais l'espace nous man-
querait; nous nous contenterons donc d'en reproduire quelques-unes par le dessin, de rappeler celles
dont le souvenir nous revient plus vif, et de demander pour Barye ce qui a été fait pour Chintreuil
et Corot, c'est-à-dire une exposition publique au Palais des Beaux-Arts. La rédaction de l'Art se met
tout entière à la disposition de la famille et des amis du maître pour cette pieuse solennité. — La
mort des grands artistes doit être un deuil et une apothéose.
Parmi ces productions non exposées du maître, en première ligne nous devons citer l'Eléphant
monté terrassant un tigre et surtout Angélique et Roger sur l'Hippogriffe, et le Candélabre à neuf figures.
Dans ces deux dernières compositions, il est évident que Barye s'est inspiré du génie de la Renais-
sance, mais il l'a fait en conservant son originalité. Rien de plus charmant que le corps nu
d'Angélique, avec ses formes jeunes et opulentes, se pressant, l'amour aux yeux et le sourire aux
lèvres, contre Roger. Admirateur enthousiaste de Rubens, dont il possédait de superbes gravures,
l'artiste s'est assurément souvenu du peintre flamand en modelant les hanches et le sein d'Angélique,
mais la conception de l'œuvre entière, Roger, l'hippogriffe que l'on sent voler dans les plaines de
l'air, sont bien à lui ; lui seul était capable de traduire ainsi le voluptueux épisode de l'Arioste. Le
Candélabre aux neuf figures pourrait être signé par Jean Goujon ou par Germain Pilon : au pied sont
assises les trois grandes déesses noblement drapées; au milieu se tordent trois chimères, et, en haut,
la gracieuse trinité des Grâces nues, de leurs bras délicatement levés soutenant les flambeaux.
Ces bijoux appartiennent au duc de Montpensier et ce nom rappelle un fait que nous aurions
dû placer plus haut, parce qu'il remonte au règne de Louis-Philippe. Lorsque l'arc de triomphe de
l'Étoile fut achevé et que Rude eut terminé sa Marseillaise, par une faute politique qu'il a dû bien
déplorer, le royal soldat de Jemmapes vieillissant s'était pris d'un imprudent amour pour les gloires de
l'empire. En son admiration des traditions impériales, il était soutenu et poussé par M. Thiers, — il
en est bien revenu depuis, — alors son ministre. Ami des arts, celui-ci pensait à donner au monument
triomphal érigé à la grande armée un couronnement digne de lui et il eut la bonne pensée de
s'adresser à Barye comme au seul homme capable de comprendre une telle idée, et de remplir un tel
programme. Le plan de l'artiste fut bientôt arrçté ; un aigle de bronze de plus de vingt mètres, les
ailes déployées et représenté comme s'abattant, à bout de vol, sur un amas de trophées de canons,
d'écussons de ville, de dépouilles opimes, devait couvrir le sommet de l'arc de triomphe. Le roi et
M. Thiers accueillirent avec enthousiasme ce beau projet, mais on craignit de froisser les suscepti-
bilités des nations voisines et Barye perdit l'unique occasion que la fortune lui. ait offerte « de faire
grand. » Comme le second empire, l'arc triomphal n'eut pas son couronnement.
La révolution de février ayant emporté le jury dont Barye avait tant à se plaindre, il reparut au
Salon de 1850 avec le Centaure et le Lapithe. Ce nouveau groupe fut l'objet de quelques critiques; nous
les repoussons de toutes nos forces. Que les genoux du vigoureux Lapithe, si audacieusement jeté sur
le dos du ravisseur des jeunes filles, fassent ou ne fassent pas des angles trop aigus, l'exagération
même du mouvement nous semble nécessaire; sans cette étreinte violente, où serait le point d'appui
du cavalier attaché comme un tigre sur sa proie ? Ce que nous admirons est l'énergie de la composition,
le beau renversement de la tête du Centaure que la massue de son adversaire va briser, et l'entrain
vigoureux avec lequel la scène est modelée. Nous ne revenons pas sur la science anatomique, elle est
constante dans les ouvrages de Barye.
En 1852 fut exposé le Jaguar dévorant un lièvre : ici, nous sommes en présence d'un chef-
d'œuvre. 11 figura en bronze à l'Exposition universelle et il a appartenu et appartient encore à la
collection du Luxembourg. Regardez ce félin, avec quelle ivresse il boit le sang; la volupté lui court
dans les veines; tout vibre en lui, depuis les lèvres relevées et frémissantes jusqu'à l'extrémité de la
queue qui se roidit. L'épine dorsale ondule, les flancs battent, les oreilles se couchent, les naseaux
reniflent, la peau frissonne, les pattes de derrière trépignent; jamais la voracité satisfaite du meurtre
n'a été rendue avec une intensité si profonde et une main si énergique.
Quel malheur que Barye n'ait transmis sa science à personne, carie maître n'a jamais eu d'élèves.
Des artistes ont suivi le cours de dessin qu'il faisait au Jardin des plantes, mais aucun n'a vécu dans Vin-