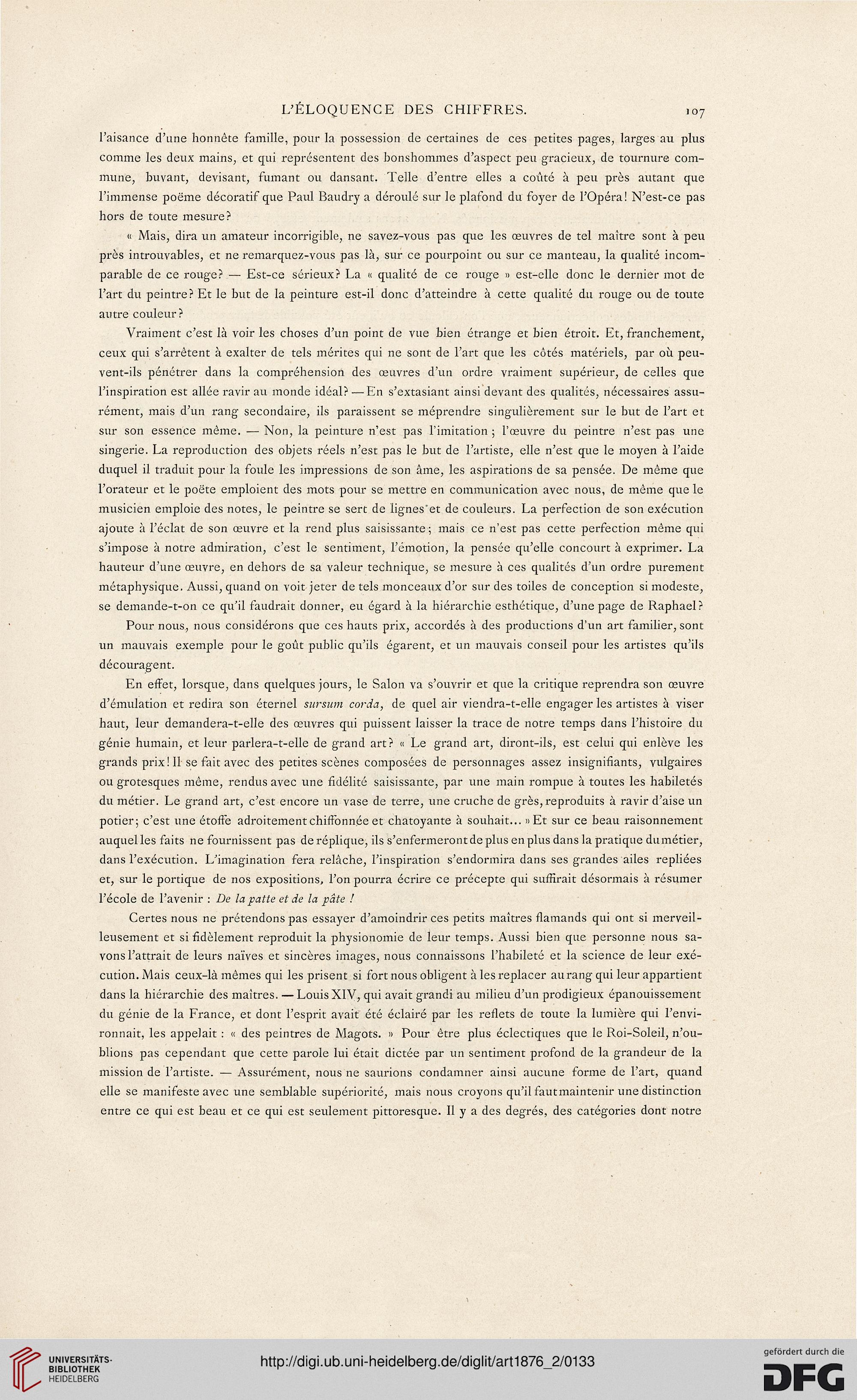L'ÉLOQUENCE DES CHIFFRES. .07
l'aisance d'une honnête famille, pour la possession de certaines de ces petites pages, larges au plus
comme les deux mains, et qui représentent des bonshommes d'aspect peu gracieux, de tournure com-
mune, buvant, devisant, fumant ou dansant. Telle d'entre elles a coûté à peu près autant que
l'immense poème décoratif que Paul Baudry a déroulé sur le plafond du foyer de l'Opéra! N'est-ce pas
hors de toute mesure?
« Mais, dira un amateur incorrigible, ne savez-vous pas que les œuvres de tel maître sont à peu
près introuvables, et ne remarquez-vous pas là, sur ce pourpoint ou sur ce manteau, la qualité incom-
parable de ce rouge? — Est-ce sérieux? La « qualité de ce rouge » est-elle donc le dernier mot de
l'art du peintre? Et le but de la peinture est-il donc d'atteindre à cette qualité du rouge ou de toute
autre couleur?
Vraiment c'est là voir les choses d'un point de vue bien étrange et bien étroit. Et, franchement,
ceux qui s'arrêtent à exalter de tels mérites qui ne sont de l'art que les côtés matériels, par où peu-
vent-ils pénétrer dans la compréhension des œuvres d'un ordre vraiment supérieur, de celles que
l'inspiration est allée ravir au monde idéal? —En s'extasiant ainsi devant des qualités, nécessaires assu-
rément, mais d'un rang secondaire, ils paraissent se méprendre singulièrement sur le but de l'art et
sur son essence même. — Non, la peinture n'est pas l'imitation ; l'œuvre du peintre n'est pas une
singerie. La reproduction des objets réels n'est pas le but de l'artiste, elle n'est que le moyen à l'aide
duquel il traduit pour la foule les impressions de son âme, les aspirations de sa pensée. De même que
l'orateur et le poëte emploient des mots pour se mettre en communication avec nous, de même que le
musicien emploie des notes, le peintre se sert de lignes'et de couleurs. La perfection de son exécution
ajoute à l'éclat de son œuvre et la rend plus saisissante; mais ce n'est pas cette perfection même qui
s'impose à notre admiration, c'est le sentiment, l'émotion, la pensée qu'elle concourt à exprimer. La
hauteur d'une œuvre, en dehors de sa valeur technique, se mesure à ces qualités d'un ordre purement
métaphysique. Aussi, quand on voit jeter de tels monceaux d'or sur des toiles de conception si modeste,
se demande-t-on ce qu'il faudrait donner, eu égard à la hiérarchie esthétique, d'une page de Raphaël?
Pour nous, nous considérons que ces hauts prix, accordés à des pi-oductions d'un art familier, sont
un mauvais exemple pour le goût public qu'ils égarent, et un mauvais conseil pour les artistes qu'ils
découragent.
En effet, lorsque, dans quelques jours, le Salon va s'ouvrir et que la critique reprendra son œuvre
d'émulation et redira son éternel sursum corda, de quel air viendra-t-elle engager les artistes à viser
haut, leur demandera-t-elle des œuvres qui puissent laisser la trace de notre temps dans l'histoire du
génie humain, et leur parlera-t-elle de grand art? « Le grand art, diront-ils, est celui qui enlève les
grands prix! Il se fait avec des petites scènes composées de personnages assez insignifiants, vulgaires
ou grotesques même, rendus avec une fidélité saisissante, par une main rompue à toutes les habiletés
du métier. Le grand art, c'est encore un vase de terre, une cruche de grès, reproduits à ravir d'aise un
potier; c'est une étoffe adroitement chiffonnée et chatoyante à souhait... » Et sur ce beau raisonnement
auquel les faits ne fournissent pas de réplique, ils s'enfermeront de plus en plus dans la pratique du métier,
dans l'exécution. L'imagination fera relâche, l'inspiration s'endormira dans ses grandes ailes repliées
et, sur le portique de nos expositions, l'on pourra écrire ce précepte qui suffirait désormais à résumer
l'école de l'avenir : De la patte et de la pâte !
Certes nous ne prétendons pas essayer d'amoindrir ces petits maîtres flamands qui ont si merveil-
leusement et si fidèlement reproduit la physionomie de leur temps. Aussi bien que personne nous sa-
vons l'attrait de leurs naïves et sincères images, nous connaissons l'habileté et la science de leur exé-
cution. Mais ceux-là mêmes qui les prisent si fort nous obligent à les replacer au rang qui leur appartient
dans la hiérarchie des maîtres. — Louis XIV, qui avait grandi au milieu d'un prodigieux épanouissement
du génie de la France, et dont l'esprit avait été éclairé par les reflets de toute la lumière qui l'envi-
ronnait, les appelait : « des peintres de Magots. » Pour être plus éclectiques que le Roi-Soleil, n'ou-
blions pas cependant que cette parole lui était dictée par un sentiment profond de la grandeur de la
mission de l'artiste. — Assurément, nous ne saurions condamner ainsi aucune forme de l'art, quand
elle se manifeste avec une semblable supériorité, mais nous croyons qu'il fautmaintenir une distinction
entre ce qui est beau et ce qui est seulement pittoresque. Il y a des degrés, des catégories dont notre
l'aisance d'une honnête famille, pour la possession de certaines de ces petites pages, larges au plus
comme les deux mains, et qui représentent des bonshommes d'aspect peu gracieux, de tournure com-
mune, buvant, devisant, fumant ou dansant. Telle d'entre elles a coûté à peu près autant que
l'immense poème décoratif que Paul Baudry a déroulé sur le plafond du foyer de l'Opéra! N'est-ce pas
hors de toute mesure?
« Mais, dira un amateur incorrigible, ne savez-vous pas que les œuvres de tel maître sont à peu
près introuvables, et ne remarquez-vous pas là, sur ce pourpoint ou sur ce manteau, la qualité incom-
parable de ce rouge? — Est-ce sérieux? La « qualité de ce rouge » est-elle donc le dernier mot de
l'art du peintre? Et le but de la peinture est-il donc d'atteindre à cette qualité du rouge ou de toute
autre couleur?
Vraiment c'est là voir les choses d'un point de vue bien étrange et bien étroit. Et, franchement,
ceux qui s'arrêtent à exalter de tels mérites qui ne sont de l'art que les côtés matériels, par où peu-
vent-ils pénétrer dans la compréhension des œuvres d'un ordre vraiment supérieur, de celles que
l'inspiration est allée ravir au monde idéal? —En s'extasiant ainsi devant des qualités, nécessaires assu-
rément, mais d'un rang secondaire, ils paraissent se méprendre singulièrement sur le but de l'art et
sur son essence même. — Non, la peinture n'est pas l'imitation ; l'œuvre du peintre n'est pas une
singerie. La reproduction des objets réels n'est pas le but de l'artiste, elle n'est que le moyen à l'aide
duquel il traduit pour la foule les impressions de son âme, les aspirations de sa pensée. De même que
l'orateur et le poëte emploient des mots pour se mettre en communication avec nous, de même que le
musicien emploie des notes, le peintre se sert de lignes'et de couleurs. La perfection de son exécution
ajoute à l'éclat de son œuvre et la rend plus saisissante; mais ce n'est pas cette perfection même qui
s'impose à notre admiration, c'est le sentiment, l'émotion, la pensée qu'elle concourt à exprimer. La
hauteur d'une œuvre, en dehors de sa valeur technique, se mesure à ces qualités d'un ordre purement
métaphysique. Aussi, quand on voit jeter de tels monceaux d'or sur des toiles de conception si modeste,
se demande-t-on ce qu'il faudrait donner, eu égard à la hiérarchie esthétique, d'une page de Raphaël?
Pour nous, nous considérons que ces hauts prix, accordés à des pi-oductions d'un art familier, sont
un mauvais exemple pour le goût public qu'ils égarent, et un mauvais conseil pour les artistes qu'ils
découragent.
En effet, lorsque, dans quelques jours, le Salon va s'ouvrir et que la critique reprendra son œuvre
d'émulation et redira son éternel sursum corda, de quel air viendra-t-elle engager les artistes à viser
haut, leur demandera-t-elle des œuvres qui puissent laisser la trace de notre temps dans l'histoire du
génie humain, et leur parlera-t-elle de grand art? « Le grand art, diront-ils, est celui qui enlève les
grands prix! Il se fait avec des petites scènes composées de personnages assez insignifiants, vulgaires
ou grotesques même, rendus avec une fidélité saisissante, par une main rompue à toutes les habiletés
du métier. Le grand art, c'est encore un vase de terre, une cruche de grès, reproduits à ravir d'aise un
potier; c'est une étoffe adroitement chiffonnée et chatoyante à souhait... » Et sur ce beau raisonnement
auquel les faits ne fournissent pas de réplique, ils s'enfermeront de plus en plus dans la pratique du métier,
dans l'exécution. L'imagination fera relâche, l'inspiration s'endormira dans ses grandes ailes repliées
et, sur le portique de nos expositions, l'on pourra écrire ce précepte qui suffirait désormais à résumer
l'école de l'avenir : De la patte et de la pâte !
Certes nous ne prétendons pas essayer d'amoindrir ces petits maîtres flamands qui ont si merveil-
leusement et si fidèlement reproduit la physionomie de leur temps. Aussi bien que personne nous sa-
vons l'attrait de leurs naïves et sincères images, nous connaissons l'habileté et la science de leur exé-
cution. Mais ceux-là mêmes qui les prisent si fort nous obligent à les replacer au rang qui leur appartient
dans la hiérarchie des maîtres. — Louis XIV, qui avait grandi au milieu d'un prodigieux épanouissement
du génie de la France, et dont l'esprit avait été éclairé par les reflets de toute la lumière qui l'envi-
ronnait, les appelait : « des peintres de Magots. » Pour être plus éclectiques que le Roi-Soleil, n'ou-
blions pas cependant que cette parole lui était dictée par un sentiment profond de la grandeur de la
mission de l'artiste. — Assurément, nous ne saurions condamner ainsi aucune forme de l'art, quand
elle se manifeste avec une semblable supériorité, mais nous croyons qu'il fautmaintenir une distinction
entre ce qui est beau et ce qui est seulement pittoresque. Il y a des degrés, des catégories dont notre