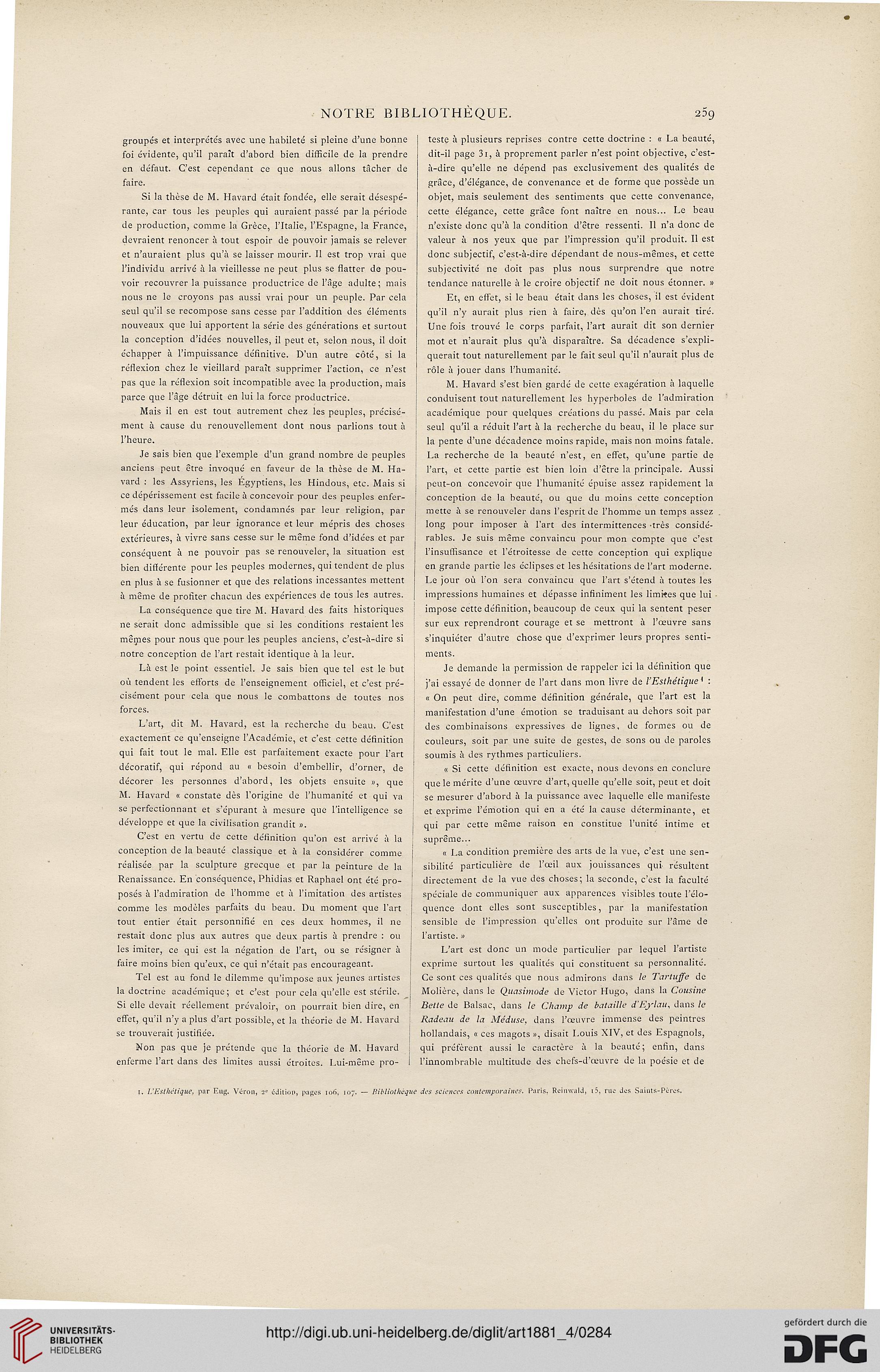NOTRE BIBLIOTHÈQUE.
2Dg
groupés et interprétés avec une habileté si pleine d'une bonne
foi évidente, qu'il paraît d'abord bien difficile de la prendre
en défaut. C'est cependant ce que nous allons tacher de
faire.
Si la thèse de M. Havard était fondée, elle serait désespé-
rante, car tous les peuples qui auraient passé par la période
de production, comme la Grèce, l'Italie, l'Espagne, la France,
devraient renoncer à tout espoir de pouvoir jamais se relever
et n'auraient plus qu'à se laisser mourir. Il est trop vrai que
l'individu arrivé à la vieillesse ne peut plus se flatter de pou-
voir recouvrer la puissance productrice de l'âge adulte; mais
nous ne le croyons pas aussi vrai pour un peuple. Par cela
seul qu'il se recompose sans cesse par l'addition des éléments
nouveaux que lui apportent la série des générations et surtout
la conception d'idées nouvelles, il peut et, selon nous, il doit
échapper à l'impuissance définitive. D'un autre côté, si la
réflexion chez le vieillard paraît supprimer l'action, ce n'est
pas que la réflexion soit incompatible avec la production, mais
parce que l'âge détruit en lui la force productrice.
Mais il en est tout autrement chez les peuples, précisé-
ment à cause du renouvellement dont nous parlions tout à
l'heure.
Je sais bien que l'exemple d'un grand nombre de peuples
anciens peut être invoqué en faveur de la thèse de M. Ha-
vard : les Assyriens, les Égyptiens, les Hindous, etc. Mais si
ce dépérissement est facile à concevoir pour des peuples enfer-
més dans leur isolement, condamnés par leur religion, par
leur éducation, par leur ignorance et leur mépris des choses
extérieures, à vivre sans cesse sur le même fond d'idées et par
conséquent à ne pouvoir pas se renouveler, la situation est
bien différente pour les peuples modernes, qui tendent de plus
en plus à se fusionner et que des relations incessantes mettent
à même de profiter chacun des expériences de tous les autres.
La conséquence que tire M. Havard des faits historiques
ne serait donc admissible que si les conditions restaient les
mêmes pour nous que pour les peuples anciens, c'est-à-dire si
notre conception de l'art restait identique à la leur.
Là est le point essentiel. Je sais bien que tel est le but
où tendent les efforts de l'enseignement officiel, et c'est pré-
cisément pour cela que nous le combattons de toutes nos
forces.
L'art, dit M. Havard, est la recherche du beau. C'est
exactement ce qu'enseigne l'Académie, et c'est cette définition
qui fait tout le mal. Elle est parfaitement exacte pour l'art
décoratif, qui répond au « besoin d'embellir, d'orner, de
décorer les personnes d'abord, les objets ensuite », que
M. Havard « constate dès l'origine de l'humanité et qui va
se perfectionnant et s'épurant à mesure que l'intelligence se
développe et que la civilisation grandit ».
C'est en vertu de cette définition qu'on est arrivé à la
conception de la beauté classique et à la considérer comme
réalisée par la sculpture grecque et par la peinture de la
Renaissance. En conséquence, Phidias et Raphaël ont été pro-
posés à l'admiration de l'homme et à l'imitation des artistes
comme les modèles parfaits du beau. Du moment que l'art
tout entier était personnifié en ces deux hommes, il ne
restait donc plus aux autres que deux partis à prendre : ou
les imiter, ce qui est la négation de l'art, ou se résigner à
faire moins bien qu'eux, ce qui n'était pas encourageant.
Tel est au fond le dilemme qu'impose aux jeunes artistes
la doctrine académique; et c'est pour cela qu'elle est stérile.
Si elle devait réellement prévaloir, on pourrait bien dire, en
effet, qu'il n'y a plus d'art possible, et la théorie de M. Havard
se trouverait justifiée.
Non pas que je prétende que la théorie de M. Havard
enferme l'art dans des limites aussi étroites. Lui-même pro-
teste à plusieurs reprises contre cette doctrine : « La beauté,
dit-il page 3i, à proprement parler n'est point objective, c'est-
à-dire qu'elle ne dépend pas exclusivement des qualités de
grâce, d'élégance, de convenance et de forme que possède un
objet, mais seulement des sentiments que cette convenance,
cette élégance, cette grâce font naître en nous... Le beau
n'existe donc qu'à la condition d'être ressenti. Il n'a donc de
valeur à nos yeux que par l'impression qu'il produit. Il est
donc subjectif, c'est-à-dire dépendant de nous-mêmes, et cette
subjectivité ne doit pas plus nous surprendre que notre
tendance naturelle à le croire objectif ne doit nous étonner. »
Et, en effet, si le beau était dans les choses, il est évident
qu'il n'y aurait plus rien à faire, dès qu'on l'en aurait tiré.
Une fois trouvé le corps parfait, l'art aurait dit son dernier
mot et n'aurait plus qu'à disparaître. Sa décadence s'expli-
querait tout naturellement par le fait seul qu'il n'aurait plus de
rôle à jouer dans l'humanité.
M. Havard s'est bien gardé de cette exagération à laquelle
conduisent tout naturellement les hyperboles de l'admiration
académique pour quelques créations du passé. Mais par cela
seul qu'il a réduit l'art à la recherche du beau, il le place sur
la pente d'une décadence moins rapide, mais non moins fatale.
La recherche de la beauté n'est, en effet, qu'une partie de
l'art, et cette partie est bien loin d'être la principale. Aussi
peut-on concevoir que l'humanité épuise assez rapidement la
conception de la beauté, ou que du moins cette conception
mette à se renouveler dans l'esprit de l'homme un temps assez
long pour imposer à l'art des intermittences -très considé-
rables. Je suis même convaincu pour mon compte que c'est
l'insuffisance et l'étroitesse de cette conception qui explique
en grande partie les éclipses et les hésitations de l'art moderne.
Le jour où l'on sera convaincu que l'art s'étend à toutes les
impressions humaines et dépasse infiniment les limites que lui
impose cette définition, beaucoup de ceux qui la sentent peser
sur eux reprendront courage et se mettront à l'œuvre sans
s'inquiéter d'autre chose que d'exprimer leurs propres senti-
ments.
Je demande la permission de rappeler ici la définition que
j'ai essayé de donner de l'art dans mon livre de l'Esthétique 1 :
« On peut dire, comme définition générale, que l'art est la
manifestation d'une émotion se traduisant au dehors soit par
des combinaisons expressives de lignes, de formes ou de
couleurs, soit par une suite de gestes, de sons ou de paroles
soumis à des rythmes particuliers.
« Si cette définition est exacte, nous devons en conclure
que le mérite d'une œuvre d'art, quelle qu'elle soit, peut et doit
se mesurer d'abord à la puissance avec laquelle elle manifeste
et exprime l'émotion qui en a été la cause déterminante, et
qui par cette même raison en constitue l'unité intime et
suprême...
« La condition première des arts de la vue, c'est une sen-
sibilité particulière de l'œil aux jouissances qui résultent
directement de la vue des choses; la seconde, c'est la faculté
spéciale de communiquer aux apparences visibles toute l'élo-
quence dont elles sont susceptibles, par la manifestation
sensible de l'impression qu'elles ont produite sur l'âme de
l'artiste. »
L'art est donc un mode particulier par lequel l'artiste
exprime surtout les qualités qui constituent sa personnalité.
Ce sont ces qualités que nous admirons dans le Tartuffe de
Molière, dans le Quasimode de Victor Hugo, dans la Cousine
Bette de Balsac, dans le Champ de bataille d'Eylau, dans le
Radeau de la Méduse, dans l'œuvre immense des peintres
hollandais, « ces magots », disait Louis XIV, et des Espagnols,
qui préfèrent aussi le caractère à la beauté; enfin, dans
l'innombrable multitude des chefs-d'œuvre de la poésie et de
i. L'Esthétique, par Eug. Véron, ■>- édition, pages 106, 107. —
Bibliothèque des sciences contemporaines, Paris. Reinwald, ô, rue Jos Saints-Pères.
2Dg
groupés et interprétés avec une habileté si pleine d'une bonne
foi évidente, qu'il paraît d'abord bien difficile de la prendre
en défaut. C'est cependant ce que nous allons tacher de
faire.
Si la thèse de M. Havard était fondée, elle serait désespé-
rante, car tous les peuples qui auraient passé par la période
de production, comme la Grèce, l'Italie, l'Espagne, la France,
devraient renoncer à tout espoir de pouvoir jamais se relever
et n'auraient plus qu'à se laisser mourir. Il est trop vrai que
l'individu arrivé à la vieillesse ne peut plus se flatter de pou-
voir recouvrer la puissance productrice de l'âge adulte; mais
nous ne le croyons pas aussi vrai pour un peuple. Par cela
seul qu'il se recompose sans cesse par l'addition des éléments
nouveaux que lui apportent la série des générations et surtout
la conception d'idées nouvelles, il peut et, selon nous, il doit
échapper à l'impuissance définitive. D'un autre côté, si la
réflexion chez le vieillard paraît supprimer l'action, ce n'est
pas que la réflexion soit incompatible avec la production, mais
parce que l'âge détruit en lui la force productrice.
Mais il en est tout autrement chez les peuples, précisé-
ment à cause du renouvellement dont nous parlions tout à
l'heure.
Je sais bien que l'exemple d'un grand nombre de peuples
anciens peut être invoqué en faveur de la thèse de M. Ha-
vard : les Assyriens, les Égyptiens, les Hindous, etc. Mais si
ce dépérissement est facile à concevoir pour des peuples enfer-
més dans leur isolement, condamnés par leur religion, par
leur éducation, par leur ignorance et leur mépris des choses
extérieures, à vivre sans cesse sur le même fond d'idées et par
conséquent à ne pouvoir pas se renouveler, la situation est
bien différente pour les peuples modernes, qui tendent de plus
en plus à se fusionner et que des relations incessantes mettent
à même de profiter chacun des expériences de tous les autres.
La conséquence que tire M. Havard des faits historiques
ne serait donc admissible que si les conditions restaient les
mêmes pour nous que pour les peuples anciens, c'est-à-dire si
notre conception de l'art restait identique à la leur.
Là est le point essentiel. Je sais bien que tel est le but
où tendent les efforts de l'enseignement officiel, et c'est pré-
cisément pour cela que nous le combattons de toutes nos
forces.
L'art, dit M. Havard, est la recherche du beau. C'est
exactement ce qu'enseigne l'Académie, et c'est cette définition
qui fait tout le mal. Elle est parfaitement exacte pour l'art
décoratif, qui répond au « besoin d'embellir, d'orner, de
décorer les personnes d'abord, les objets ensuite », que
M. Havard « constate dès l'origine de l'humanité et qui va
se perfectionnant et s'épurant à mesure que l'intelligence se
développe et que la civilisation grandit ».
C'est en vertu de cette définition qu'on est arrivé à la
conception de la beauté classique et à la considérer comme
réalisée par la sculpture grecque et par la peinture de la
Renaissance. En conséquence, Phidias et Raphaël ont été pro-
posés à l'admiration de l'homme et à l'imitation des artistes
comme les modèles parfaits du beau. Du moment que l'art
tout entier était personnifié en ces deux hommes, il ne
restait donc plus aux autres que deux partis à prendre : ou
les imiter, ce qui est la négation de l'art, ou se résigner à
faire moins bien qu'eux, ce qui n'était pas encourageant.
Tel est au fond le dilemme qu'impose aux jeunes artistes
la doctrine académique; et c'est pour cela qu'elle est stérile.
Si elle devait réellement prévaloir, on pourrait bien dire, en
effet, qu'il n'y a plus d'art possible, et la théorie de M. Havard
se trouverait justifiée.
Non pas que je prétende que la théorie de M. Havard
enferme l'art dans des limites aussi étroites. Lui-même pro-
teste à plusieurs reprises contre cette doctrine : « La beauté,
dit-il page 3i, à proprement parler n'est point objective, c'est-
à-dire qu'elle ne dépend pas exclusivement des qualités de
grâce, d'élégance, de convenance et de forme que possède un
objet, mais seulement des sentiments que cette convenance,
cette élégance, cette grâce font naître en nous... Le beau
n'existe donc qu'à la condition d'être ressenti. Il n'a donc de
valeur à nos yeux que par l'impression qu'il produit. Il est
donc subjectif, c'est-à-dire dépendant de nous-mêmes, et cette
subjectivité ne doit pas plus nous surprendre que notre
tendance naturelle à le croire objectif ne doit nous étonner. »
Et, en effet, si le beau était dans les choses, il est évident
qu'il n'y aurait plus rien à faire, dès qu'on l'en aurait tiré.
Une fois trouvé le corps parfait, l'art aurait dit son dernier
mot et n'aurait plus qu'à disparaître. Sa décadence s'expli-
querait tout naturellement par le fait seul qu'il n'aurait plus de
rôle à jouer dans l'humanité.
M. Havard s'est bien gardé de cette exagération à laquelle
conduisent tout naturellement les hyperboles de l'admiration
académique pour quelques créations du passé. Mais par cela
seul qu'il a réduit l'art à la recherche du beau, il le place sur
la pente d'une décadence moins rapide, mais non moins fatale.
La recherche de la beauté n'est, en effet, qu'une partie de
l'art, et cette partie est bien loin d'être la principale. Aussi
peut-on concevoir que l'humanité épuise assez rapidement la
conception de la beauté, ou que du moins cette conception
mette à se renouveler dans l'esprit de l'homme un temps assez
long pour imposer à l'art des intermittences -très considé-
rables. Je suis même convaincu pour mon compte que c'est
l'insuffisance et l'étroitesse de cette conception qui explique
en grande partie les éclipses et les hésitations de l'art moderne.
Le jour où l'on sera convaincu que l'art s'étend à toutes les
impressions humaines et dépasse infiniment les limites que lui
impose cette définition, beaucoup de ceux qui la sentent peser
sur eux reprendront courage et se mettront à l'œuvre sans
s'inquiéter d'autre chose que d'exprimer leurs propres senti-
ments.
Je demande la permission de rappeler ici la définition que
j'ai essayé de donner de l'art dans mon livre de l'Esthétique 1 :
« On peut dire, comme définition générale, que l'art est la
manifestation d'une émotion se traduisant au dehors soit par
des combinaisons expressives de lignes, de formes ou de
couleurs, soit par une suite de gestes, de sons ou de paroles
soumis à des rythmes particuliers.
« Si cette définition est exacte, nous devons en conclure
que le mérite d'une œuvre d'art, quelle qu'elle soit, peut et doit
se mesurer d'abord à la puissance avec laquelle elle manifeste
et exprime l'émotion qui en a été la cause déterminante, et
qui par cette même raison en constitue l'unité intime et
suprême...
« La condition première des arts de la vue, c'est une sen-
sibilité particulière de l'œil aux jouissances qui résultent
directement de la vue des choses; la seconde, c'est la faculté
spéciale de communiquer aux apparences visibles toute l'élo-
quence dont elles sont susceptibles, par la manifestation
sensible de l'impression qu'elles ont produite sur l'âme de
l'artiste. »
L'art est donc un mode particulier par lequel l'artiste
exprime surtout les qualités qui constituent sa personnalité.
Ce sont ces qualités que nous admirons dans le Tartuffe de
Molière, dans le Quasimode de Victor Hugo, dans la Cousine
Bette de Balsac, dans le Champ de bataille d'Eylau, dans le
Radeau de la Méduse, dans l'œuvre immense des peintres
hollandais, « ces magots », disait Louis XIV, et des Espagnols,
qui préfèrent aussi le caractère à la beauté; enfin, dans
l'innombrable multitude des chefs-d'œuvre de la poésie et de
i. L'Esthétique, par Eug. Véron, ■>- édition, pages 106, 107. —
Bibliothèque des sciences contemporaines, Paris. Reinwald, ô, rue Jos Saints-Pères.