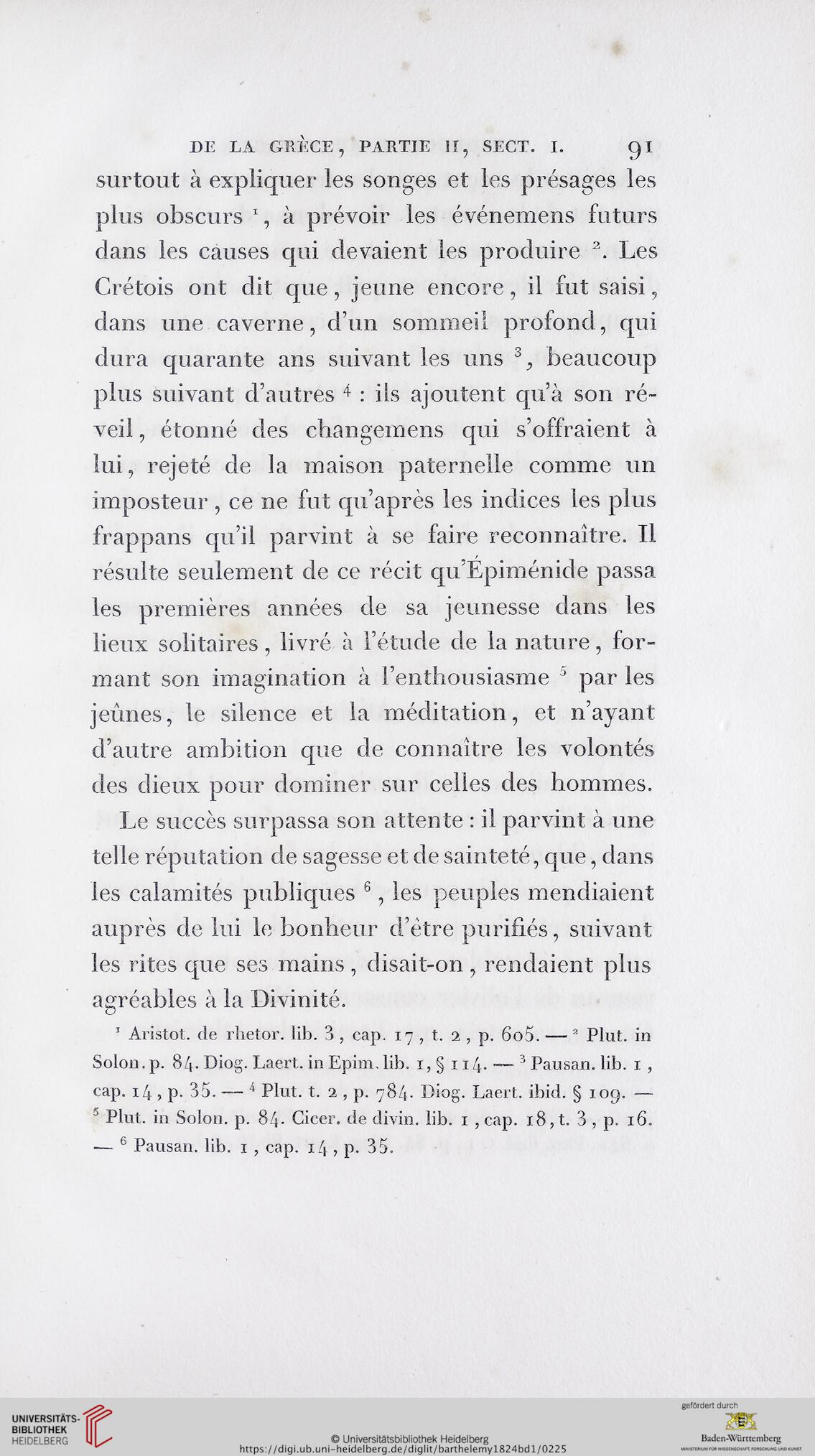DE LA GRÈCE, PARTIE II, SECT. I. gi
surtout à expliquer les songes et les présages les
plus obscurs à prévoir les événemens futurs
dans les causes qui devaient les produire 2. Les
Crétois ont dit que, jeune encore, il fut saisi,
dans une caverne, d’un sommeil profond, qui
dura quarante ans suivant les uns 3, beaucoup
plus suivant d’autres 4 : ils ajoutent qu’à son ré-
veil , étonné des changemens qui s’offraient à
lui, rejeté de la maison paternelle comme un
imposteur, ce ne fut qu’après les indices les plus
frappans qu’il parvint à se faire reconnaître. Il
résulte seulement de ce récit qu’Épiménicle passa
les premières années de sa jeunesse dans les
lieux solitaires, livré à l’étude de la nature, for-
mant son imagination à l’enthousiasme 5 par les
jeûnes, le silence et la méditation, et n’ayant
d’autre ambition que de connaître les volontés
des dieux pour dominer sur celles des hommes.
Le succès surpassa son attente : il parvint à une
telle réputation de sagesse et de sainteté, que, dans
les calamités publiques 6, les peuples mendiaient
auprès de lui le bonheur d’étre purifiés, suivant
les rites que ses mains , disait-on , rendaient plus
agréables à la Divinité.
’ Aristot. de rhetor. lib. 3 , cap. 17 , t. 2 , p. 6o5. —3 Plut, in
Solon, p. 84- Diog. Laert. in Epim.lib. 1, § 114. — 3 Pausan. lib. 1 ,
cap. 14 > P- 35. — 4 Plut. t. 2 , p. 784. Diog. Laert. ibid. § 10g. —
5 Plut, in Solon, p. 84- Cieer. de divin, lib. 1 , cap. 18, t. 3 , p. 16.
— 6 Pausan. lib. 1 , cap. 14 , p. 35.
surtout à expliquer les songes et les présages les
plus obscurs à prévoir les événemens futurs
dans les causes qui devaient les produire 2. Les
Crétois ont dit que, jeune encore, il fut saisi,
dans une caverne, d’un sommeil profond, qui
dura quarante ans suivant les uns 3, beaucoup
plus suivant d’autres 4 : ils ajoutent qu’à son ré-
veil , étonné des changemens qui s’offraient à
lui, rejeté de la maison paternelle comme un
imposteur, ce ne fut qu’après les indices les plus
frappans qu’il parvint à se faire reconnaître. Il
résulte seulement de ce récit qu’Épiménicle passa
les premières années de sa jeunesse dans les
lieux solitaires, livré à l’étude de la nature, for-
mant son imagination à l’enthousiasme 5 par les
jeûnes, le silence et la méditation, et n’ayant
d’autre ambition que de connaître les volontés
des dieux pour dominer sur celles des hommes.
Le succès surpassa son attente : il parvint à une
telle réputation de sagesse et de sainteté, que, dans
les calamités publiques 6, les peuples mendiaient
auprès de lui le bonheur d’étre purifiés, suivant
les rites que ses mains , disait-on , rendaient plus
agréables à la Divinité.
’ Aristot. de rhetor. lib. 3 , cap. 17 , t. 2 , p. 6o5. —3 Plut, in
Solon, p. 84- Diog. Laert. in Epim.lib. 1, § 114. — 3 Pausan. lib. 1 ,
cap. 14 > P- 35. — 4 Plut. t. 2 , p. 784. Diog. Laert. ibid. § 10g. —
5 Plut, in Solon, p. 84- Cieer. de divin, lib. 1 , cap. 18, t. 3 , p. 16.
— 6 Pausan. lib. 1 , cap. 14 , p. 35.