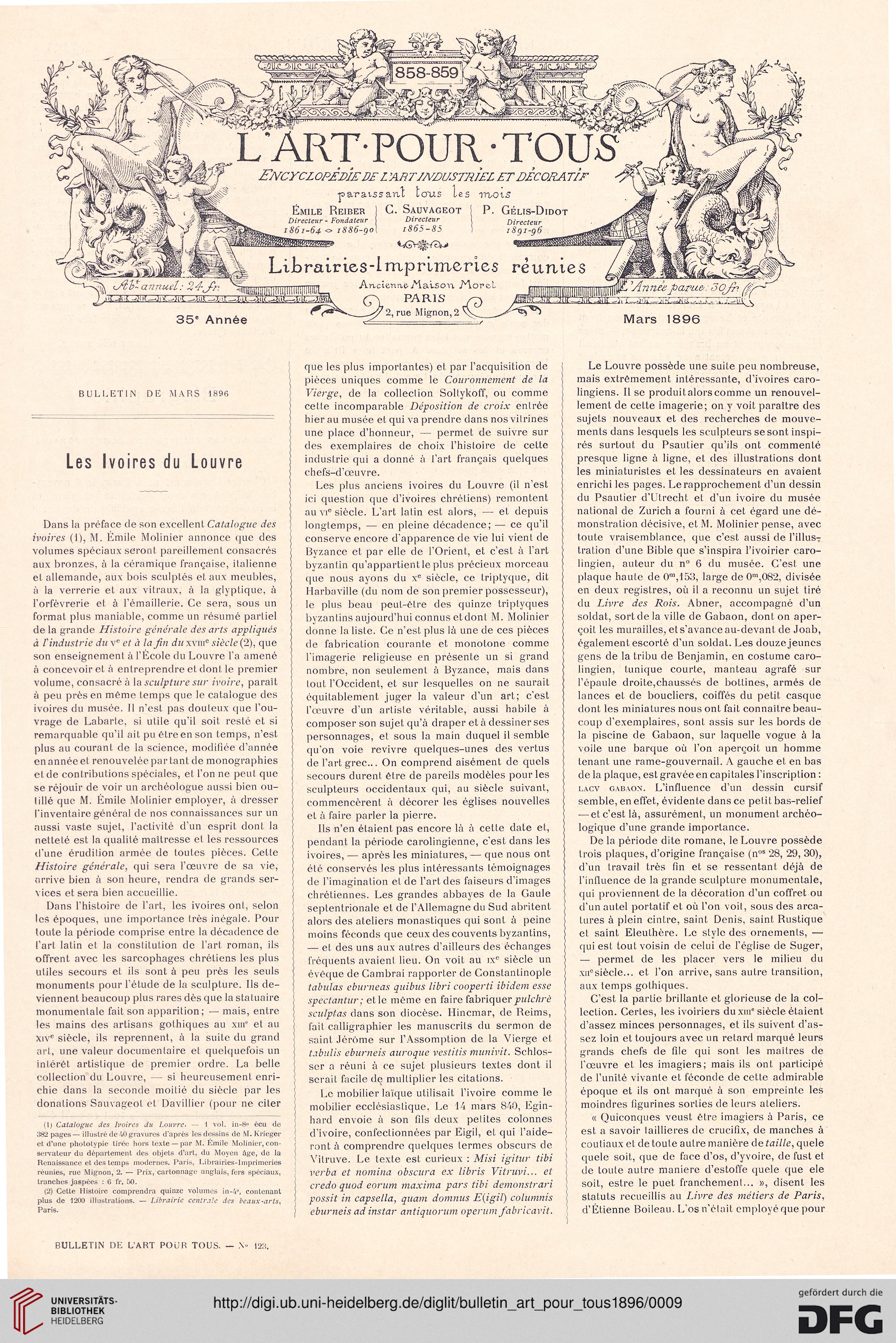L'ART-POUR • TOUS
ENCYCLOPEDIEDE L'ARTINDUSTRIEL ET DECORA TIF
p&ravssarit tous les mots
Emile Reiber
Directeur - Fondateur
1861-64 o 1886-go
G. Sauvageot 1 P. Gélis-Didot
Directeur Directeur
i86s-8i i8gi-g6
Litrairies-Imprimeries reunies
^ <AV-annuel : 24Jr. ^MUlhllIIllIllllIlIlllllllIL. Ancteniv*Maison .Moral ,
im ç\ paris M
^r^^^s/ 2, rue Mignon, 2 <^__J>^r
35e Année ' 5 J^r;— Mars 1896
BULLETIN DE MARS 1896
Les Ivoires du Louvre
Dans la préface de son excellent Catalogue des
ivoires (1), M. Emile Molinier annonce que des
volumes spéciaux seront pareillement consacrés
aux bronzes, à la céramique française, italienne
el allemande, aux bois sculptés et aux meubles,
à la verrerie et aux vitraux, à la glyptique, à
l'orfèvrerie et à l'émaillerie. Ce sera, sous un
format plus maniable, comme un résumé partiel
de la grande Histoire générale des arts appliqués
à r industrie du ve et à la fin du xvnie siècle (2), que
son enseignement à l'Ecole du Louvre l'a amené
à concevoir et à entreprendre et dont le premier
volume, consacré à la sculpture sur ivoire, paraît
à peu près en même temps que le catalogue des
ivoires du musée. Il n'est pas douteux que l'ou-
vrage de Labarte, si utile qu'il soit resté et si
remarquable qu'il ait pu être en son temps, n'est
plus au courant de la science, modifiée d'année
en année et renouvelée par tant de monographies
et de contributions spéciales, et l'on ne peut que
se réjouir de voir un archéologue aussi bien ou-
tillé que M. Emile Molinier employer, à dresser
l'inventaire général de nos connaissances sur un
aussi vaste sujet, l'activité d'un esprit dont la
netteté est la qualité maîtresse et les ressources
d'une érudilion armée de toutes pièces. Celte
Histoire générale, qui sera l'œuvre de sa vie,
arrive bien à son heure, rendra de grands ser-
vices et sera bien accueillie.
Dans l'histoire de l'art, les ivoires onl, selon
les époques, une importance très inégale. Pour
toute la période comprise entre la décadence de
l'art latin et la constitution de l'art roman, ils
offrent avec les sarcophages chrétiens les plus
utiles secours et ils sont à peu près les seuls
monuments pour l'étude de la sculpture. Ils de-
viennent beaucoup plus rares dès que la statuaire
monumentale fait son apparition; — mais, entre
les mains des artisans gothiques au xmc et au
xive siècle, ils reprennent, à la suite du grand
art, une valeur documentaire el quelquefois un
intérêt artistique de premier ordre. La belle
collection du Louvre, — si heureusement enri-
chie dans la seconde moitié du siècle par les
donations Sauvageot et Davillier (pour ne citer
[\} Catalogue des Ivoires du Louvre. — 1 vol. in-8° ècu de
:t82 pages— illustré de 40 gravures d'après les dessins de M. Kricger
et d'une phototypie tirée hors texte — par M. Émile Molinier, con-
servateur du département des objets d'art, du Moyen âge, de la
Renaissance et des temps modernes. Paris, Librairies-Imprimeries
réunies, rue Mignon, 2. — Prix, cartonnage anglais, fers spéciaux,
tranches jaspées : 6 fr. 50.
(2) Cette Histoire comprendra quinze volumes in-'i°, contenant
plus de 1200 illustrations. — Librairie centrale des beaux.arts.
Paris.
que les plus importantes) et par l'acquisition de
pièces uniques comme le Couronnement de la
> Vierge, de la colleclion Soltykoff, ou comme
celle incomparable Déposition de croix entrée
hier au musée et qui va prendre dans nos vilrines
une place d'honneur, — permet de suivre sur
des exemplaires de choix l'histoire de cette
industrie qui a donné à l'art français quelques
chefs-d'œuvre.
Les plus anciens ivoires du Louvre (il n'est
ici question que d'ivoires chrétiens) remontent
au vie siècle. L'art latin est alors, — et depuis
longtemps, — en pleine décadence; — ce qu'il
; conserve encore d'apparence de vie lui vient de
\ Byzance et par elle de l'Orient, et c'est à l'art
\ byzantin qu'appartient le plus précieux morceau
! que nous ayons du xe siècle, ce triptyque, dit
> Harbaville (du nom de son premier possesseur),
i le plus beau peut-être des quinze triptyques
i byzantins aujourd'hui connus etdont M. Molinier
1 donne la liste. Ce n'est plus là une de ces pièces
1 de fabrication courante et monotone comme
| l'imagerie religieuse en présente un si grand
| nombre, non seulement à Byzance, mais dans
j lout l'Occident, et sur lesquelles on ne saurait
j équitablement juger la valeur d'un art; c'est
l'œuvre d'un artiste véritable, aussi habile à
composer son sujet qu'à draper et à dessiner ses
personnages, et sous la main duquel il semble
j qu'on voie revivre quelques-unes des vertus
j de l'art grec... On comprend aisément de quels
j secours durent être de pareils modèles pour les
sculpteurs occidentaux qui, au siècle suivant,
commencèrent à décorer les églises nouvelles
j et à faire parler la pierre.
Ils n'en étaient pas encore là à cette date et,
pendant la période carolingienne, c'est dans les
ivoires, — après les miniatures, — que nous ont
été conservés les plus intéressants témoignages
de l'imagination et de l'art des faiseurs d'images
chrétiennes. Les grandes abbayes de la Gaule
septentrionale et de l'Allemagne du Sud abritent
alors des ateliers monastiques qui sont à peine
moins féconds que ceux des couvents byzantins,
— et des uns aux autres d'ailleurs des échanges
fréquents avaient lieu. On voit au ixe siècle un
évêque de Cambrai rapporter de Constantinople
| tabulas eburneas quibus libri cooperti ibidem esse
j spectantur; et le même en faire fabriquer pulchrè
sculptas dans son diocèse. Hincmar, de Reims,
fait calligraphier les manuscrits du sermon de
saint Jérôme sur l'Assomption de la Vierge el
tabulis eburneis auroque vestitis munivit. Schlos-
ser a réuni à ce sujet plusieurs textes dont il
; serait facile de multiplier les citations.
Le mobilier laïque utilisait l'ivoire comme le
mobilier ecclésiastique. Le 14 mars 840, Egin-
( hard envoie à son fils deux pelites colonnes
< d'ivoire, confectionnées par Eigil, et qui l'aide-
ront à comprendre quelques termes obscurs de
Yitruve. Le texte est curieux : Misi igitur tibi
j verba et nomina obscura ex libris Vitruvi... et
credo quod eorum maxima pars tibi demonstrari
possit in capsella, quant dontnus E(igil) columnis
j eburneis ad instar antiquorum operuin fabricavit.
Le Louvre possède une suite peu nombreuse,
mais extrêmement intéressante, d'ivoires caro-
lingiens. Il se produit alors comme un renouvel-
lement de cette imagerie; on y voit paraître des
sujets nouveaux et des recherches de mouve-
ments dans lesquels les sculpteurs se sont inspi-
rés surtout du Psautier qu'ils ont commenté
presque ligne à ligne, et des illustrations dont
les miniaturistes et les dessinateurs en avaient
enrichi les pages. Le rapprochement d'un dessin
du Psautier d'Utrecht et d'un ivoire du musée
national de Zurich a fourni à cet égard une dé-
monstration décisive, et M. Molinier pense, avec
toute vraisemblance, que c'est aussi de l'illusT
tration d'une Bible que s'inspira l'ivoirier caro-
lingien, auteur du n° 6 du musée. C'est une
plaque haute de 0m,153, large de 0m,082, divisée
en deux registres, où il a reconnu un sujet tiré
du Livre des Rois. Abner, accompagné d'un
soldat, sort de la ville de Gabaon, dont on aper-
çoit les murailles, et s'avance au-devant de Joab,
également escorté d'un soldat. Les douze jeunes
gens de la tribu de Benjamin, en costume caro-
lingien, tunique courte, manteau agrafé sur
l'épaule droite,chaussés de bottines, armés de
lances et de boucliers, coiffés du petit casque
dont les miniatures nous ont fait connaître beau-
coup d'exemplaires, sont assis sur les bords de
la piscine de Gabaon, sur laquelle vogue à la
voile une barque où l'on aperçoit un homme
tenant une rame-gouvernail. A gauche et en bas
de la plaque, est gravée en capitales l'inscription :
lacv gabaon. L'influence d'un dessin cursif
semble, en effet, évidente dans ce petit bas-relief
— et c'est là, assurément, un monument archéo-
logique d'une grande importance.
De la période dite romane, le Louvre possède
trois plaques, d'origine française (nos 28, 29, 30),
d'un travail très fin et se ressentant déjà de
l'influence de la grande sculpture monumentale,
qui proviennent de la décoration d'un coffret ou
d'un autel portatif et où l'on voit, sous des arca-
Lures à plein cintre, saint Denis, saint Rustique
et saint Eleulhère. Le style des ornements, —
qui est tout voisin de celui de l'église de Suger,
— permet de les placer vers le milieu du
xn°siècle... et l'on arrive, sans autre transition,
aux temps gothiques.
C'est la partie brillante et glorieuse de la col-
lection. Certes, les ivoiriers duxme siècle étaient
d'assez minces personnages, et ils suivent d'as-
sez loin et toujours avec un retard marqué leurs
grands chefs de file qui sont les maîtres de
l'œuvre et les imagiers; mais ils ont participé
de l'unité vivante et féconde de cette admirable
époque et ils onl marqué à son empreinte les
moindres figurines sorties de leurs ateliers.
« Ouiconques veust être imagiers à Paris, ce
est a savoir laillieres de crucifix, de manches à
coutiaux el de toute autre manière de taille, quele
quele soit, que de face d'os, d'yvoire, de fust et
de toute autre manière d'estoffe quele que ele
soit, estre le puet franchement... », disent les
statuts recueillis au Livre des métiers de Paris,
d'Etienne Boileau. L'os n'était employé que pour
BULLETIN DE L'ART POUR TOUS. — N« 123.
ENCYCLOPEDIEDE L'ARTINDUSTRIEL ET DECORA TIF
p&ravssarit tous les mots
Emile Reiber
Directeur - Fondateur
1861-64 o 1886-go
G. Sauvageot 1 P. Gélis-Didot
Directeur Directeur
i86s-8i i8gi-g6
Litrairies-Imprimeries reunies
^ <AV-annuel : 24Jr. ^MUlhllIIllIllllIlIlllllllIL. Ancteniv*Maison .Moral ,
im ç\ paris M
^r^^^s/ 2, rue Mignon, 2 <^__J>^r
35e Année ' 5 J^r;— Mars 1896
BULLETIN DE MARS 1896
Les Ivoires du Louvre
Dans la préface de son excellent Catalogue des
ivoires (1), M. Emile Molinier annonce que des
volumes spéciaux seront pareillement consacrés
aux bronzes, à la céramique française, italienne
el allemande, aux bois sculptés et aux meubles,
à la verrerie et aux vitraux, à la glyptique, à
l'orfèvrerie et à l'émaillerie. Ce sera, sous un
format plus maniable, comme un résumé partiel
de la grande Histoire générale des arts appliqués
à r industrie du ve et à la fin du xvnie siècle (2), que
son enseignement à l'Ecole du Louvre l'a amené
à concevoir et à entreprendre et dont le premier
volume, consacré à la sculpture sur ivoire, paraît
à peu près en même temps que le catalogue des
ivoires du musée. Il n'est pas douteux que l'ou-
vrage de Labarte, si utile qu'il soit resté et si
remarquable qu'il ait pu être en son temps, n'est
plus au courant de la science, modifiée d'année
en année et renouvelée par tant de monographies
et de contributions spéciales, et l'on ne peut que
se réjouir de voir un archéologue aussi bien ou-
tillé que M. Emile Molinier employer, à dresser
l'inventaire général de nos connaissances sur un
aussi vaste sujet, l'activité d'un esprit dont la
netteté est la qualité maîtresse et les ressources
d'une érudilion armée de toutes pièces. Celte
Histoire générale, qui sera l'œuvre de sa vie,
arrive bien à son heure, rendra de grands ser-
vices et sera bien accueillie.
Dans l'histoire de l'art, les ivoires onl, selon
les époques, une importance très inégale. Pour
toute la période comprise entre la décadence de
l'art latin et la constitution de l'art roman, ils
offrent avec les sarcophages chrétiens les plus
utiles secours et ils sont à peu près les seuls
monuments pour l'étude de la sculpture. Ils de-
viennent beaucoup plus rares dès que la statuaire
monumentale fait son apparition; — mais, entre
les mains des artisans gothiques au xmc et au
xive siècle, ils reprennent, à la suite du grand
art, une valeur documentaire el quelquefois un
intérêt artistique de premier ordre. La belle
collection du Louvre, — si heureusement enri-
chie dans la seconde moitié du siècle par les
donations Sauvageot et Davillier (pour ne citer
[\} Catalogue des Ivoires du Louvre. — 1 vol. in-8° ècu de
:t82 pages— illustré de 40 gravures d'après les dessins de M. Kricger
et d'une phototypie tirée hors texte — par M. Émile Molinier, con-
servateur du département des objets d'art, du Moyen âge, de la
Renaissance et des temps modernes. Paris, Librairies-Imprimeries
réunies, rue Mignon, 2. — Prix, cartonnage anglais, fers spéciaux,
tranches jaspées : 6 fr. 50.
(2) Cette Histoire comprendra quinze volumes in-'i°, contenant
plus de 1200 illustrations. — Librairie centrale des beaux.arts.
Paris.
que les plus importantes) et par l'acquisition de
pièces uniques comme le Couronnement de la
> Vierge, de la colleclion Soltykoff, ou comme
celle incomparable Déposition de croix entrée
hier au musée et qui va prendre dans nos vilrines
une place d'honneur, — permet de suivre sur
des exemplaires de choix l'histoire de cette
industrie qui a donné à l'art français quelques
chefs-d'œuvre.
Les plus anciens ivoires du Louvre (il n'est
ici question que d'ivoires chrétiens) remontent
au vie siècle. L'art latin est alors, — et depuis
longtemps, — en pleine décadence; — ce qu'il
; conserve encore d'apparence de vie lui vient de
\ Byzance et par elle de l'Orient, et c'est à l'art
\ byzantin qu'appartient le plus précieux morceau
! que nous ayons du xe siècle, ce triptyque, dit
> Harbaville (du nom de son premier possesseur),
i le plus beau peut-être des quinze triptyques
i byzantins aujourd'hui connus etdont M. Molinier
1 donne la liste. Ce n'est plus là une de ces pièces
1 de fabrication courante et monotone comme
| l'imagerie religieuse en présente un si grand
| nombre, non seulement à Byzance, mais dans
j lout l'Occident, et sur lesquelles on ne saurait
j équitablement juger la valeur d'un art; c'est
l'œuvre d'un artiste véritable, aussi habile à
composer son sujet qu'à draper et à dessiner ses
personnages, et sous la main duquel il semble
j qu'on voie revivre quelques-unes des vertus
j de l'art grec... On comprend aisément de quels
j secours durent être de pareils modèles pour les
sculpteurs occidentaux qui, au siècle suivant,
commencèrent à décorer les églises nouvelles
j et à faire parler la pierre.
Ils n'en étaient pas encore là à cette date et,
pendant la période carolingienne, c'est dans les
ivoires, — après les miniatures, — que nous ont
été conservés les plus intéressants témoignages
de l'imagination et de l'art des faiseurs d'images
chrétiennes. Les grandes abbayes de la Gaule
septentrionale et de l'Allemagne du Sud abritent
alors des ateliers monastiques qui sont à peine
moins féconds que ceux des couvents byzantins,
— et des uns aux autres d'ailleurs des échanges
fréquents avaient lieu. On voit au ixe siècle un
évêque de Cambrai rapporter de Constantinople
| tabulas eburneas quibus libri cooperti ibidem esse
j spectantur; et le même en faire fabriquer pulchrè
sculptas dans son diocèse. Hincmar, de Reims,
fait calligraphier les manuscrits du sermon de
saint Jérôme sur l'Assomption de la Vierge el
tabulis eburneis auroque vestitis munivit. Schlos-
ser a réuni à ce sujet plusieurs textes dont il
; serait facile de multiplier les citations.
Le mobilier laïque utilisait l'ivoire comme le
mobilier ecclésiastique. Le 14 mars 840, Egin-
( hard envoie à son fils deux pelites colonnes
< d'ivoire, confectionnées par Eigil, et qui l'aide-
ront à comprendre quelques termes obscurs de
Yitruve. Le texte est curieux : Misi igitur tibi
j verba et nomina obscura ex libris Vitruvi... et
credo quod eorum maxima pars tibi demonstrari
possit in capsella, quant dontnus E(igil) columnis
j eburneis ad instar antiquorum operuin fabricavit.
Le Louvre possède une suite peu nombreuse,
mais extrêmement intéressante, d'ivoires caro-
lingiens. Il se produit alors comme un renouvel-
lement de cette imagerie; on y voit paraître des
sujets nouveaux et des recherches de mouve-
ments dans lesquels les sculpteurs se sont inspi-
rés surtout du Psautier qu'ils ont commenté
presque ligne à ligne, et des illustrations dont
les miniaturistes et les dessinateurs en avaient
enrichi les pages. Le rapprochement d'un dessin
du Psautier d'Utrecht et d'un ivoire du musée
national de Zurich a fourni à cet égard une dé-
monstration décisive, et M. Molinier pense, avec
toute vraisemblance, que c'est aussi de l'illusT
tration d'une Bible que s'inspira l'ivoirier caro-
lingien, auteur du n° 6 du musée. C'est une
plaque haute de 0m,153, large de 0m,082, divisée
en deux registres, où il a reconnu un sujet tiré
du Livre des Rois. Abner, accompagné d'un
soldat, sort de la ville de Gabaon, dont on aper-
çoit les murailles, et s'avance au-devant de Joab,
également escorté d'un soldat. Les douze jeunes
gens de la tribu de Benjamin, en costume caro-
lingien, tunique courte, manteau agrafé sur
l'épaule droite,chaussés de bottines, armés de
lances et de boucliers, coiffés du petit casque
dont les miniatures nous ont fait connaître beau-
coup d'exemplaires, sont assis sur les bords de
la piscine de Gabaon, sur laquelle vogue à la
voile une barque où l'on aperçoit un homme
tenant une rame-gouvernail. A gauche et en bas
de la plaque, est gravée en capitales l'inscription :
lacv gabaon. L'influence d'un dessin cursif
semble, en effet, évidente dans ce petit bas-relief
— et c'est là, assurément, un monument archéo-
logique d'une grande importance.
De la période dite romane, le Louvre possède
trois plaques, d'origine française (nos 28, 29, 30),
d'un travail très fin et se ressentant déjà de
l'influence de la grande sculpture monumentale,
qui proviennent de la décoration d'un coffret ou
d'un autel portatif et où l'on voit, sous des arca-
Lures à plein cintre, saint Denis, saint Rustique
et saint Eleulhère. Le style des ornements, —
qui est tout voisin de celui de l'église de Suger,
— permet de les placer vers le milieu du
xn°siècle... et l'on arrive, sans autre transition,
aux temps gothiques.
C'est la partie brillante et glorieuse de la col-
lection. Certes, les ivoiriers duxme siècle étaient
d'assez minces personnages, et ils suivent d'as-
sez loin et toujours avec un retard marqué leurs
grands chefs de file qui sont les maîtres de
l'œuvre et les imagiers; mais ils ont participé
de l'unité vivante et féconde de cette admirable
époque et ils onl marqué à son empreinte les
moindres figurines sorties de leurs ateliers.
« Ouiconques veust être imagiers à Paris, ce
est a savoir laillieres de crucifix, de manches à
coutiaux el de toute autre manière de taille, quele
quele soit, que de face d'os, d'yvoire, de fust et
de toute autre manière d'estoffe quele que ele
soit, estre le puet franchement... », disent les
statuts recueillis au Livre des métiers de Paris,
d'Etienne Boileau. L'os n'était employé que pour
BULLETIN DE L'ART POUR TOUS. — N« 123.