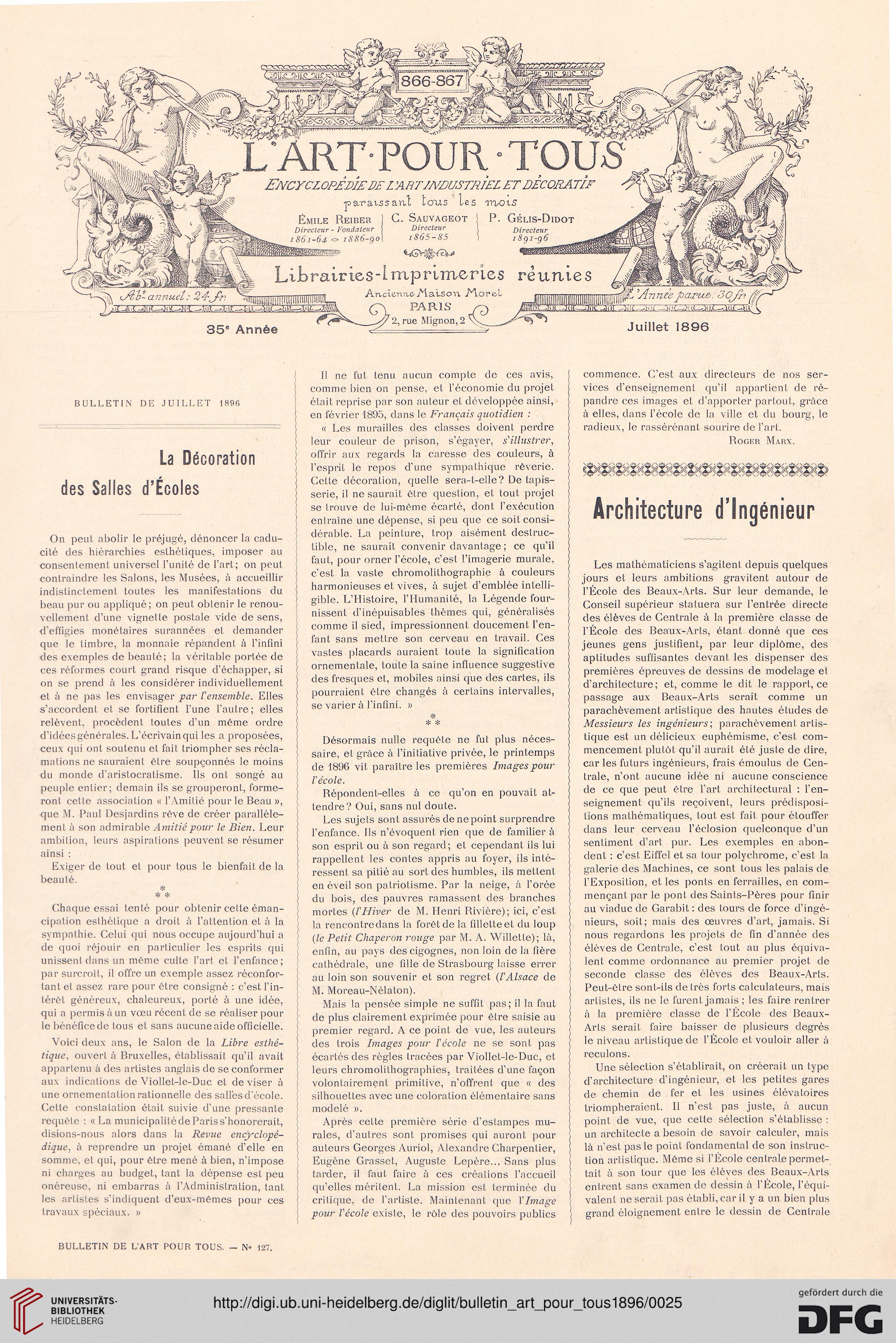ART-POUR • TOUS
Encyclopédie'de l 'art/mxjsttiiel et décora tif
T
>arai..ss arut tous les ni/OtS
G. Sauvageot 1 P. Gélis-Didot
Directeur Directe!,
Reiber
recteur - Fondateur
1886-go i865-85 T8c
irairies-Imprimeries ré
'''^^^^SwWWiiHL w^^S^^T*1 éJI
^^^^)!i;^xix^i,^¥!Ui)L^at^M (J\ PARIS iEffiV^^Vtt'J^ytf^i»^1 ^ai iT-^rz^?rrr3.Tr;cz^-i.^< i.<-^<^ ^At t^,
. t- 0^2,rueMignon,2^_^^ ^.^ 18Q6
bulletin de juillet 1896
La Décoration
des Salles d'Écoles
On peut abolir le préjugé, dénoncer la cadu-
cité des hiérarchies esthétiques, imposer au
consentement universel l'unité de l'art; on peut
contraindre les Salons, les Musées, à accueillir
indistinctement toutes les manifestations du
beau pur ou appliqué; on peut obtenir le renou-
vellement d'une vignette postale vide de sens,
d'effigies monétaires surannées et demander
que le timbre, la monnaie répandent à l'infini
des exemples de beauté; la véritable portée de
ces réformes court grand risque d'échapper, si
on se prend à les considérer individuellement
et à ne pas les envisager par Vensemble. Elles
s'accordent et se fortifient l'une l'autre; elles
relèvent, procèdent toutes d'un même ordre
d'idées générales. L'écrivain qui les a proposées, >
ceux qui ont soutenu et fait triompher ses récla-
mations ne sauraient être soupçonnés le moins
du monde d'aristocratisme. Ils ont songé au
peuple entier; demain ils se grouperont, forme-
ront cette association « l'Amitié pour le Beau »,
que M. Paul Desjardins rêve de créer parallèle-
ment à son admirable Amitié pour le Bien. Leur
ambition, leurs aspirations peuvent se résumer
ainsi :
Exiger de tout et pour tous le bienfait de la
beauté.
* (
* * j
Chaque essai lenté pour obtenir cette éman- !
cipation esthétique a droit à l'attention et à la
sympathie. Celui qui nous occupe aujourd'hui a
de quoi réjouir en particulier les esprits qui
unissent dans un même culte l'art et l'enfance;
par surcroit, il offre un exemple assez réconfor-
tant et assez rare pour être consigné : c'est l'in-
térêt généreux, chaleureux, porté à une idée,
qui a permis à un vœu récent de se réaliser pour
le bénéfice de tous et sans aucune aide officielle.
Voici deux ans, le Salon de la Libre esthé- \
tique, ouvert à Bruxelles, établissait qu'il avait
appartenu à des artistes anglais de se conformer
aux indications de Viollet-le-Duc et de viser à
une ornementation rationnelle des sallesd'école. j
Cette constatation était suivie d'une pressante !
requête : « La municipalité de Paris s'honorerait,
disions-nous alors dans la Revue encyclopé-
dique, à reprendre un projet émané d'elle en
somme, el qui, pour être mené à bien, n'impose
ni charges au budget, tant la dépense est peu
onéreuse, ni embarras à l'Administration, tant j
les artistes s'indiquent d'eux-mêmes pour ces j
travaux spéciaux. »
Il ne fut tenu aucun compte de ces avis,
comme bien on pense, et l'économie du projet
était reprise par son auteur el développée ainsi,
en février 4895, dans le Français quotidien :
« Les murailles des classes doivent perdre
leur couleur de prison, s'égayer, s'illustrer,
offrir aux regards la caresse des couleurs, à
l'esprit le repos d'une sympathique rêverie.
Cette décoration, quelle sera-t-elle? De tapis-
serie, il ne saurait être question, et tout projet
se trouve de lui-même écarté, dont l'exécution
entraîne une dépense, si peu que ce soit consi-
dérable. La peinture, trop aisément destruc-
tible, ne saurait convenir davantage ; ce qu'il
faut, pour orner l'école, c'est l'imagerie murale,
c'est la vaste chromolithographie à couleurs
harmonieuses et vives, à sujet d'emblée intelli-
gible. L'Histoire, l'Humanité, la Légende four-
nissent d'inépuisables thèmes qui, généralisés
comme il sied, impressionnent doucement l'en-
fant sans mettre son cerveau en travail. Ces
vastes placards auraient toute la signification
ornementale, toute la saine influence suggestive
des fresques et, mobiles ainsi que des cartes, ils
pourraient être changés à certains intervalles,
se varier à l'infini. »
*
* *
Désormais nulle requête ne fut plus néces-
saire, et grâce à l'initiative privée, le printemps
de 1896 vil paraître les premières Images pour
Vécole.
Bépondenl-elles à ce qu'on en pouvait at-
tendre? Oui, sans nul doute.
Les sujets sont assurés de ne point surprendre
l'enfance. Ils n'évoquent rien que de familier à
son esprit ou à son regard; et cependant ils lui
rappellent les contes appris au foyer, ils inté-
ressent sa pitié au sort des humbles, ils mettent
en éveil son patriotisme. Par la neige, à l'orée
du bois, des pauvres ramassent des branches
mortes {THiver de M. Henri Rivière); ici, c'est
la rencontre dans la forêt de la fillette el du loup
{le Petit Chaperon rouge par M. A. Willette); là,
enfin, au pays des cigognes, non loin de la fi ère
cathédrale, une fille de Strasbourg laisse errer
au loin son souvenir et son regret {l'Alsace de
M. Moreau-Nclaton).
Mais la pensée simple ne suffit pas; il la faut
de plus clairement exprimée pour être saisie au
premier regard. A ce point de vue, les auteurs
des trois Images pour Vécole ne se sonl pas
écartés des règles tracées par Viollel-le-Duc, et
leurs chromolithographies, traitées d'une façon
volontairement primitive, n'offrenl que « des
silhouettes avec une coloration élémentaire sans
modelé ».
Après cette première série d'estampes mu-
rales, d'autres sonl promises qui auront pour
auteurs Georges Auriol, Alexandre Charpentier,
Eugène Grasset, Auguste Lepère... Sans plus
larder, il faut faire à ces créations l'accueil
qu'elles méritent. La mission est terminée du
critique, de l'artiste. Maintenant que l'Image
pour Vécole existe, le rôle des pouvoirs publics
commence. C'est aux directeurs de nos ser-
vices d'enseignement qu'il appartient de ré-
pandre ces images et d'apporter partout, grâce
à elles, dans l'école de la ville et du bourg, le
radieux, le rassérénant sourire de l'art.
Roger Marx.
Architecture d'Ingénieur
Les mathématiciens s'agitent depuis quelques
jours et leurs ambitions gravitent autour de
l'École des Beaux-Arts. Sur leur demande, le
Conseil supérieur statuera sur l'entrée directe
des élèves de Centrale à la première classe de
l'École des Beaux-Arts, étant donné que ces
jeunes gens justifient, par leur diplôme, des
aptitudes suffisantes devant les dispenser des
premières épreuves de dessins de modelage el
d'architecture; et, comme le dit le rapport, ce
passage aux Beaux-Arts serait comme un
parachèvement artistique des hautes éludes de
Messieurs les ingénieurs; parachèvement artis-
tique est un délicieux euphémisme, c'est com-
mencement plutôt qu'il aurait été juste de dire,
car les futurs ingénieurs, frais émoulus de Cen-
trale, n'ont aucune idée ni aucune conscience
de ce que peut être l'art architectural : l'en-
seignement qu'ils reçoivent, leurs prédisposi-
tions mathématiques, tout est fait pour étouffer
dans leur cerveau l'éclosion quelconque d'un
sentiment d'art pur. Les exemples en abon-
dent : c'est Eiffel et sa tour polychrome, c'est la
galerie des Machines, ce sont tous les palais de
l'Exposition, et les ponts en ferrailles, en com-
mençant par le pont des Saints-Pères pour finir
au viaduc de Garabit : des tours de force d'ingé-
nieurs, soit; mais des œuvres d'art, jamais. Si
nous regardons les projets de fin d'année des
élèves de Centrale, c'est tout au plus équiva-
lent comme ordonnance au premier projet de
seconde classe des élèves des Beaux-Arts.
Peut-être sont-ils de très forts calculateurs, mais
artistes, ils ne le furent, jamais ; les faire rentrer
à la première classe de l'École des Beaux-
Arts serait faire baisser de plusieurs degrés
le niveau artistique de l'École et vouloir aller à
reculons.
Une sélection s'établirait, on créerait un type
d'architecture d'ingénieur, et les petites gares
de chemin de fer et les usines élévatoires
triompheraient. Il n'est pas juste, à aucun
point de vue, que cette sélection s'établisse :
un architecte a besoin de savoir calculer, mais
là n'est pas le point fondamental de son instruc-
tion artistique. Même si l'École centrale permet-
tait à son tour que les élèves des Beaux-Arts
entrent sans examende dessin à l'Ecole, l'équi-
valent ne serait pas établi, car il y a un bien plus
grand éloignement entre le dessin de Centrale
bulletin de l'art pour tous. — n° 127.
Encyclopédie'de l 'art/mxjsttiiel et décora tif
T
>arai..ss arut tous les ni/OtS
G. Sauvageot 1 P. Gélis-Didot
Directeur Directe!,
Reiber
recteur - Fondateur
1886-go i865-85 T8c
irairies-Imprimeries ré
'''^^^^SwWWiiHL w^^S^^T*1 éJI
^^^^)!i;^xix^i,^¥!Ui)L^at^M (J\ PARIS iEffiV^^Vtt'J^ytf^i»^1 ^ai iT-^rz^?rrr3.Tr;cz^-i.^< i.<-^<^ ^At t^,
. t- 0^2,rueMignon,2^_^^ ^.^ 18Q6
bulletin de juillet 1896
La Décoration
des Salles d'Écoles
On peut abolir le préjugé, dénoncer la cadu-
cité des hiérarchies esthétiques, imposer au
consentement universel l'unité de l'art; on peut
contraindre les Salons, les Musées, à accueillir
indistinctement toutes les manifestations du
beau pur ou appliqué; on peut obtenir le renou-
vellement d'une vignette postale vide de sens,
d'effigies monétaires surannées et demander
que le timbre, la monnaie répandent à l'infini
des exemples de beauté; la véritable portée de
ces réformes court grand risque d'échapper, si
on se prend à les considérer individuellement
et à ne pas les envisager par Vensemble. Elles
s'accordent et se fortifient l'une l'autre; elles
relèvent, procèdent toutes d'un même ordre
d'idées générales. L'écrivain qui les a proposées, >
ceux qui ont soutenu et fait triompher ses récla-
mations ne sauraient être soupçonnés le moins
du monde d'aristocratisme. Ils ont songé au
peuple entier; demain ils se grouperont, forme-
ront cette association « l'Amitié pour le Beau »,
que M. Paul Desjardins rêve de créer parallèle-
ment à son admirable Amitié pour le Bien. Leur
ambition, leurs aspirations peuvent se résumer
ainsi :
Exiger de tout et pour tous le bienfait de la
beauté.
* (
* * j
Chaque essai lenté pour obtenir cette éman- !
cipation esthétique a droit à l'attention et à la
sympathie. Celui qui nous occupe aujourd'hui a
de quoi réjouir en particulier les esprits qui
unissent dans un même culte l'art et l'enfance;
par surcroit, il offre un exemple assez réconfor-
tant et assez rare pour être consigné : c'est l'in-
térêt généreux, chaleureux, porté à une idée,
qui a permis à un vœu récent de se réaliser pour
le bénéfice de tous et sans aucune aide officielle.
Voici deux ans, le Salon de la Libre esthé- \
tique, ouvert à Bruxelles, établissait qu'il avait
appartenu à des artistes anglais de se conformer
aux indications de Viollet-le-Duc et de viser à
une ornementation rationnelle des sallesd'école. j
Cette constatation était suivie d'une pressante !
requête : « La municipalité de Paris s'honorerait,
disions-nous alors dans la Revue encyclopé-
dique, à reprendre un projet émané d'elle en
somme, el qui, pour être mené à bien, n'impose
ni charges au budget, tant la dépense est peu
onéreuse, ni embarras à l'Administration, tant j
les artistes s'indiquent d'eux-mêmes pour ces j
travaux spéciaux. »
Il ne fut tenu aucun compte de ces avis,
comme bien on pense, et l'économie du projet
était reprise par son auteur el développée ainsi,
en février 4895, dans le Français quotidien :
« Les murailles des classes doivent perdre
leur couleur de prison, s'égayer, s'illustrer,
offrir aux regards la caresse des couleurs, à
l'esprit le repos d'une sympathique rêverie.
Cette décoration, quelle sera-t-elle? De tapis-
serie, il ne saurait être question, et tout projet
se trouve de lui-même écarté, dont l'exécution
entraîne une dépense, si peu que ce soit consi-
dérable. La peinture, trop aisément destruc-
tible, ne saurait convenir davantage ; ce qu'il
faut, pour orner l'école, c'est l'imagerie murale,
c'est la vaste chromolithographie à couleurs
harmonieuses et vives, à sujet d'emblée intelli-
gible. L'Histoire, l'Humanité, la Légende four-
nissent d'inépuisables thèmes qui, généralisés
comme il sied, impressionnent doucement l'en-
fant sans mettre son cerveau en travail. Ces
vastes placards auraient toute la signification
ornementale, toute la saine influence suggestive
des fresques et, mobiles ainsi que des cartes, ils
pourraient être changés à certains intervalles,
se varier à l'infini. »
*
* *
Désormais nulle requête ne fut plus néces-
saire, et grâce à l'initiative privée, le printemps
de 1896 vil paraître les premières Images pour
Vécole.
Bépondenl-elles à ce qu'on en pouvait at-
tendre? Oui, sans nul doute.
Les sujets sont assurés de ne point surprendre
l'enfance. Ils n'évoquent rien que de familier à
son esprit ou à son regard; et cependant ils lui
rappellent les contes appris au foyer, ils inté-
ressent sa pitié au sort des humbles, ils mettent
en éveil son patriotisme. Par la neige, à l'orée
du bois, des pauvres ramassent des branches
mortes {THiver de M. Henri Rivière); ici, c'est
la rencontre dans la forêt de la fillette el du loup
{le Petit Chaperon rouge par M. A. Willette); là,
enfin, au pays des cigognes, non loin de la fi ère
cathédrale, une fille de Strasbourg laisse errer
au loin son souvenir et son regret {l'Alsace de
M. Moreau-Nclaton).
Mais la pensée simple ne suffit pas; il la faut
de plus clairement exprimée pour être saisie au
premier regard. A ce point de vue, les auteurs
des trois Images pour Vécole ne se sonl pas
écartés des règles tracées par Viollel-le-Duc, et
leurs chromolithographies, traitées d'une façon
volontairement primitive, n'offrenl que « des
silhouettes avec une coloration élémentaire sans
modelé ».
Après cette première série d'estampes mu-
rales, d'autres sonl promises qui auront pour
auteurs Georges Auriol, Alexandre Charpentier,
Eugène Grasset, Auguste Lepère... Sans plus
larder, il faut faire à ces créations l'accueil
qu'elles méritent. La mission est terminée du
critique, de l'artiste. Maintenant que l'Image
pour Vécole existe, le rôle des pouvoirs publics
commence. C'est aux directeurs de nos ser-
vices d'enseignement qu'il appartient de ré-
pandre ces images et d'apporter partout, grâce
à elles, dans l'école de la ville et du bourg, le
radieux, le rassérénant sourire de l'art.
Roger Marx.
Architecture d'Ingénieur
Les mathématiciens s'agitent depuis quelques
jours et leurs ambitions gravitent autour de
l'École des Beaux-Arts. Sur leur demande, le
Conseil supérieur statuera sur l'entrée directe
des élèves de Centrale à la première classe de
l'École des Beaux-Arts, étant donné que ces
jeunes gens justifient, par leur diplôme, des
aptitudes suffisantes devant les dispenser des
premières épreuves de dessins de modelage el
d'architecture; et, comme le dit le rapport, ce
passage aux Beaux-Arts serait comme un
parachèvement artistique des hautes éludes de
Messieurs les ingénieurs; parachèvement artis-
tique est un délicieux euphémisme, c'est com-
mencement plutôt qu'il aurait été juste de dire,
car les futurs ingénieurs, frais émoulus de Cen-
trale, n'ont aucune idée ni aucune conscience
de ce que peut être l'art architectural : l'en-
seignement qu'ils reçoivent, leurs prédisposi-
tions mathématiques, tout est fait pour étouffer
dans leur cerveau l'éclosion quelconque d'un
sentiment d'art pur. Les exemples en abon-
dent : c'est Eiffel et sa tour polychrome, c'est la
galerie des Machines, ce sont tous les palais de
l'Exposition, et les ponts en ferrailles, en com-
mençant par le pont des Saints-Pères pour finir
au viaduc de Garabit : des tours de force d'ingé-
nieurs, soit; mais des œuvres d'art, jamais. Si
nous regardons les projets de fin d'année des
élèves de Centrale, c'est tout au plus équiva-
lent comme ordonnance au premier projet de
seconde classe des élèves des Beaux-Arts.
Peut-être sont-ils de très forts calculateurs, mais
artistes, ils ne le furent, jamais ; les faire rentrer
à la première classe de l'École des Beaux-
Arts serait faire baisser de plusieurs degrés
le niveau artistique de l'École et vouloir aller à
reculons.
Une sélection s'établirait, on créerait un type
d'architecture d'ingénieur, et les petites gares
de chemin de fer et les usines élévatoires
triompheraient. Il n'est pas juste, à aucun
point de vue, que cette sélection s'établisse :
un architecte a besoin de savoir calculer, mais
là n'est pas le point fondamental de son instruc-
tion artistique. Même si l'École centrale permet-
tait à son tour que les élèves des Beaux-Arts
entrent sans examende dessin à l'Ecole, l'équi-
valent ne serait pas établi, car il y a un bien plus
grand éloignement entre le dessin de Centrale
bulletin de l'art pour tous. — n° 127.