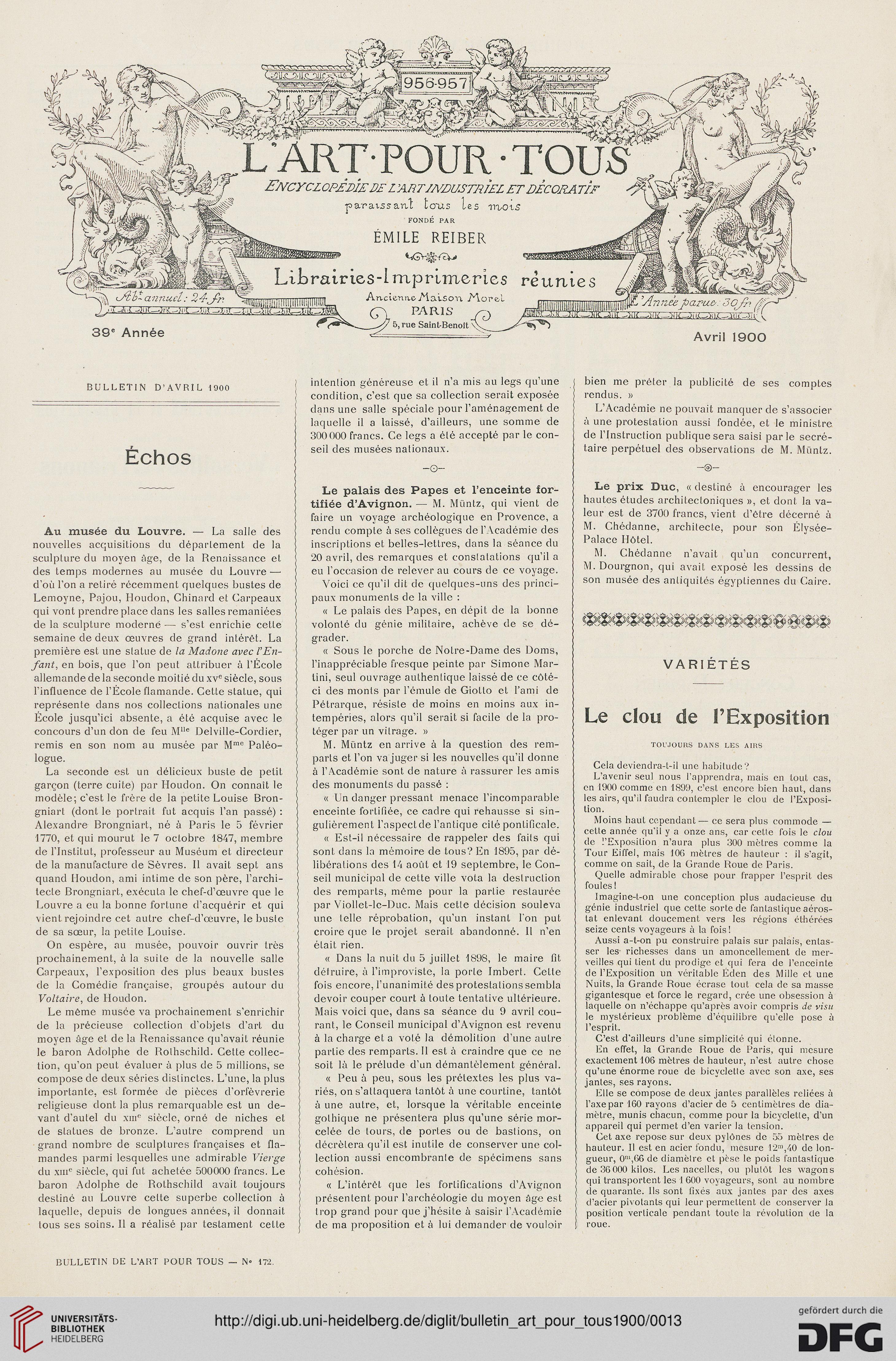LÀRTPOUR-TOUS
FNCYCLOPÊdÎE de L ART INDUSTRIEL ET DECORATIF
Y>&v3.iss ant tous les itwhs
FONDÉ PAR
EMILE REIBER
Litratries-imprimertes réunies
tyî'b* annuel : 24" fr. ^FiiiiHnii'iinMiniiiiiiiiiiimm Ancienne- /Maison IA.ove.1 ,,,,.......................
^—j!Mfflil"ll|il11"^ r~\ park. ^ .rJlililii pu iliiiiiiii .pMiiii^ ""'■"Vf"*™- ^y/^fir
5, rue Saint-Benoit V
Avril 1900
BULLETIN D'AVRIL 1900
Échos
Au musée du Louvre. — La salle des
nouvelles acquisitions du déparlement de la
sculpture du moyen âge, de la Renaissance et
des temps modernes au musée du Louvre —
d'où l'on a retiré récemment quelques bustes de
Lemoyne, Pajou, Houdon, Chinard et Carpeaux
qui vont prendre place dans les salles remaniées
de la sculpture moderne — s'est enrichie cette
semaine de deux œuvres de grand intérêt. La
première est une slatue de la Madone avec l'En-
fant, en bois, que l'on peut attribuer à l'Ecole
allemande de la seconde moitié du xve siècle, sous
l'influence de l'Ecole flamande. Cette statue, qui
représente dans nos collections nationales une
Ecole jusqu'ici absente, a été acquise avec le
concours d'un don de feu M"e Delville-Cordier,
remis en son nom au musée par Mme Paléo-
logue.
La seconde est un délicieux buste de petit
garçon (terre cuite) par Houdon. On connaît le
modèle; c'est le frère de la petite Louise Bron-
gniarl (dont le portrait fut acquis l'an passé) :
Alexandre Brongniart, né à Paris le 5 février
1770, et qui mourut le 7 octobre 1847, membre
de l'Institut, professeur au Muséum et directeur
de la manufacture de Sèvres. Il avait sept ans
quand Houdon, ami intime de son père, l'archi-
tecte Brongniart, exécuta le chef-d'œuvre que le
Louvre a eu la bonne fortune d'acquérir et qui
vient rejoindre cet autre chef-d'œuvre, le buste
de sa sœur, la petite Louise.
On espère, au musée, pouvoir ouvrir très
prochainement, à la suite de la nouvelle salle
Carpeaux, l'exposition des plus beaux bustes
de la Comédie française, groupés autour du
Voltaire, de Houdon.
Le même musée va prochainement s'enrichir
de la précieuse collection d'objets d'art du
moyen âge et de la Renaissance qu'avait réunie
le baron Adolphe de Rolhschild. Cette collec-
tion, qu'on peut évaluer à plus de 5 millions, se
compose de deux séries distinctes. L'une, la plus
importante, est formée de pièces d'orfèvrerie
religieuse dont la plus remarquable est un de-
vant d'autel du xme siècle, orné de niches et
de statues de bronze. L'autre comprend un
grand nombre de sculptures françaises et fla-
mandes parmi lesquelles une admirable Vierge
du xinc siècle, qui fut achetée 500000 francs. Le
baron Adolphe de Rothschild avait toujours
destiné au Louvre cette superbe collection à
laquelle, depuis de longues années, il donnait
tous ses soins. Il a réalisé par testament cette
intention généreuse et il n'a mis au legs qu'une
condition, c'est que sa collection serait exposée
dans une salle spéciale pour l'aménagement de
laquelle il a laissé, d'ailleurs, une somme de
300 000 francs. Ce legs a été accepté par le con-
seil des musées nationaux.
-O-
Le palais des Papes et l'enceinte for-
tifiée d'Avignon. — M. Mùntz, qui vient de
faire un voyage archéologique en Provence, a
rendu compte à ses collègues de l'Académie des
inscriptions et belles-lettres, dans la séance du
20 avril, des remarques et constatations qu'il a
eu l'occasion de relever au cours de ce voyage.
Voici ce qu'il dit de quelques-uns des princi-
paux monuments de la ville :
« Le palais des Papes, en dépit de la bonne
volonté du génie militaire, achève de se dé-
grader.
« Sous le porche de Notre-Dame des Doms,
l'inappréciable fresque peinte par Simone Mar-
tini, seul ouvrage authentique laissé de ce côté-
ci des monts par l'émule de Giolto et l'ami de
Pétrarque, résiste de moins en moins aux in-
tempéries, alors qu'il serait si facile de la pro-
téger par un vitrage. »
M. Mùntz en arrive à la question des rem-
parts et l'on va juger si les nouvelles qu'il donne
à l'Académie sont de nature à rassurer les amis
des monuments du passé :
« Un danger pressant menace l'incomparable
enceinte fortifiée, ce cadre qui rehausse si sin-
gulièrement l'aspectde l'antique cité pontificale.
« Est-il nécessaire de rappeler des faits qui
sont dans la mémoire de tous? En 1895, par dé-
libérations des 14 août et 19 septembre, le Con-
seil municipal de cette ville vota la destruction
des remparts, même pour la partie restaurée
par Viollet-lc-Duc. Mais cette décision souleva
une telle réprobation, qu'un instant l'on put
croire que le projet serait abandonné. Il n'en
était rien.
« Dans la nuit du 5 juillet 1898, le maire fit
détruire, à l'improviste, la porte Imbert. Cette
fois encore, l'unanimité des protestations sembla
devoir couper court à toute tentative ultérieure.
Mais voici que, dans sa séance du 9 avril cou-
rant, le Conseil municipal d'Avignon est revenu
à la charge et a volé la démolition d'une autre
partie des remparts. Il est à craindre que ce ne
soit là le prélude d'un démantèlement général.
« Peu à peu, sous les prétextes les plus va-
riés, on s'attaquera tantôt à une courtine, tantôt
à une autre, et, lorsque la véritable enceinte
gothique ne présentera plus qu'une série mor-
celée de tours, de portes ou de bastions, on
décrétera qu'il est inutile de conserver une col-
lection aussi encombrante de spécimens sans
cohésion.
« L'intérêt que les fortifications d'Avignon
présentent pour l'archéologie du moyen âge est
trop grand pour que j'hésite à saisir l'Académie
de ma proposition et à lui demander de vouloir
bien me prêter la publicité de ses comptes
rendus. »
L'Académie ne pouvait manquer de s'associer
à une protestation aussi fondée, et le ministre
de l'Instruction publique sera saisi par le secré-
taire perpétuel des observations de M. Mùntz.
-®-
Le prix Duc, « destiné à encourager les
hautes études architectoniques », et dont la va-
leur est de 3700 francs, vient d'être décerné à
M. Chédanne, architecte, pour son Elysée-
Palace Hôtel.
M. Chédanne n'avait qu'un concurrent,
M.Dourgnon, qui avait exposé les dessins de
son musée des antiquités égyptiennes du Caire.
VARIÉTÉS
Le clou de l'Exposition
TOUJOURS DANS LES AIRS
Cela deviendra-t-il une habitude?
L'avenir seul nous l'apprendra, mais en tout cas,
en 1900 comme en 1899, c'est encore bien haut, dans
les airs, qu'il faudra contempler le clou de l'Exposi-
tion.
Moins haut cependant— ce sera plus commode —
cette année qu'il y a onze ans, car cette fois le clou
de l'Exposition n'aura plus 300 mètres comme la
Tour Eiffel, mais 106 mètres de hauteur : il s'agit,
comme on sait, de la Grande Roue de Paris.
Quelle admirable chose pour frapper l'esprit des
foules !
Imagine-l-on une conception plus audacieuse du
génie industriel que cette sorte de fantastique aéros-
tat enlevant doucement vers les régions ethérées
seize cents voyageurs à la fois !
Aussi a-t-on pu construire palais sur palais, entas-
ser les- richesses dans un amoncellement de mer-
veilles qui tient du prodige et qui fera de l'enceinte
de l'Exposition un véritable Ëden des Mille et une
Nuits, la Grande Roue écrase tout cela de sa masse
gigantesque et force le regard, crée une obsession à
laquelle on n'échappe qu'après avoir compris de visu
le mystérieux problème d'équilibre qu'elle pose à
l'esprit.
C'est d'ailleurs d'une simplicité qui étonne.
En effet, la Grande Roue de Paris, qui mesure
exactement 106 mètres de hauteur, n'est autre chose
qu'une énorme roue de bicyclette avec son axe, ses
jantes, ses rayons.
Elle se compose de deux jantes parallèles reliées à
l'axe par 160 rayons d'acier de 5 centimètres de dia-
mètre, munis chacun, comme pour la bicyclette, d'un
appareil qui permet d'en varier la tension.
Cet axe repose sur deux pylônes de 55 mètres de
hauteur. Il est en acier fondu, mesure 12™,40 de lon-
gueur, 0m,66 de diamètre et pèse le poids fantastique
de 36 000 kilos. Les nacelles, ou plutôt les wagons
qui transportent les 1 600 voyageurs, sont au nombre
de quarante. Ils sont fixés aux jantes par des axes
d'acier pivotants qui leur permettent de conserver la
position verticale pendant toute la révolution de la
roue.
BULLETIN DE L'ART POUR TOUS — N° 172
FNCYCLOPÊdÎE de L ART INDUSTRIEL ET DECORATIF
Y>&v3.iss ant tous les itwhs
FONDÉ PAR
EMILE REIBER
Litratries-imprimertes réunies
tyî'b* annuel : 24" fr. ^FiiiiHnii'iinMiniiiiiiiiiiimm Ancienne- /Maison IA.ove.1 ,,,,.......................
^—j!Mfflil"ll|il11"^ r~\ park. ^ .rJlililii pu iliiiiiiii .pMiiii^ ""'■"Vf"*™- ^y/^fir
5, rue Saint-Benoit V
Avril 1900
BULLETIN D'AVRIL 1900
Échos
Au musée du Louvre. — La salle des
nouvelles acquisitions du déparlement de la
sculpture du moyen âge, de la Renaissance et
des temps modernes au musée du Louvre —
d'où l'on a retiré récemment quelques bustes de
Lemoyne, Pajou, Houdon, Chinard et Carpeaux
qui vont prendre place dans les salles remaniées
de la sculpture moderne — s'est enrichie cette
semaine de deux œuvres de grand intérêt. La
première est une slatue de la Madone avec l'En-
fant, en bois, que l'on peut attribuer à l'Ecole
allemande de la seconde moitié du xve siècle, sous
l'influence de l'Ecole flamande. Cette statue, qui
représente dans nos collections nationales une
Ecole jusqu'ici absente, a été acquise avec le
concours d'un don de feu M"e Delville-Cordier,
remis en son nom au musée par Mme Paléo-
logue.
La seconde est un délicieux buste de petit
garçon (terre cuite) par Houdon. On connaît le
modèle; c'est le frère de la petite Louise Bron-
gniarl (dont le portrait fut acquis l'an passé) :
Alexandre Brongniart, né à Paris le 5 février
1770, et qui mourut le 7 octobre 1847, membre
de l'Institut, professeur au Muséum et directeur
de la manufacture de Sèvres. Il avait sept ans
quand Houdon, ami intime de son père, l'archi-
tecte Brongniart, exécuta le chef-d'œuvre que le
Louvre a eu la bonne fortune d'acquérir et qui
vient rejoindre cet autre chef-d'œuvre, le buste
de sa sœur, la petite Louise.
On espère, au musée, pouvoir ouvrir très
prochainement, à la suite de la nouvelle salle
Carpeaux, l'exposition des plus beaux bustes
de la Comédie française, groupés autour du
Voltaire, de Houdon.
Le même musée va prochainement s'enrichir
de la précieuse collection d'objets d'art du
moyen âge et de la Renaissance qu'avait réunie
le baron Adolphe de Rolhschild. Cette collec-
tion, qu'on peut évaluer à plus de 5 millions, se
compose de deux séries distinctes. L'une, la plus
importante, est formée de pièces d'orfèvrerie
religieuse dont la plus remarquable est un de-
vant d'autel du xme siècle, orné de niches et
de statues de bronze. L'autre comprend un
grand nombre de sculptures françaises et fla-
mandes parmi lesquelles une admirable Vierge
du xinc siècle, qui fut achetée 500000 francs. Le
baron Adolphe de Rothschild avait toujours
destiné au Louvre cette superbe collection à
laquelle, depuis de longues années, il donnait
tous ses soins. Il a réalisé par testament cette
intention généreuse et il n'a mis au legs qu'une
condition, c'est que sa collection serait exposée
dans une salle spéciale pour l'aménagement de
laquelle il a laissé, d'ailleurs, une somme de
300 000 francs. Ce legs a été accepté par le con-
seil des musées nationaux.
-O-
Le palais des Papes et l'enceinte for-
tifiée d'Avignon. — M. Mùntz, qui vient de
faire un voyage archéologique en Provence, a
rendu compte à ses collègues de l'Académie des
inscriptions et belles-lettres, dans la séance du
20 avril, des remarques et constatations qu'il a
eu l'occasion de relever au cours de ce voyage.
Voici ce qu'il dit de quelques-uns des princi-
paux monuments de la ville :
« Le palais des Papes, en dépit de la bonne
volonté du génie militaire, achève de se dé-
grader.
« Sous le porche de Notre-Dame des Doms,
l'inappréciable fresque peinte par Simone Mar-
tini, seul ouvrage authentique laissé de ce côté-
ci des monts par l'émule de Giolto et l'ami de
Pétrarque, résiste de moins en moins aux in-
tempéries, alors qu'il serait si facile de la pro-
téger par un vitrage. »
M. Mùntz en arrive à la question des rem-
parts et l'on va juger si les nouvelles qu'il donne
à l'Académie sont de nature à rassurer les amis
des monuments du passé :
« Un danger pressant menace l'incomparable
enceinte fortifiée, ce cadre qui rehausse si sin-
gulièrement l'aspectde l'antique cité pontificale.
« Est-il nécessaire de rappeler des faits qui
sont dans la mémoire de tous? En 1895, par dé-
libérations des 14 août et 19 septembre, le Con-
seil municipal de cette ville vota la destruction
des remparts, même pour la partie restaurée
par Viollet-lc-Duc. Mais cette décision souleva
une telle réprobation, qu'un instant l'on put
croire que le projet serait abandonné. Il n'en
était rien.
« Dans la nuit du 5 juillet 1898, le maire fit
détruire, à l'improviste, la porte Imbert. Cette
fois encore, l'unanimité des protestations sembla
devoir couper court à toute tentative ultérieure.
Mais voici que, dans sa séance du 9 avril cou-
rant, le Conseil municipal d'Avignon est revenu
à la charge et a volé la démolition d'une autre
partie des remparts. Il est à craindre que ce ne
soit là le prélude d'un démantèlement général.
« Peu à peu, sous les prétextes les plus va-
riés, on s'attaquera tantôt à une courtine, tantôt
à une autre, et, lorsque la véritable enceinte
gothique ne présentera plus qu'une série mor-
celée de tours, de portes ou de bastions, on
décrétera qu'il est inutile de conserver une col-
lection aussi encombrante de spécimens sans
cohésion.
« L'intérêt que les fortifications d'Avignon
présentent pour l'archéologie du moyen âge est
trop grand pour que j'hésite à saisir l'Académie
de ma proposition et à lui demander de vouloir
bien me prêter la publicité de ses comptes
rendus. »
L'Académie ne pouvait manquer de s'associer
à une protestation aussi fondée, et le ministre
de l'Instruction publique sera saisi par le secré-
taire perpétuel des observations de M. Mùntz.
-®-
Le prix Duc, « destiné à encourager les
hautes études architectoniques », et dont la va-
leur est de 3700 francs, vient d'être décerné à
M. Chédanne, architecte, pour son Elysée-
Palace Hôtel.
M. Chédanne n'avait qu'un concurrent,
M.Dourgnon, qui avait exposé les dessins de
son musée des antiquités égyptiennes du Caire.
VARIÉTÉS
Le clou de l'Exposition
TOUJOURS DANS LES AIRS
Cela deviendra-t-il une habitude?
L'avenir seul nous l'apprendra, mais en tout cas,
en 1900 comme en 1899, c'est encore bien haut, dans
les airs, qu'il faudra contempler le clou de l'Exposi-
tion.
Moins haut cependant— ce sera plus commode —
cette année qu'il y a onze ans, car cette fois le clou
de l'Exposition n'aura plus 300 mètres comme la
Tour Eiffel, mais 106 mètres de hauteur : il s'agit,
comme on sait, de la Grande Roue de Paris.
Quelle admirable chose pour frapper l'esprit des
foules !
Imagine-l-on une conception plus audacieuse du
génie industriel que cette sorte de fantastique aéros-
tat enlevant doucement vers les régions ethérées
seize cents voyageurs à la fois !
Aussi a-t-on pu construire palais sur palais, entas-
ser les- richesses dans un amoncellement de mer-
veilles qui tient du prodige et qui fera de l'enceinte
de l'Exposition un véritable Ëden des Mille et une
Nuits, la Grande Roue écrase tout cela de sa masse
gigantesque et force le regard, crée une obsession à
laquelle on n'échappe qu'après avoir compris de visu
le mystérieux problème d'équilibre qu'elle pose à
l'esprit.
C'est d'ailleurs d'une simplicité qui étonne.
En effet, la Grande Roue de Paris, qui mesure
exactement 106 mètres de hauteur, n'est autre chose
qu'une énorme roue de bicyclette avec son axe, ses
jantes, ses rayons.
Elle se compose de deux jantes parallèles reliées à
l'axe par 160 rayons d'acier de 5 centimètres de dia-
mètre, munis chacun, comme pour la bicyclette, d'un
appareil qui permet d'en varier la tension.
Cet axe repose sur deux pylônes de 55 mètres de
hauteur. Il est en acier fondu, mesure 12™,40 de lon-
gueur, 0m,66 de diamètre et pèse le poids fantastique
de 36 000 kilos. Les nacelles, ou plutôt les wagons
qui transportent les 1 600 voyageurs, sont au nombre
de quarante. Ils sont fixés aux jantes par des axes
d'acier pivotants qui leur permettent de conserver la
position verticale pendant toute la révolution de la
roue.
BULLETIN DE L'ART POUR TOUS — N° 172