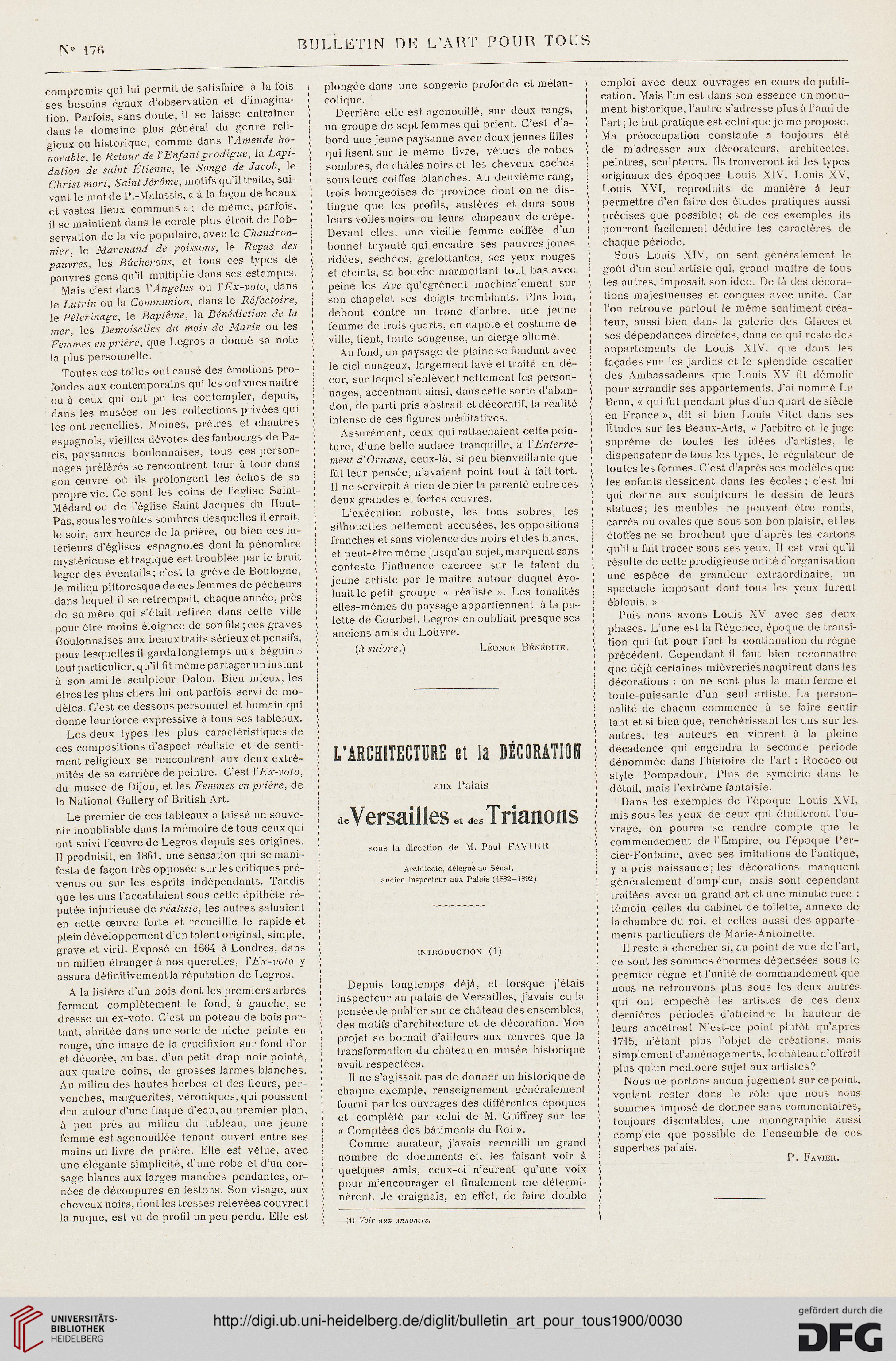IN° 176
BULLETIN DE L'ART POUR TOUS
compromis qui lui permît de satisfaire à la fois
ses besoins égaux d'observation et d'imagina-
tion. Parfois, sans doute, il se laisse entraîner
clans le domaine plus général du genre reli-
gieux ou historique, comme dans Y Amende ho-
norable, le Retour de V Enfant prodigue, la Lapi-
dation de saint Étienne, le Songe de Jacob, le
Christ mort, Saint Jérôme, motifs qu'il traite, sui-
vant le mot de P.-Malassis, « à la façon de beaux
et vastes lieux communs » ; de même, parfois,
il se maintient dans le cercle plus étroit de l'ob-
servation de la vie populaire, avec le Chaudron-
nier, le Marchand de poissons, le Repas des
pauvres, les Bûcherons, et tous ces types de
pauvres gens qu'il multiplie dans ses estampes.
Mais c'est dans Y Angélus ou Y Ex-voto, dans
le Lutrin ou la Communion, dans le Réfectoire,
le Pèlerinage, le Baptême, la Bénédiction de la
mer, les Demoiselles du mois de Marie ou les
Femmes en prière, que Legros a donné sa note
la plus personnelle.
Toutes ces toiles ont causé des émotions pro-
fondes aux contemporains qui les ont vues naître
ou à ceux qui ont pu les contempler, depuis,
dans les musées ou les collections privées qui
les ont recuellies. Moines, prêtres et chantres
espagnols, vieilles dévotes des faubourgs de Pa-
ris, paysannes boulonnaises, tous ces person-
nages préférés se rencontrent tour à tour dans
son œuvre où ils prolongent les échos de sa
propre vie. Ce sont les coins de l'église Saint-
Médard ou de l'église Saint-Jacques du Haut-
Pas, sous les voûtes sombres desquelles il errait,
le soir, aux heures de la prière, ou bien ces in-
térieurs d'églises espagnoles dont la pénombre
mystérieuse et tragique est troublée par le bruit
léger des éventails; c'est la grève de Boulogne,
le milieu pittoresque de ces femmes de pêcheurs
dans lequel il se retrempait, chaque année, près
de sa mère qui s'était retirée dans cette ville
pour être moins éloignée de son fils; ces graves
Boulonnaises aux beaux traits sérieux et pensifs,
pour lesquelles il gardalongtemps un « béguin»
tout particulier, qu'il fit môme partager un instant
à son ami le sculpteur Dalou. Bien mieux, les
êtres les plus chers lui ont parfois servi de mo-
dèles. C'est ce dessous personnel et humain qui
donne leur force expressive à tous ses tableaux.
Les deux types les plus caractéristiques de
ces compositions d'aspect réaliste et de senti-
ment religieux se rencontrent aux deux extré-
mités de sa carrière de peintre. C'est YEx-voto,
du musée de Dijon, et les Femmes en prière, de
la National Gallery of British Art.
Le premier de ces tableaux a laissé un souve-
nir inoubliable dans la mémoire de tous ceux qui
ont suivi l'œuvre de Legros depuis ses origines.
11 produisit, en 1861, une sensation qui se mani-
festa de façon très opposée sur les critiques pré-
venus ou sur les esprits indépendants. Tandis
que les uns l'accablaient sous celle épithète ré-
putée injurieuse de réaliste, les autres saluaient
en cette œuvre forte et recueillie le rapide et
plein développement d'un talent original, simple,
grave et viril. Exposé en 1864 à Londres, dans
un milieu étranger à nos querelles, YEx-voto y
assura définitivement la réputation de Legros.
A la lisière d'un bois dont les premiers arbres
ferment complètement le fond, à gauche, se
dresse un ex-voto. C'est un poteau de bois por-
tant, abritée dans une sorte de niche peinte en
rouge, une image de la crucifixion sur fond d'or
et décorée, au bas, d'un petit drap noir pointé,
aux quatre coins, de grosses larmes blanches.
Au milieu des hautes herbes et des fleurs, per-
venches, marguerites, véroniques, qui poussent
dru autour d'une flaque d'eau, au premier plan,
à peu près au milieu du tableau, une jeune
femme est agenouillée tenant ouvert entre ses
mains un livre de prière. Elle est vêtue, avec
une élégante simplicité, d'une robe et d'un cor-
sage blancs aux larges manches pendantes, or-
nées de découpures en lestons. Son visage, aux
cheveux noirs, dont les tresses relevées couvrent
la nuque, est vu de profil un peu perdu. Elle est
plongée dans une songerie profonde et mélan-
colique.
Derrière elle est agenouillé, sur deux rangs,
un groupe de sept femmes qui prient. C'est d'a-
bord une jeune paysanne avec deux jeunes filles
qui lisent sur le même livre, vêtues de robes
sombres, de châles noirs et les cheveux cachés
sous leurs coiffes blanches. Au deuxième rang,
trois bourgeoises de province dont on ne dis-
tingue que les profils, austères et durs sous
leurs voiles noirs ou leurs chapeaux de crêpe.
Devant elles, une vieille femme coiffée d'un
bonnet tuyauté qui encadre ses pauvres joues
ridées, séchées, grelottantes, ses yeux rouges
et éteints, sa bouche marmoltant tout bas avec
peine les Ave qu'égrènent machinalement sur
son chapelet ses doigts tremblants. Plus loin,
debout contre un tronc d'arbre, une jeune
femme de trois quarts, en capote et costume de
ville, tient, toute songeuse, un cierge allumé.
Au fond, un paysage de plaine se fondant avec
le ciel nuageux, largement lavé et traité en dé-
cor, sur lequel s'enlèvent nettement les person-
nages, accentuant ainsi, dans cette sorte d'aban-
don, de parti pris abstrait et décoratif, la réalité
intense de ces figures méditatives.
Assurément, ceux qui rattachaient cette pein-
ture, d'une belle audace tranquille, à YEnterre-
ment d'Ornans, ceux-là, si peu bienveillante que
fût leur pensée, n'avaient point tout à fait tort.
II ne servirait à rien denier la parenté entre ces
deux grandes et fortes œuvres.
L'exécution robuste, les tons sobres, les
silhouettes nettement accusées, les oppositions
franches et sans violence des noirs et des blancs,
et peut-être même jusqu'au sujet, marquent sans
conteste l'influence exercée sur le talent du
jeune artiste par le maître autour duquel évo-
luait le petit groupe « réaliste ». Les tonalités
elles-mêmes du paysage appartiennent à la pa-
lette de Courbet. Legros en oubliait presque ses
anciens amis du Louvre.
(à suivre.) Léonce Bénédite.
L'ARCHITECTURE et la DÉCORATION
aux Palais
^Versailles et des Trianons
sous la direction de M. Paul FAVI E R
Architecte, délégué au Sénat,
ancien inspecteur aux Palais (1882—1802)
introduction (1)
Depuis longtemps déjà, et lorsque j'étais
inspecteur au palais de Versailles, j'avais eu la
pensée de publier sur ce château des ensembles,
des motifs d'architecture et de décoration. Mon
projet se bornait d'ailleurs aux œuvres que la
transformation du château en musée historique
avait respectées.
Il ne s'agissait pas de donner un historique de
chaque exemple, renseignement généralement
fourni par les ouvrages des différentes époques
et complété par celui de M. Guiffrey sur les
« Comptées des bâtiments du Roi ».
Comme amaLeur, j'avais recueilli un grand
nombre de documents et, les faisant voir à
quelques amis, ceux-ci n'eurent qu'une voix
pour m'encourager et finalement me détermi-
nèrent. Je craignais, en effet, de faire double
(1) Voir aux annonces.
emploi avec deux ouvrages en cours de publi-
cation. Mais l'un est dans son essence un monu-
ment historique, l'autre s'adresse plus à l'ami de
l'art ; le but pratique est celui que je me propose.
Ma préoccupation constante a toujours été
de m'adresser aux décorateurs, architectes,
peintres, sculpteurs. Ils trouveront ici les types
originaux des époques Louis XIV, Louis XV,
Louis XVI, reproduits de manière à leur
permettre d'en faire des études pratiques aussi
précises que possible; et de ces exemples ils
pourront facilement déduire les caractères de
chaque période.
Sous Louis XIV, on sent généralement le
goût d'un seul artiste qui, grand maître de tous
les autres, imposait son idée. De là des décora-
lions majestueuses et conçues avec unité. Car
l'on retrouve partout le même sentiment créa-
teur, aussi bien dans la galerie des Glaces et
ses dépendances directes, clans ce qui reste des
appartements de Louis XIV, que dans les
façades sur les jardins et le splendide escalier
des Ambassadeurs que Louis XV fit démolir
pour agrandir ses appartements. J'ai nommé Le
Brun, « qui fut pendant plus d'un quart de siècle
en France », dit si bien Louis Vitet dans ses
Études sur les Beaux-Arts, « l'arbitre et le juge
suprême de toutes les idées d'artistes, le
dispensateur de tous les types, le régulateur de
toutes les formes. C'est d'après ses modèles que
les enfants dessinent dans les écoles ; c'est lui
qui donne aux sculpteurs le dessin de leurs
statues; les meubles ne peuvent être ronds,
carrés ou ovales que sous son bon plaisir, et les
étoffes ne se brochent que d'après les cartons
qu'il a fait tracer sous ses yeux. Il est vrai qu'il
résulte de cette prodigieuse unité d'organisation
une espèce de grandeur extraordinaire, un
spectacle imposant dont tous les yeux furent
éblouis. »
Puis nous avons Louis XV avec ses deux
phases. L'une est la Régence, époque de transi-
tion qui fut pour l'art la continuation du règne
précédent. Cependant il faut bien reconnaître
que déjà certaines mièvreries naquirent dans les
décorations : on ne sent plus la main ferme et
toute-puissante d'un seul artiste. La person-
nalité de chacun commence à se faire sentir
tant et si bien que, renchérissant les uns sur les
autres, les auteurs en vinrent à la pleine
décadence qui engendra la seconde période
dénommée dans l'histoire de l'art : Rococo ou
style Pompadour, Plus de symétrie dans le
détail, mais l'extrême fantaisie.
Dans les exemples de l'époque Louis XVI,
mis sous les yeux de ceux qui étudieront l'ou-
vrage, on pourra se rendre compte que le
commencement de l'Empire, ou l'époque Per-
cier-Fontaine, avec ses imitations de l'antique,
y a pris naissance; les décorations manquent
généralement d'ampleur, mais sont cependant
traitées avec un grand art et une minutie rare :
témoin celles du cabinet de toilette, annexe de
la chambre du roi, et celles aussi des apparte-
ments particuliers de Marie-Antoinette.
Il reste à chercher si, au point de vue de l'art,
ce sont les sommes énormes dépensées sous le
premier règne et l'unité de commandement que
nous ne retrouvons plus sous les deux autres
qui ont empêché les artistes de ces deux
dernières périodes d'atteindre la hauteur de
leurs ancêtres! N'est-ce point plutôt qu'après
1715, n'étant plus l'objet de créations, mais
simplement d'aménagements, le château n'offrait
plus qu'un médiocre sujet aux artistes?
Nous ne portons aucun jugement sur ce point,
voulant rester dans le rôle que nous nous
sommes imposé de donner sans commentaires,
toujours discutables, une monographie aussi
complète que possible de l'ensemble de ces
superbes palais.
P. Favier.
BULLETIN DE L'ART POUR TOUS
compromis qui lui permît de satisfaire à la fois
ses besoins égaux d'observation et d'imagina-
tion. Parfois, sans doute, il se laisse entraîner
clans le domaine plus général du genre reli-
gieux ou historique, comme dans Y Amende ho-
norable, le Retour de V Enfant prodigue, la Lapi-
dation de saint Étienne, le Songe de Jacob, le
Christ mort, Saint Jérôme, motifs qu'il traite, sui-
vant le mot de P.-Malassis, « à la façon de beaux
et vastes lieux communs » ; de même, parfois,
il se maintient dans le cercle plus étroit de l'ob-
servation de la vie populaire, avec le Chaudron-
nier, le Marchand de poissons, le Repas des
pauvres, les Bûcherons, et tous ces types de
pauvres gens qu'il multiplie dans ses estampes.
Mais c'est dans Y Angélus ou Y Ex-voto, dans
le Lutrin ou la Communion, dans le Réfectoire,
le Pèlerinage, le Baptême, la Bénédiction de la
mer, les Demoiselles du mois de Marie ou les
Femmes en prière, que Legros a donné sa note
la plus personnelle.
Toutes ces toiles ont causé des émotions pro-
fondes aux contemporains qui les ont vues naître
ou à ceux qui ont pu les contempler, depuis,
dans les musées ou les collections privées qui
les ont recuellies. Moines, prêtres et chantres
espagnols, vieilles dévotes des faubourgs de Pa-
ris, paysannes boulonnaises, tous ces person-
nages préférés se rencontrent tour à tour dans
son œuvre où ils prolongent les échos de sa
propre vie. Ce sont les coins de l'église Saint-
Médard ou de l'église Saint-Jacques du Haut-
Pas, sous les voûtes sombres desquelles il errait,
le soir, aux heures de la prière, ou bien ces in-
térieurs d'églises espagnoles dont la pénombre
mystérieuse et tragique est troublée par le bruit
léger des éventails; c'est la grève de Boulogne,
le milieu pittoresque de ces femmes de pêcheurs
dans lequel il se retrempait, chaque année, près
de sa mère qui s'était retirée dans cette ville
pour être moins éloignée de son fils; ces graves
Boulonnaises aux beaux traits sérieux et pensifs,
pour lesquelles il gardalongtemps un « béguin»
tout particulier, qu'il fit môme partager un instant
à son ami le sculpteur Dalou. Bien mieux, les
êtres les plus chers lui ont parfois servi de mo-
dèles. C'est ce dessous personnel et humain qui
donne leur force expressive à tous ses tableaux.
Les deux types les plus caractéristiques de
ces compositions d'aspect réaliste et de senti-
ment religieux se rencontrent aux deux extré-
mités de sa carrière de peintre. C'est YEx-voto,
du musée de Dijon, et les Femmes en prière, de
la National Gallery of British Art.
Le premier de ces tableaux a laissé un souve-
nir inoubliable dans la mémoire de tous ceux qui
ont suivi l'œuvre de Legros depuis ses origines.
11 produisit, en 1861, une sensation qui se mani-
festa de façon très opposée sur les critiques pré-
venus ou sur les esprits indépendants. Tandis
que les uns l'accablaient sous celle épithète ré-
putée injurieuse de réaliste, les autres saluaient
en cette œuvre forte et recueillie le rapide et
plein développement d'un talent original, simple,
grave et viril. Exposé en 1864 à Londres, dans
un milieu étranger à nos querelles, YEx-voto y
assura définitivement la réputation de Legros.
A la lisière d'un bois dont les premiers arbres
ferment complètement le fond, à gauche, se
dresse un ex-voto. C'est un poteau de bois por-
tant, abritée dans une sorte de niche peinte en
rouge, une image de la crucifixion sur fond d'or
et décorée, au bas, d'un petit drap noir pointé,
aux quatre coins, de grosses larmes blanches.
Au milieu des hautes herbes et des fleurs, per-
venches, marguerites, véroniques, qui poussent
dru autour d'une flaque d'eau, au premier plan,
à peu près au milieu du tableau, une jeune
femme est agenouillée tenant ouvert entre ses
mains un livre de prière. Elle est vêtue, avec
une élégante simplicité, d'une robe et d'un cor-
sage blancs aux larges manches pendantes, or-
nées de découpures en lestons. Son visage, aux
cheveux noirs, dont les tresses relevées couvrent
la nuque, est vu de profil un peu perdu. Elle est
plongée dans une songerie profonde et mélan-
colique.
Derrière elle est agenouillé, sur deux rangs,
un groupe de sept femmes qui prient. C'est d'a-
bord une jeune paysanne avec deux jeunes filles
qui lisent sur le même livre, vêtues de robes
sombres, de châles noirs et les cheveux cachés
sous leurs coiffes blanches. Au deuxième rang,
trois bourgeoises de province dont on ne dis-
tingue que les profils, austères et durs sous
leurs voiles noirs ou leurs chapeaux de crêpe.
Devant elles, une vieille femme coiffée d'un
bonnet tuyauté qui encadre ses pauvres joues
ridées, séchées, grelottantes, ses yeux rouges
et éteints, sa bouche marmoltant tout bas avec
peine les Ave qu'égrènent machinalement sur
son chapelet ses doigts tremblants. Plus loin,
debout contre un tronc d'arbre, une jeune
femme de trois quarts, en capote et costume de
ville, tient, toute songeuse, un cierge allumé.
Au fond, un paysage de plaine se fondant avec
le ciel nuageux, largement lavé et traité en dé-
cor, sur lequel s'enlèvent nettement les person-
nages, accentuant ainsi, dans cette sorte d'aban-
don, de parti pris abstrait et décoratif, la réalité
intense de ces figures méditatives.
Assurément, ceux qui rattachaient cette pein-
ture, d'une belle audace tranquille, à YEnterre-
ment d'Ornans, ceux-là, si peu bienveillante que
fût leur pensée, n'avaient point tout à fait tort.
II ne servirait à rien denier la parenté entre ces
deux grandes et fortes œuvres.
L'exécution robuste, les tons sobres, les
silhouettes nettement accusées, les oppositions
franches et sans violence des noirs et des blancs,
et peut-être même jusqu'au sujet, marquent sans
conteste l'influence exercée sur le talent du
jeune artiste par le maître autour duquel évo-
luait le petit groupe « réaliste ». Les tonalités
elles-mêmes du paysage appartiennent à la pa-
lette de Courbet. Legros en oubliait presque ses
anciens amis du Louvre.
(à suivre.) Léonce Bénédite.
L'ARCHITECTURE et la DÉCORATION
aux Palais
^Versailles et des Trianons
sous la direction de M. Paul FAVI E R
Architecte, délégué au Sénat,
ancien inspecteur aux Palais (1882—1802)
introduction (1)
Depuis longtemps déjà, et lorsque j'étais
inspecteur au palais de Versailles, j'avais eu la
pensée de publier sur ce château des ensembles,
des motifs d'architecture et de décoration. Mon
projet se bornait d'ailleurs aux œuvres que la
transformation du château en musée historique
avait respectées.
Il ne s'agissait pas de donner un historique de
chaque exemple, renseignement généralement
fourni par les ouvrages des différentes époques
et complété par celui de M. Guiffrey sur les
« Comptées des bâtiments du Roi ».
Comme amaLeur, j'avais recueilli un grand
nombre de documents et, les faisant voir à
quelques amis, ceux-ci n'eurent qu'une voix
pour m'encourager et finalement me détermi-
nèrent. Je craignais, en effet, de faire double
(1) Voir aux annonces.
emploi avec deux ouvrages en cours de publi-
cation. Mais l'un est dans son essence un monu-
ment historique, l'autre s'adresse plus à l'ami de
l'art ; le but pratique est celui que je me propose.
Ma préoccupation constante a toujours été
de m'adresser aux décorateurs, architectes,
peintres, sculpteurs. Ils trouveront ici les types
originaux des époques Louis XIV, Louis XV,
Louis XVI, reproduits de manière à leur
permettre d'en faire des études pratiques aussi
précises que possible; et de ces exemples ils
pourront facilement déduire les caractères de
chaque période.
Sous Louis XIV, on sent généralement le
goût d'un seul artiste qui, grand maître de tous
les autres, imposait son idée. De là des décora-
lions majestueuses et conçues avec unité. Car
l'on retrouve partout le même sentiment créa-
teur, aussi bien dans la galerie des Glaces et
ses dépendances directes, clans ce qui reste des
appartements de Louis XIV, que dans les
façades sur les jardins et le splendide escalier
des Ambassadeurs que Louis XV fit démolir
pour agrandir ses appartements. J'ai nommé Le
Brun, « qui fut pendant plus d'un quart de siècle
en France », dit si bien Louis Vitet dans ses
Études sur les Beaux-Arts, « l'arbitre et le juge
suprême de toutes les idées d'artistes, le
dispensateur de tous les types, le régulateur de
toutes les formes. C'est d'après ses modèles que
les enfants dessinent dans les écoles ; c'est lui
qui donne aux sculpteurs le dessin de leurs
statues; les meubles ne peuvent être ronds,
carrés ou ovales que sous son bon plaisir, et les
étoffes ne se brochent que d'après les cartons
qu'il a fait tracer sous ses yeux. Il est vrai qu'il
résulte de cette prodigieuse unité d'organisation
une espèce de grandeur extraordinaire, un
spectacle imposant dont tous les yeux furent
éblouis. »
Puis nous avons Louis XV avec ses deux
phases. L'une est la Régence, époque de transi-
tion qui fut pour l'art la continuation du règne
précédent. Cependant il faut bien reconnaître
que déjà certaines mièvreries naquirent dans les
décorations : on ne sent plus la main ferme et
toute-puissante d'un seul artiste. La person-
nalité de chacun commence à se faire sentir
tant et si bien que, renchérissant les uns sur les
autres, les auteurs en vinrent à la pleine
décadence qui engendra la seconde période
dénommée dans l'histoire de l'art : Rococo ou
style Pompadour, Plus de symétrie dans le
détail, mais l'extrême fantaisie.
Dans les exemples de l'époque Louis XVI,
mis sous les yeux de ceux qui étudieront l'ou-
vrage, on pourra se rendre compte que le
commencement de l'Empire, ou l'époque Per-
cier-Fontaine, avec ses imitations de l'antique,
y a pris naissance; les décorations manquent
généralement d'ampleur, mais sont cependant
traitées avec un grand art et une minutie rare :
témoin celles du cabinet de toilette, annexe de
la chambre du roi, et celles aussi des apparte-
ments particuliers de Marie-Antoinette.
Il reste à chercher si, au point de vue de l'art,
ce sont les sommes énormes dépensées sous le
premier règne et l'unité de commandement que
nous ne retrouvons plus sous les deux autres
qui ont empêché les artistes de ces deux
dernières périodes d'atteindre la hauteur de
leurs ancêtres! N'est-ce point plutôt qu'après
1715, n'étant plus l'objet de créations, mais
simplement d'aménagements, le château n'offrait
plus qu'un médiocre sujet aux artistes?
Nous ne portons aucun jugement sur ce point,
voulant rester dans le rôle que nous nous
sommes imposé de donner sans commentaires,
toujours discutables, une monographie aussi
complète que possible de l'ensemble de ces
superbes palais.
P. Favier.