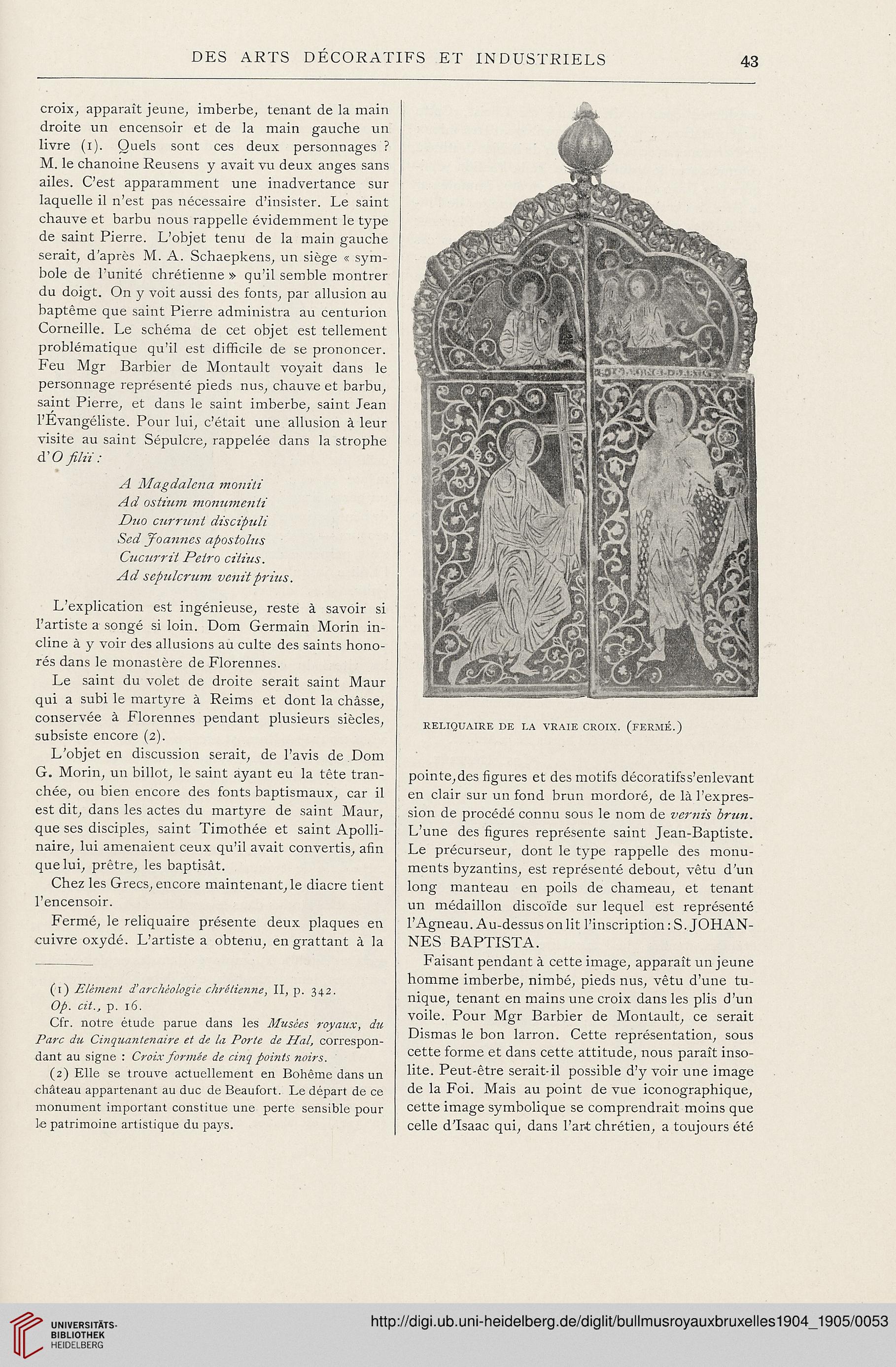DES ARTS DÉCORATIFS ET INDUSTRIELS
43
croix, apparaît jeune, imberbe, tenant de la main
droite un encensoir et de la main gauche un
livre (i). Quels sont ces deux personnages ?
M. le chanoine Reusens y avait vu deux anges sans
ailes. C’est apparamment une inadvertance sur
laquelle il n’est pas nécessaire d’insister. Le saint
chauve et barbu nous rappelle évidemment le type
de saint Pierre. L’objet tenu de la main gauche
serait, d’après M. A. Schaepkens, un siège « sym-
bole de l’unité chrétienne » qu’il semble montrer
du doigt. On y voit aussi des fonts, par allusion au
baptême que saint Pierre administra au centurion
Corneille. Le schéma de cet objet est tellement
problématique qu’il est difficile de se prononcer.
Feu Mgr Barbier de Montault voyait dans le
personnage représenté pieds nus, chauve et barbu,
saint Pierre, et dans le saint imberbe, saint Jean
l'Évangéliste. Pour lui, c’était une allusion à leur
visite au saint Sépulcre, rappelée dans la strophe
d’O filii :
A Magdalena moniti
Ad ostium monumenii
Duo currunt discipuli
Scd Joannes apostolus
Cucurrit Petro ciiius.
Ad sepulcrum venitprius.
L’explication est ingénieuse, reste à savoir si
l’artiste a songé si loin. Dom Germain Morin in-
cline à y voir des allusions au culte des saints hono-
rés dans le monastère de Florennes.
Le saint du volet de droite serait saint Maur
qui a subi le martyre à Reims et dont la châsse,
conservée à Florennes pendant plusieurs siècles,
subsiste encore (2).
L’objet en discussion serait, de l’avis de Dom
G. Morin, un billot, le saint ayant eu la tête tran-
chée, ou bien encore des fonts baptismaux, car il
est dit, dans les actes du martyre de saint Maur,
que ses disciples, saint Timothée et saint Apolli-
naire, lui amenaient ceux qu’il avait convertis, afin
que lui, prêtre, les baptisât.
Chez les Grecs, encore maintenant, le diacre tient
l’encensoir.
Fermé, le reliquaire présente deux plaques en
cuivre oxydé. L’artiste a obtenu, en grattant à la
(1) Elément d'archéologie chrétienne, II, p. 342.
Op. cit., p. 16.
Cfr. notre étude parue dans les Musées royaux, du
Parc du Cinquantenaire et de la Porte de Hal, correspon-
dant au signe : Croix formée de cinq points noirs.
(2) Elle se trouve actuellement en Bohême dans un
château appartenant au duc de Beaufort. Le départ de ce
monument important constitue une perte sensible pour
le patrimoine artistique du pays.
RELIQUAIRE DE LA VRAIE CROIX. (FERMÉ.)
pointe,des figures et des motifs décoratifss’enlevant
en clair sur un fond brun mordoré, de là l’expres-
sion de procédé connu sous le nom de vernis brun.
L’une des figures représente saint Jean-Baptiste.
Le précurseur, dont le type rappelle des monu-
ments byzantins, est représenté debout, vêtu d’un
long manteau en poils de chameau, et tenant
un médaillon discoïde sur lequel est représenté
l’Agneau .Au-dessus on lit l’inscription : S .JOHAN-
NES BAPTISTA.
Faisant pendant à cette image, apparaît un jeune
homme imberbe, nimbé, pieds nus, vêtu d’une tu-
nique, tenant en mains une croix dans les plis d’un
voile. Pour Mgr Barbier de Montault, ce serait
Dismas le bon larron. Cette représentation, sous
cette forme et dans cette attitude, nous paraît inso-
lite. Peut-être serait-il possible d’y voir une image
de la Foi. Mais au point de vue iconographique,
cette image symbolique se comprendrait moins que
celle d’Isaac qui, dans l’art chrétien, a toujours été
43
croix, apparaît jeune, imberbe, tenant de la main
droite un encensoir et de la main gauche un
livre (i). Quels sont ces deux personnages ?
M. le chanoine Reusens y avait vu deux anges sans
ailes. C’est apparamment une inadvertance sur
laquelle il n’est pas nécessaire d’insister. Le saint
chauve et barbu nous rappelle évidemment le type
de saint Pierre. L’objet tenu de la main gauche
serait, d’après M. A. Schaepkens, un siège « sym-
bole de l’unité chrétienne » qu’il semble montrer
du doigt. On y voit aussi des fonts, par allusion au
baptême que saint Pierre administra au centurion
Corneille. Le schéma de cet objet est tellement
problématique qu’il est difficile de se prononcer.
Feu Mgr Barbier de Montault voyait dans le
personnage représenté pieds nus, chauve et barbu,
saint Pierre, et dans le saint imberbe, saint Jean
l'Évangéliste. Pour lui, c’était une allusion à leur
visite au saint Sépulcre, rappelée dans la strophe
d’O filii :
A Magdalena moniti
Ad ostium monumenii
Duo currunt discipuli
Scd Joannes apostolus
Cucurrit Petro ciiius.
Ad sepulcrum venitprius.
L’explication est ingénieuse, reste à savoir si
l’artiste a songé si loin. Dom Germain Morin in-
cline à y voir des allusions au culte des saints hono-
rés dans le monastère de Florennes.
Le saint du volet de droite serait saint Maur
qui a subi le martyre à Reims et dont la châsse,
conservée à Florennes pendant plusieurs siècles,
subsiste encore (2).
L’objet en discussion serait, de l’avis de Dom
G. Morin, un billot, le saint ayant eu la tête tran-
chée, ou bien encore des fonts baptismaux, car il
est dit, dans les actes du martyre de saint Maur,
que ses disciples, saint Timothée et saint Apolli-
naire, lui amenaient ceux qu’il avait convertis, afin
que lui, prêtre, les baptisât.
Chez les Grecs, encore maintenant, le diacre tient
l’encensoir.
Fermé, le reliquaire présente deux plaques en
cuivre oxydé. L’artiste a obtenu, en grattant à la
(1) Elément d'archéologie chrétienne, II, p. 342.
Op. cit., p. 16.
Cfr. notre étude parue dans les Musées royaux, du
Parc du Cinquantenaire et de la Porte de Hal, correspon-
dant au signe : Croix formée de cinq points noirs.
(2) Elle se trouve actuellement en Bohême dans un
château appartenant au duc de Beaufort. Le départ de ce
monument important constitue une perte sensible pour
le patrimoine artistique du pays.
RELIQUAIRE DE LA VRAIE CROIX. (FERMÉ.)
pointe,des figures et des motifs décoratifss’enlevant
en clair sur un fond brun mordoré, de là l’expres-
sion de procédé connu sous le nom de vernis brun.
L’une des figures représente saint Jean-Baptiste.
Le précurseur, dont le type rappelle des monu-
ments byzantins, est représenté debout, vêtu d’un
long manteau en poils de chameau, et tenant
un médaillon discoïde sur lequel est représenté
l’Agneau .Au-dessus on lit l’inscription : S .JOHAN-
NES BAPTISTA.
Faisant pendant à cette image, apparaît un jeune
homme imberbe, nimbé, pieds nus, vêtu d’une tu-
nique, tenant en mains une croix dans les plis d’un
voile. Pour Mgr Barbier de Montault, ce serait
Dismas le bon larron. Cette représentation, sous
cette forme et dans cette attitude, nous paraît inso-
lite. Peut-être serait-il possible d’y voir une image
de la Foi. Mais au point de vue iconographique,
cette image symbolique se comprendrait moins que
celle d’Isaac qui, dans l’art chrétien, a toujours été