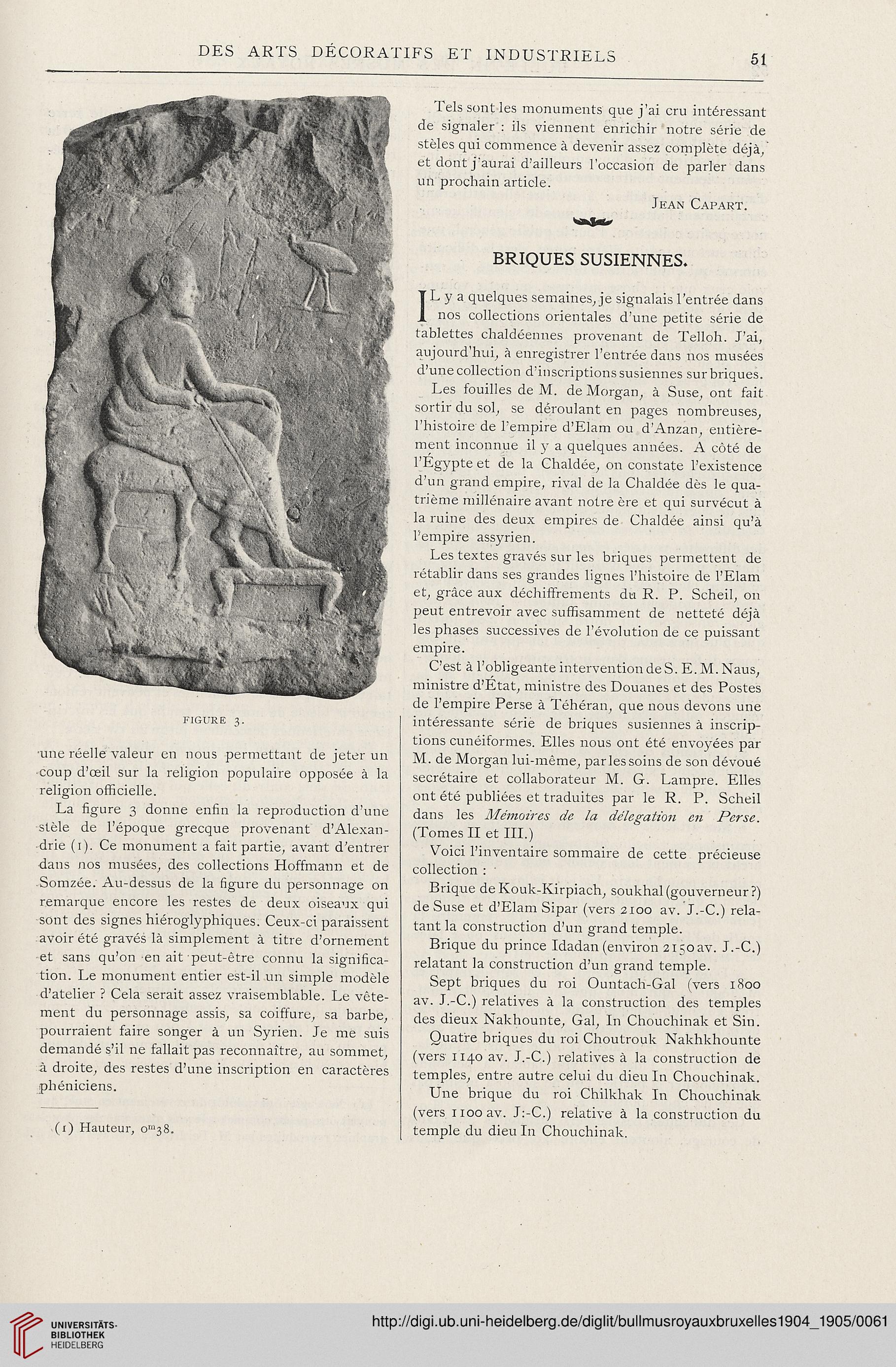DES ARTS DECORATIFS ET INDUSTRIELS
51
FIGURE 3.
■une réelle valeur en nous permettant de jeter un
■coup d’œil sur la religion populaire opposée à la
religion officielle.
La figure 3 donne enfin la reproduction d’une
■stèle de l’époque grecque provenant d’Alexan-
drie (1). Ce monument a fait partie, avant d’entrer
dans nos musées, des collections Hoffmann et de
Somzée. Au-dessus de la figure du personnage on
remarque encore les restes de deux oiseaux qui
sont des signes hiéroglyphiques. Ceux-ci paraissent
avoir été gravés là simplement à titre d’ornement
et sans qu’on en ait peut-être connu la significa-
tion. Le monument entier est-il un simple modèle
d’atelier ? Cela serait assez vraisemblable. Le vête-
ment du personnage assis, sa coiffure, sa barbe,
pourraient faire songer à un Syrien. Je me suis
demandé s’il ne fallait pas reconnaître, au sommet,
à droite, des restes d’une inscription en caractères
phéniciens.
(1) Hauteur, om38.
Tels sont les monuments que j’ai cru intéressant
de signaler : ils viennent enrichir notre série de
stèles qui commence à devenir assez complète déjà,
et dont j'aurai d’ailleurs l’occasion de parler dans
un prochain article.
Jean Capart.
BRIQUES SUSIENNES.
IL y a quelques semaines, je signalais l’entrée dans
nos collections orientales d’une petite série de
tablettes chaldéennes provenant de Telloh. J’ai,
aujourd’hui, à enregistrer l’entrée dans nos musées
d’une collection d’inscriptions susiennes sur briques.
Les fouilles de M. de Morgan, à Suse, ont fait
sortir du sol, se déroulant en pages nombreuses,
l’histoire de l'empire d’Elam ou d’Anzan, entière-
ment inconnue il y a quelques années. A côté de
l’Egypte et de la Chaldée, on constate l’existence
d’un grand empire, rival de la Chaldée dès le qua-
trième millénaire avant notre ère et qui survécut à
la ruine des deux empires de Chaldée ainsi qu’à
l’empire assyrien.
Les textes gravés sur les briques permettent de
rétablir dans ses grandes lignes l’histoire de l’Elam
et, grâce aux déchiffrements du R. P. Scheil, 011
peut entrevoir avec suffisamment de netteté déjà
les phases successives de l’évolution de ce puissant
empire.
C’est à l’obligeante intervention de S. E. M. Naus,
ministre d’Etat, ministre des Douanes et des Postes
de l’empire Perse à Téhéran, que nous devons une
intéressante série de briques susiennes à inscrip-
tions cunéiformes. Elles nous ont été envoyées par
M. de Morgan lui-même, par les soins de son dévoué
secrétaire et collaborateur M. G. Lampre. Elles
ont été publiées et traduites par le R. P. Scheil
dans les Mémoires de la délégation en Perse.
(Tomes II et III.)
Voici l’inventaire sommaire de cette précieuse
collection :
Brique de Ivouk-Kirpiach, soukhal(gouverneur?)
de Suse et d’Elam Sipar (vers 2100 av. J.-C.) rela-
tant la construction d’un grand temple.
Brique du prince Idadan (environ 2i5oav. J.-C.)
relatant la construction d’un grand temple.
Sept briques du roi Ountach-Gal (vers 1800
av. J.-C.) relatives à la construction des temples
des dieux Nakhounte, Gai, In Chouchinak et Sin.
Quatre briques du roi Choutrouk Nakhkhounte
(vers 1140 av. J.-C.) relatives à la construction de
temples, entre autre celui du dieu In Chouchinak.
Une brique du roi Chilkhak In Chouchinak
(vers nooav. J:-C.) relative à la construction du
temple du dieu In Chouchinak.
51
FIGURE 3.
■une réelle valeur en nous permettant de jeter un
■coup d’œil sur la religion populaire opposée à la
religion officielle.
La figure 3 donne enfin la reproduction d’une
■stèle de l’époque grecque provenant d’Alexan-
drie (1). Ce monument a fait partie, avant d’entrer
dans nos musées, des collections Hoffmann et de
Somzée. Au-dessus de la figure du personnage on
remarque encore les restes de deux oiseaux qui
sont des signes hiéroglyphiques. Ceux-ci paraissent
avoir été gravés là simplement à titre d’ornement
et sans qu’on en ait peut-être connu la significa-
tion. Le monument entier est-il un simple modèle
d’atelier ? Cela serait assez vraisemblable. Le vête-
ment du personnage assis, sa coiffure, sa barbe,
pourraient faire songer à un Syrien. Je me suis
demandé s’il ne fallait pas reconnaître, au sommet,
à droite, des restes d’une inscription en caractères
phéniciens.
(1) Hauteur, om38.
Tels sont les monuments que j’ai cru intéressant
de signaler : ils viennent enrichir notre série de
stèles qui commence à devenir assez complète déjà,
et dont j'aurai d’ailleurs l’occasion de parler dans
un prochain article.
Jean Capart.
BRIQUES SUSIENNES.
IL y a quelques semaines, je signalais l’entrée dans
nos collections orientales d’une petite série de
tablettes chaldéennes provenant de Telloh. J’ai,
aujourd’hui, à enregistrer l’entrée dans nos musées
d’une collection d’inscriptions susiennes sur briques.
Les fouilles de M. de Morgan, à Suse, ont fait
sortir du sol, se déroulant en pages nombreuses,
l’histoire de l'empire d’Elam ou d’Anzan, entière-
ment inconnue il y a quelques années. A côté de
l’Egypte et de la Chaldée, on constate l’existence
d’un grand empire, rival de la Chaldée dès le qua-
trième millénaire avant notre ère et qui survécut à
la ruine des deux empires de Chaldée ainsi qu’à
l’empire assyrien.
Les textes gravés sur les briques permettent de
rétablir dans ses grandes lignes l’histoire de l’Elam
et, grâce aux déchiffrements du R. P. Scheil, 011
peut entrevoir avec suffisamment de netteté déjà
les phases successives de l’évolution de ce puissant
empire.
C’est à l’obligeante intervention de S. E. M. Naus,
ministre d’Etat, ministre des Douanes et des Postes
de l’empire Perse à Téhéran, que nous devons une
intéressante série de briques susiennes à inscrip-
tions cunéiformes. Elles nous ont été envoyées par
M. de Morgan lui-même, par les soins de son dévoué
secrétaire et collaborateur M. G. Lampre. Elles
ont été publiées et traduites par le R. P. Scheil
dans les Mémoires de la délégation en Perse.
(Tomes II et III.)
Voici l’inventaire sommaire de cette précieuse
collection :
Brique de Ivouk-Kirpiach, soukhal(gouverneur?)
de Suse et d’Elam Sipar (vers 2100 av. J.-C.) rela-
tant la construction d’un grand temple.
Brique du prince Idadan (environ 2i5oav. J.-C.)
relatant la construction d’un grand temple.
Sept briques du roi Ountach-Gal (vers 1800
av. J.-C.) relatives à la construction des temples
des dieux Nakhounte, Gai, In Chouchinak et Sin.
Quatre briques du roi Choutrouk Nakhkhounte
(vers 1140 av. J.-C.) relatives à la construction de
temples, entre autre celui du dieu In Chouchinak.
Une brique du roi Chilkhak In Chouchinak
(vers nooav. J:-C.) relative à la construction du
temple du dieu In Chouchinak.