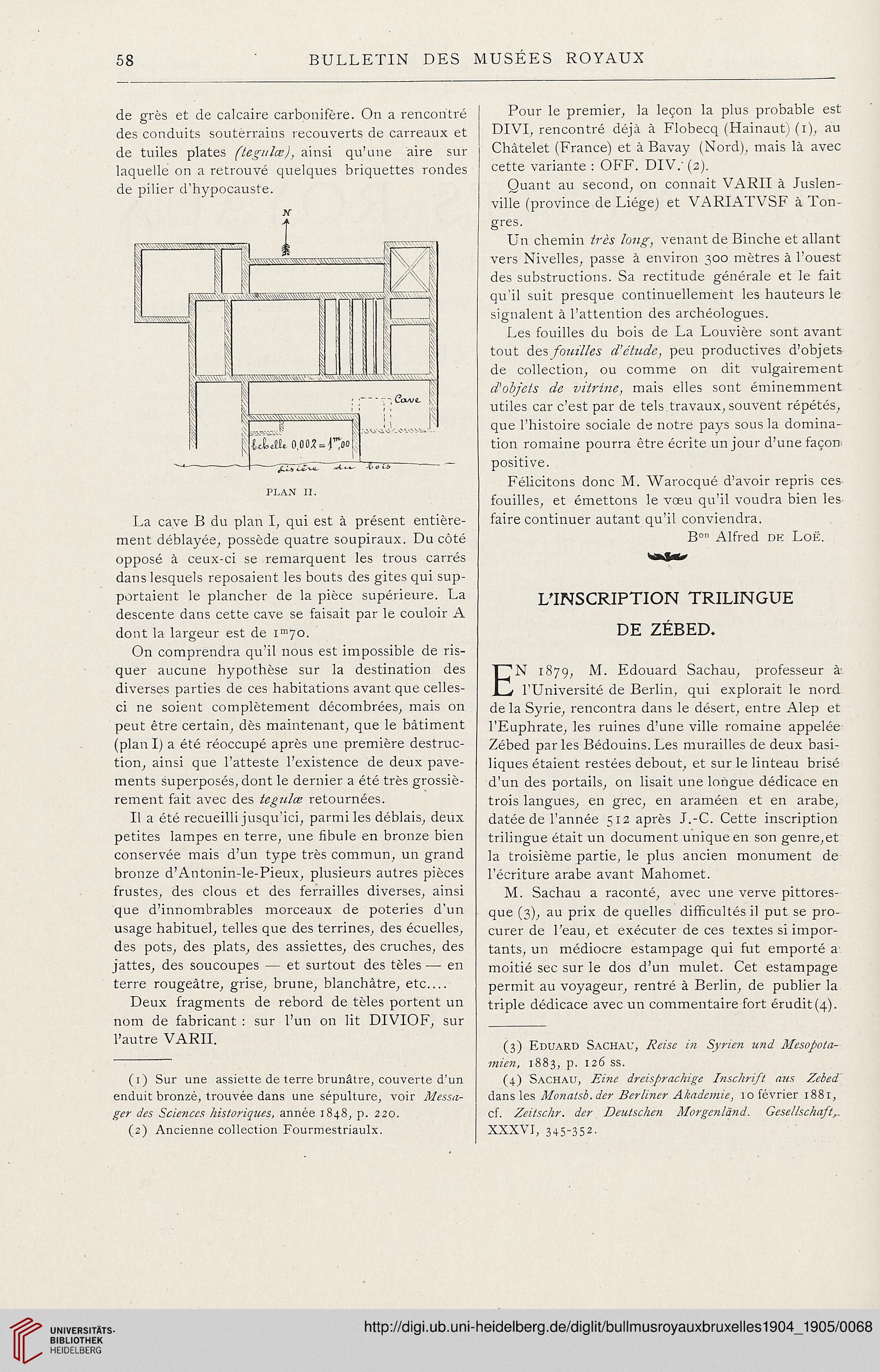58
BULLETIN DES MUSEES ROYAUX
de grès et de calcaire carbonifère. On a rencontré
des conduits souterrains recouverts de carreaux et
de tuiles plates (tegulceJ, ainsi qu’une aire sur
laquelle on a retrouvé quelques briquettes rondes
de pilier d’hypocauste.
H
La cave B du plan I, qui est à présent entière-
ment déblayée, possède quatre soupiraux. Du côté
opposé à ceux-ci se remarquent les trous carrés
dans lesquels reposaient les bouts des gites qui sup-
portaient le plancher de la pièce supérieure. La
descente dans cette cave se faisait par le couloir A
dont la largeur est de lm70.
On comprendra qu’il nous est impossible de ris-
quer aucune hypothèse sur la destination des
diverses parties de ces habitations avant que celles-
ci ne soient complètement décombrées, mais on
peut être certain, dès maintenant, que le bâtiment
(plan I) a été réoccupé après une première destruc-
tion, ainsi que l’atteste l’existence de deux pave-
ments superposés, dont le dernier a été très grossiè-
rement fait avec des tegulce retournées.
Il a été recueilli jusqu’ici, parmi les déblais, deux
petites lampes en terre, une fibule en bronze bien
conservée mais d’un type très commun, un grand
bronze d’Antonin-le-Pieux, plusieurs autres pièces
frustes, des clous et des ferrailles diverses, ainsi
que d’innombrables morceaux de poteries d’un
usage habituel, telles que des terrines, des écuelies,
des pots, des plats, des assiettes, des cruches, des
jattes, des soucoupes — et surtout des tèles — en
terre rougeâtre, grise, brune, blanchâtre, etc....
Deux fragments de rebord de tèles portent un
nom de fabricant : sur l’un on lit DIVIO F, sur
l’autre VARII.
(1) Sur une assiette de terre brunâtre, couverte d’un
enduit bronzé, trouvée dans une sépulture, voir Messa-
ger des Sciences historiques, année 1848, p. 220.
(2) Ancienne collection Fourmestriaulx.
Pour le premier, la leçon la plus probable est
DIVI, rencontré déjà à Flobecq (Hainaut) (1), au
Châtelet (France) et à Bavay (Nord), mais là avec
cette variante : OFF. DIV.' (2).
Quant au second, on connaît VARII à Juslen-
ville (province de Liège) et VARIATVSF à Ton-
gres.
Un chemin très long, venant de Binche et allant
vers Nivelles, passe à environ 300 mètres à l’ouest
des substructions. Sa rectitude générale et le fait
qu'il suit presque continuellement les hauteurs le
signalent à l’attention des archéologues.
Les fouilles du bois de La Louvière sont avant
tout des fouilles d’étude, peu productives d’objets
de collection, ou comme on dit vulgairement
d'objets de vitrine, mais elles sont éminemment
utiles car c’est par de tels , travaux, souvent répétés,
que l’histoire sociale de notre pays sous la domina-
tion romaine pourra être écrite un jour d’une façon
positive.
Félicitons donc M. Warocqué d’avoir repris ces-
fouilles, et émettons le vœu qu’il voudra bien les
faire continuer autant qu’il conviendra.
B°n Alfred de Loë.
'vmtytw
L'INSCRIPTION TRILINGUE
DE ZÉBED.
EN 1879, M. Edouard Sachau, professeur à
l’Université de Berlin, qui explorait le nord
de la Syrie, rencontra dans le désert, entre Alep et
l’Euphrate, les ruines d’une ville romaine appelée
Zébed par les Bédouins. Les murailles de deux basi-
liques étaient restées debout, et sur le linteau brisé
d’un des portails, on lisait une longue dédicace en
trois langues, en grec, en araméen et en arabe,
datée de l’année 512 après J.-C. Cette inscription
trilingue était un document unique en son genre,et
la troisième partie, le plus ancien monument de
l’écriture arabe avant Mahomet.
M. Sachau a raconté, avec une verve pittores-
que (3), au prix de quelles difficultés il put se pro-
curer de l’eau, et exécuter de ces textes si impor-
tants, un médiocre estampage qui fut emporté a
moitié sec sur le dos d’un mulet. Cet estampage
permit au voyageur, rentré à Berlin, de publier la
triple dédicace avec un commentaire fort érudit (4).
(3) Eduard Sachau, Reise iti Syrien und Mesopota-
mien, 1883, p. 126 ss.
(4) Sachau, Eine dreisprachige Inschrift ans Zcbed
dans les Monatsb.der Berlincr Akademie, 10 février 1881,
cf. Zcitschr. der Deutschen Morgenlànd. Gesellschaft,..
XXXVI, 345-352-
BULLETIN DES MUSEES ROYAUX
de grès et de calcaire carbonifère. On a rencontré
des conduits souterrains recouverts de carreaux et
de tuiles plates (tegulceJ, ainsi qu’une aire sur
laquelle on a retrouvé quelques briquettes rondes
de pilier d’hypocauste.
H
La cave B du plan I, qui est à présent entière-
ment déblayée, possède quatre soupiraux. Du côté
opposé à ceux-ci se remarquent les trous carrés
dans lesquels reposaient les bouts des gites qui sup-
portaient le plancher de la pièce supérieure. La
descente dans cette cave se faisait par le couloir A
dont la largeur est de lm70.
On comprendra qu’il nous est impossible de ris-
quer aucune hypothèse sur la destination des
diverses parties de ces habitations avant que celles-
ci ne soient complètement décombrées, mais on
peut être certain, dès maintenant, que le bâtiment
(plan I) a été réoccupé après une première destruc-
tion, ainsi que l’atteste l’existence de deux pave-
ments superposés, dont le dernier a été très grossiè-
rement fait avec des tegulce retournées.
Il a été recueilli jusqu’ici, parmi les déblais, deux
petites lampes en terre, une fibule en bronze bien
conservée mais d’un type très commun, un grand
bronze d’Antonin-le-Pieux, plusieurs autres pièces
frustes, des clous et des ferrailles diverses, ainsi
que d’innombrables morceaux de poteries d’un
usage habituel, telles que des terrines, des écuelies,
des pots, des plats, des assiettes, des cruches, des
jattes, des soucoupes — et surtout des tèles — en
terre rougeâtre, grise, brune, blanchâtre, etc....
Deux fragments de rebord de tèles portent un
nom de fabricant : sur l’un on lit DIVIO F, sur
l’autre VARII.
(1) Sur une assiette de terre brunâtre, couverte d’un
enduit bronzé, trouvée dans une sépulture, voir Messa-
ger des Sciences historiques, année 1848, p. 220.
(2) Ancienne collection Fourmestriaulx.
Pour le premier, la leçon la plus probable est
DIVI, rencontré déjà à Flobecq (Hainaut) (1), au
Châtelet (France) et à Bavay (Nord), mais là avec
cette variante : OFF. DIV.' (2).
Quant au second, on connaît VARII à Juslen-
ville (province de Liège) et VARIATVSF à Ton-
gres.
Un chemin très long, venant de Binche et allant
vers Nivelles, passe à environ 300 mètres à l’ouest
des substructions. Sa rectitude générale et le fait
qu'il suit presque continuellement les hauteurs le
signalent à l’attention des archéologues.
Les fouilles du bois de La Louvière sont avant
tout des fouilles d’étude, peu productives d’objets
de collection, ou comme on dit vulgairement
d'objets de vitrine, mais elles sont éminemment
utiles car c’est par de tels , travaux, souvent répétés,
que l’histoire sociale de notre pays sous la domina-
tion romaine pourra être écrite un jour d’une façon
positive.
Félicitons donc M. Warocqué d’avoir repris ces-
fouilles, et émettons le vœu qu’il voudra bien les
faire continuer autant qu’il conviendra.
B°n Alfred de Loë.
'vmtytw
L'INSCRIPTION TRILINGUE
DE ZÉBED.
EN 1879, M. Edouard Sachau, professeur à
l’Université de Berlin, qui explorait le nord
de la Syrie, rencontra dans le désert, entre Alep et
l’Euphrate, les ruines d’une ville romaine appelée
Zébed par les Bédouins. Les murailles de deux basi-
liques étaient restées debout, et sur le linteau brisé
d’un des portails, on lisait une longue dédicace en
trois langues, en grec, en araméen et en arabe,
datée de l’année 512 après J.-C. Cette inscription
trilingue était un document unique en son genre,et
la troisième partie, le plus ancien monument de
l’écriture arabe avant Mahomet.
M. Sachau a raconté, avec une verve pittores-
que (3), au prix de quelles difficultés il put se pro-
curer de l’eau, et exécuter de ces textes si impor-
tants, un médiocre estampage qui fut emporté a
moitié sec sur le dos d’un mulet. Cet estampage
permit au voyageur, rentré à Berlin, de publier la
triple dédicace avec un commentaire fort érudit (4).
(3) Eduard Sachau, Reise iti Syrien und Mesopota-
mien, 1883, p. 126 ss.
(4) Sachau, Eine dreisprachige Inschrift ans Zcbed
dans les Monatsb.der Berlincr Akademie, 10 février 1881,
cf. Zcitschr. der Deutschen Morgenlànd. Gesellschaft,..
XXXVI, 345-352-