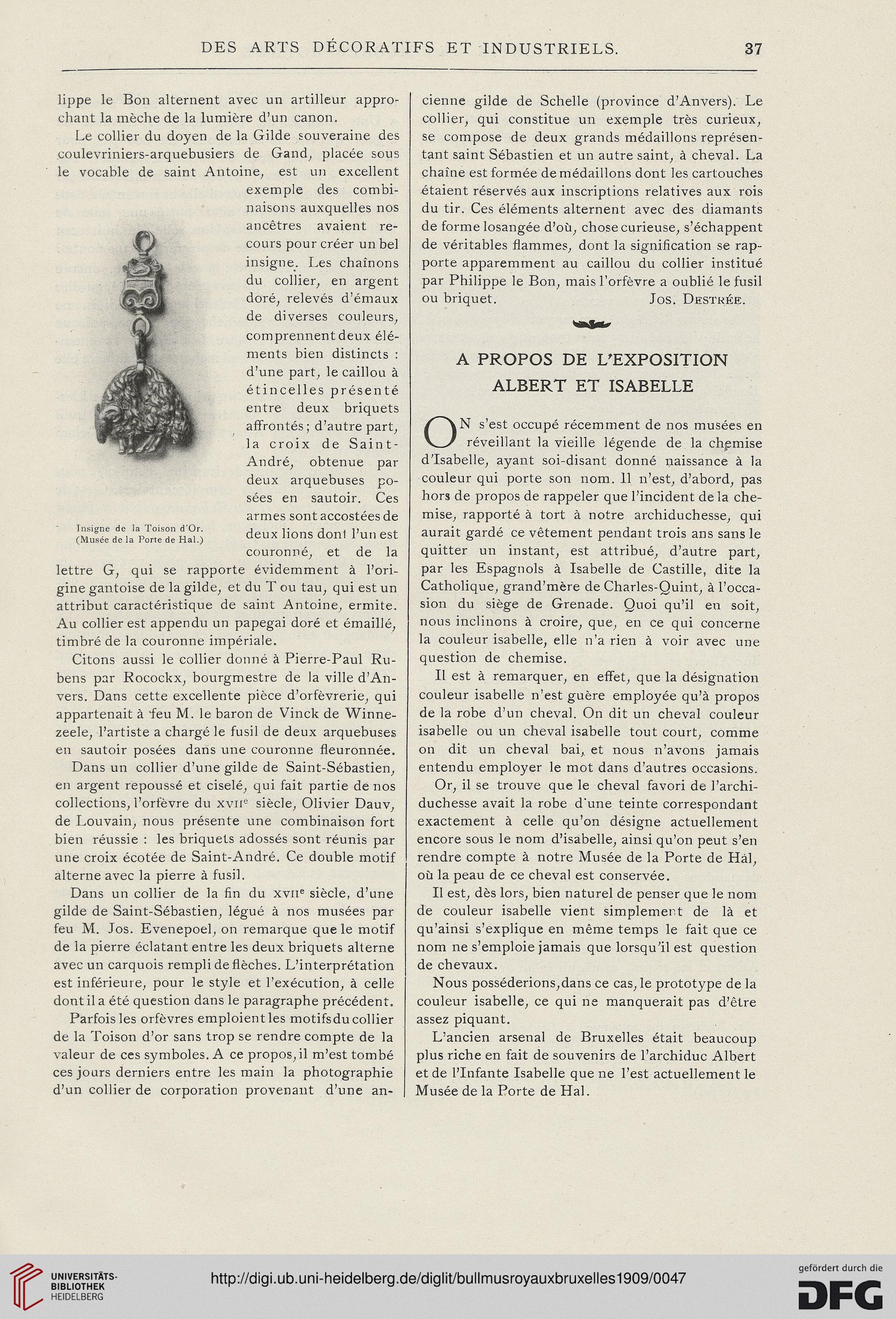DES ARTS DÉCORATIFS ET INDUSTRIELS.
37
Insigne de la Toison d’Or.
(Musée de la Porte de Hal.)
lippe le Bon alternent avec un artilleur appro-
chant la mèche de la lumière d’un canon.
Le collier du doyen de la Gilde souveraine des
coulevriniers-arquebusiers de Gand, placée sous
le vocable de saint Antoine, est un excellent
exemple des combi-
naisons auxquelles nos
ancêtres avaient re-
cours pour créer un bel
insigne. Les chaînons
du collier, en argent
doré, relevés d’émaux
de diverses couleurs,
comprennent deux élé-
ments bien distincts :
d’une part, le caillou à
étincelles présenté
entre deux briquets
affrontés; d’autre part,
1 a croix de Sain t-
André, obtenue par
deux arquebuses po-
sées en sautoir. Ces
armes sont accostées de
deux lions don! l’un est
couronné, et de la
lettre G, qui se rapporte évidemment à l’ori-
gine gantoise de la gilde, et du T ou tau, qui est un
attribut caractéristique de saint Antoine, ermite.
Au collier est appendu un papegai doré et émaillé,
timbré de la couronne impériale.
Citons aussi le collier donné à Pierre-Paul Ru-
bens par Rocockx, bourgmestre de la ville d’An-
vers. Dans cette excellente pièce d’orfèvrerie, qui
appartenait à 'feu M. le baron de Vinck de Winne-
zeele, l’artiste a chargé le fusil de deux arquebuses
en sautoir posées dans une couronne fleuronnée.
Dans un collier d’une gilde de Saint-Sébastien,
en argent repoussé et ciselé, qui fait partie de nos
collections, l’orfèvre du xvne siècle, Olivier Dauv,
de Louvain, nous présente une combinaison fort
bien réussie : les briquets adossés sont réunis par
une croix écotée de Saint-André. Ce double motif
alterne avec la pierre à fusil.
Dans un collier de la fin du xvrie siècle, d’une
gilde de Saint-Sébastien, légué à nos musées par
feu M. Jos. Evenepoel, on remarque que le motif
de la pierre éclatant entre les deux briquets alterne
avec un carquois rempli de flèches. L’interprétation
est inférieure, pour le style et l’exécution, à celle
dont il a été question dans le paragraphe précédent.
Parfois les orfèvres emploient les motifsdu collier
de la Toison d’or sans trop se rendre compte de la
valeur de ces symboles. A ce propos, il m’est tombé
ces jours derniers entre les main la photographie
d’un collier de corporation provenant d’une an-
cienne gilde de Schelle (province d’Anvers). Le
collier, qui constitue un exemple très curieux,
se compose de deux grands médaillons représen-
tant saint Sébastien et un autre saint, à cheval. La
chaîne est formée de médaillons dont les cartouches
étaient réservés aux inscriptions relatives aux rois
du tir. Ces éléments alternent avec des diamants
de forme losangée d’où, chose curieuse, s’échappent
de véritables flammes, dont la signification se rap-
porte apparemment au caillou du collier institué
par Philippe le Bon, mais l’orfèvre a oublié le fusil
ou briquet. los. Destrée.
SBkSab’
A PROPOS DE L'EXPOSITION
ALBERT ET ISABELLE
ON s’est occupé récemment de nos musées en
réveillant la vieille légende de la chpmise
d'Isabelle, ayant soi-disant donné naissance à la
couleur qui porte son nom. 11 n’est, d’abord, pas
hors de propos de rappeler que l’incident delà che-
mise, rapporté à tort à notre archiduchesse, qui
aurait gardé ce vêtement pendant trois ans sans le
quitter un instant, est attribué, d’autre part,
par les Espagnols à Isabelle de Castille, dite la
Catholique, grand’mère de Charles-Quint, à l’occa-
sion du siège de Grenade. Quoi qu’il eu soit,
nous inclinons à croire, que, en ce qui concerne
la couleur isabelle, elle n’a rien à voir avec une
question de chemise.
Il est à remarquer, en effet, que la désignation
couleur isabelle n’est guère employée qu’à propos
de la robe d’un cheval. On dit un cheval couleur
isabelle ou un cheval isabelle tout court, comme
on dit un cheval bai,, et nous n’avons jamais
entendu employer le mot dans d’autres occasions.
Or, il se trouve que le cheval favori de l’archi-
duchesse avait la robe d'une teinte correspondant
exactement à celle qu’on désigne actuellement
encore sous le nom d’isabelle, ainsi qu’on peut s’en
rendre compte à notre Musée de la Porte de Hàl,
où la peau de ce cheval est conservée.
Il est, dès lors, bien naturel de penser que le nom
de couleur isabelle vient simplement de là et
qu’ainsi s’explique en même temps le fait que ce
nom ne s’emploie jamais que lorsqu’il est question
de chevaux.
Nous posséderions,dans ce cas, le prototype de la
couleur isabelle, ce qui ne manquerait pas d’être
assez piquant.
L’ancien arsenal de Bruxelles était beaucoup
plus riche en fait de souvenirs de l’archiduc Albert
et de l’Infante Isabelle que ne l’est actuellement le
Musée de la Porte de Hal.
37
Insigne de la Toison d’Or.
(Musée de la Porte de Hal.)
lippe le Bon alternent avec un artilleur appro-
chant la mèche de la lumière d’un canon.
Le collier du doyen de la Gilde souveraine des
coulevriniers-arquebusiers de Gand, placée sous
le vocable de saint Antoine, est un excellent
exemple des combi-
naisons auxquelles nos
ancêtres avaient re-
cours pour créer un bel
insigne. Les chaînons
du collier, en argent
doré, relevés d’émaux
de diverses couleurs,
comprennent deux élé-
ments bien distincts :
d’une part, le caillou à
étincelles présenté
entre deux briquets
affrontés; d’autre part,
1 a croix de Sain t-
André, obtenue par
deux arquebuses po-
sées en sautoir. Ces
armes sont accostées de
deux lions don! l’un est
couronné, et de la
lettre G, qui se rapporte évidemment à l’ori-
gine gantoise de la gilde, et du T ou tau, qui est un
attribut caractéristique de saint Antoine, ermite.
Au collier est appendu un papegai doré et émaillé,
timbré de la couronne impériale.
Citons aussi le collier donné à Pierre-Paul Ru-
bens par Rocockx, bourgmestre de la ville d’An-
vers. Dans cette excellente pièce d’orfèvrerie, qui
appartenait à 'feu M. le baron de Vinck de Winne-
zeele, l’artiste a chargé le fusil de deux arquebuses
en sautoir posées dans une couronne fleuronnée.
Dans un collier d’une gilde de Saint-Sébastien,
en argent repoussé et ciselé, qui fait partie de nos
collections, l’orfèvre du xvne siècle, Olivier Dauv,
de Louvain, nous présente une combinaison fort
bien réussie : les briquets adossés sont réunis par
une croix écotée de Saint-André. Ce double motif
alterne avec la pierre à fusil.
Dans un collier de la fin du xvrie siècle, d’une
gilde de Saint-Sébastien, légué à nos musées par
feu M. Jos. Evenepoel, on remarque que le motif
de la pierre éclatant entre les deux briquets alterne
avec un carquois rempli de flèches. L’interprétation
est inférieure, pour le style et l’exécution, à celle
dont il a été question dans le paragraphe précédent.
Parfois les orfèvres emploient les motifsdu collier
de la Toison d’or sans trop se rendre compte de la
valeur de ces symboles. A ce propos, il m’est tombé
ces jours derniers entre les main la photographie
d’un collier de corporation provenant d’une an-
cienne gilde de Schelle (province d’Anvers). Le
collier, qui constitue un exemple très curieux,
se compose de deux grands médaillons représen-
tant saint Sébastien et un autre saint, à cheval. La
chaîne est formée de médaillons dont les cartouches
étaient réservés aux inscriptions relatives aux rois
du tir. Ces éléments alternent avec des diamants
de forme losangée d’où, chose curieuse, s’échappent
de véritables flammes, dont la signification se rap-
porte apparemment au caillou du collier institué
par Philippe le Bon, mais l’orfèvre a oublié le fusil
ou briquet. los. Destrée.
SBkSab’
A PROPOS DE L'EXPOSITION
ALBERT ET ISABELLE
ON s’est occupé récemment de nos musées en
réveillant la vieille légende de la chpmise
d'Isabelle, ayant soi-disant donné naissance à la
couleur qui porte son nom. 11 n’est, d’abord, pas
hors de propos de rappeler que l’incident delà che-
mise, rapporté à tort à notre archiduchesse, qui
aurait gardé ce vêtement pendant trois ans sans le
quitter un instant, est attribué, d’autre part,
par les Espagnols à Isabelle de Castille, dite la
Catholique, grand’mère de Charles-Quint, à l’occa-
sion du siège de Grenade. Quoi qu’il eu soit,
nous inclinons à croire, que, en ce qui concerne
la couleur isabelle, elle n’a rien à voir avec une
question de chemise.
Il est à remarquer, en effet, que la désignation
couleur isabelle n’est guère employée qu’à propos
de la robe d’un cheval. On dit un cheval couleur
isabelle ou un cheval isabelle tout court, comme
on dit un cheval bai,, et nous n’avons jamais
entendu employer le mot dans d’autres occasions.
Or, il se trouve que le cheval favori de l’archi-
duchesse avait la robe d'une teinte correspondant
exactement à celle qu’on désigne actuellement
encore sous le nom d’isabelle, ainsi qu’on peut s’en
rendre compte à notre Musée de la Porte de Hàl,
où la peau de ce cheval est conservée.
Il est, dès lors, bien naturel de penser que le nom
de couleur isabelle vient simplement de là et
qu’ainsi s’explique en même temps le fait que ce
nom ne s’emploie jamais que lorsqu’il est question
de chevaux.
Nous posséderions,dans ce cas, le prototype de la
couleur isabelle, ce qui ne manquerait pas d’être
assez piquant.
L’ancien arsenal de Bruxelles était beaucoup
plus riche en fait de souvenirs de l’archiduc Albert
et de l’Infante Isabelle que ne l’est actuellement le
Musée de la Porte de Hal.