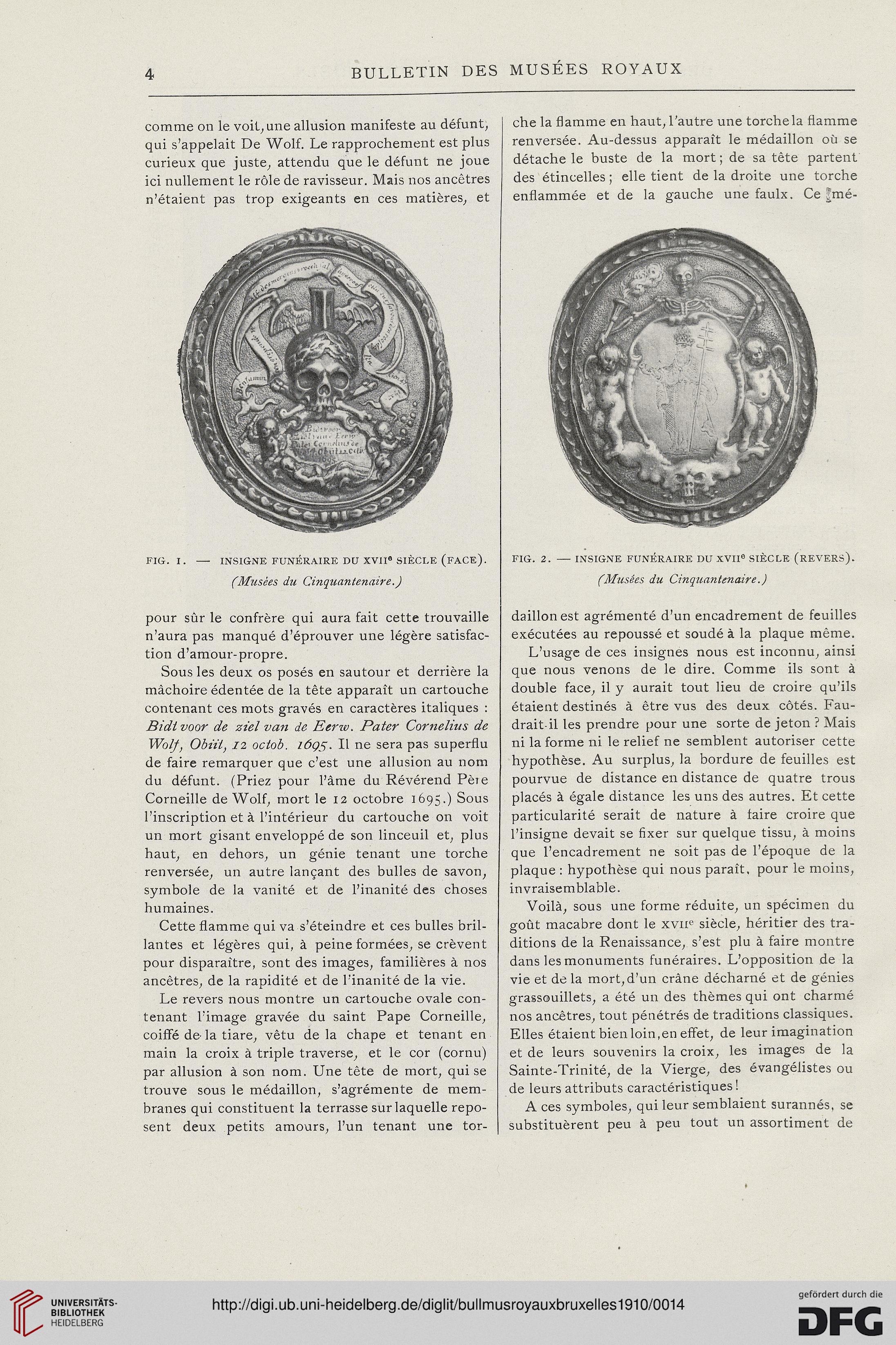4
BULLETIN DES MUSÉES ROYAUX
comme on le voit, une allusion manifeste au défunt,
qui s’appelait De Wolf. Le rapprochement est plus
curieux que juste, attendu que le défunt ne joue
ici nullement le rôle de ravisseur. Mais nos ancêtres
n’étaient pas trop exigeants en ces matières, et
FIG. I. — INSIGNE FUNÉRAIRE DU XVIIe SIÈCLE (FACE).
(Musées du Cinquantenaire.)
pour sûr le confrère qui aura fait cette trouvaille
n’aura pas manqué d’éprouver une légère satisfac-
tion d’amour-propre.
Sous les deux os posés en sautour et derrière la
mâchoire édentée de la tête apparaît un cartouche
contenant ces mots gravés en caractères italiques :
Bidi voor de ziel van de Eerw. Pater Cornélius de
Wolf, Obiii, 12 octob. i6q$. Il ne sera pas superflu
de faire remarquer que c’est une allusion au nom
du défunt. (Priez pour l’âme du Révérend Père
Corneille de Wolf, mort le 12 octobre 1695.) Sous
l’inscription et à l’intérieur du cartouche on voit
un mort gisant enveloppé de son linceuil et, plus
haut, en dehors, un génie tenant une torche
renversée, un autre lançant des bulles de savon,
symbole de la vanité et de l’inanité des choses
humaines.
Cette flamme qui va s’éteindre et ces bulles bril-
lantes et légères qui, à peine formées, se crèvent
pour disparaître, sont des images, familières à nos
ancêtres, de la rapidité et de l’inanité de la vie.
Le revers nous montre un cartouche ovale con-
tenant l’image gravée du saint Pape Corneille,
coiffé de-la tiare, vêtu delà chape et tenant en
main la croix à triple traverse, et le cor (cornu)
par allusion à son nom. Une tête de mort, qui se
trouve sous le médaillon, s’agrémente de mem-
branes qui constituent la terrasse sur laquelle repo-
sent deux petits amours, l’un tenant une tor-
che la flamme en haut, l’autre une torche la flamme
renversée. Au-dessus apparaît le médaillon où se
détache le buste de la mort ; de sa tête partent
des étincelles ; elle tient de la droite une torche
enflammée et de la gauche une faulx. Ce fmé-
FIG. 2. - INSIGNE FUNÉRAIRE DU XVIIe SIÈCLE (REVERS).
(Musées du Cinquantenaire.)
daillonest agrémenté d’un encadrement de feuilles
exécutées au repoussé et soudé à la plaque même.
L’usage de ces insignes nous est inconnu, ainsi
que nous venons de le dire. Comme ils sont à
double face, il y aurait tout lieu de croire qu’ils
étaient destinés à être vus des deux côtés. Fau-
drait il les prendre pour une sorte de jeton ? Mais
ni la forme ni le relief ne semblent autoriser cette
hypothèse. Au surplus, la bordure de feuilles est
pourvue de distance en distance de quatre trous
placés à égale distance les uns des autres. Et cette
particularité serait de nature à faire croire que
l’insigne devait se fixer sur quelque tissu, à moins
que l’encadrement ne soit pas de l’époque de la
plaque : hypothèse qui nous paraît, pour le moins,
invraisemblable.
Voilà, sous une forme réduite, un spécimen du
goût macabre dont le xvne siècle, héritier des tra-
ditions de la Renaissance, s’est plu à faire montre
dans les monuments funéraires. L’opposition de la
vie et de la mort, d’un crâne décharné et de génies
grassouillets, a été un des thèmes qui ont charmé
nos ancêtres, tout pénétrés de traditions classiques.
Elles étaient bien loin,en effet, de leur imagination
et de leurs souvenirs la croix, les images de la
Sainte-Trinité, de la Vierge, des évangélistes ou
de leurs attributs caractéristiques!
A ces symboles, qui leur semblaient surannés, se
substituèrent peu à peu tout un assortiment de
BULLETIN DES MUSÉES ROYAUX
comme on le voit, une allusion manifeste au défunt,
qui s’appelait De Wolf. Le rapprochement est plus
curieux que juste, attendu que le défunt ne joue
ici nullement le rôle de ravisseur. Mais nos ancêtres
n’étaient pas trop exigeants en ces matières, et
FIG. I. — INSIGNE FUNÉRAIRE DU XVIIe SIÈCLE (FACE).
(Musées du Cinquantenaire.)
pour sûr le confrère qui aura fait cette trouvaille
n’aura pas manqué d’éprouver une légère satisfac-
tion d’amour-propre.
Sous les deux os posés en sautour et derrière la
mâchoire édentée de la tête apparaît un cartouche
contenant ces mots gravés en caractères italiques :
Bidi voor de ziel van de Eerw. Pater Cornélius de
Wolf, Obiii, 12 octob. i6q$. Il ne sera pas superflu
de faire remarquer que c’est une allusion au nom
du défunt. (Priez pour l’âme du Révérend Père
Corneille de Wolf, mort le 12 octobre 1695.) Sous
l’inscription et à l’intérieur du cartouche on voit
un mort gisant enveloppé de son linceuil et, plus
haut, en dehors, un génie tenant une torche
renversée, un autre lançant des bulles de savon,
symbole de la vanité et de l’inanité des choses
humaines.
Cette flamme qui va s’éteindre et ces bulles bril-
lantes et légères qui, à peine formées, se crèvent
pour disparaître, sont des images, familières à nos
ancêtres, de la rapidité et de l’inanité de la vie.
Le revers nous montre un cartouche ovale con-
tenant l’image gravée du saint Pape Corneille,
coiffé de-la tiare, vêtu delà chape et tenant en
main la croix à triple traverse, et le cor (cornu)
par allusion à son nom. Une tête de mort, qui se
trouve sous le médaillon, s’agrémente de mem-
branes qui constituent la terrasse sur laquelle repo-
sent deux petits amours, l’un tenant une tor-
che la flamme en haut, l’autre une torche la flamme
renversée. Au-dessus apparaît le médaillon où se
détache le buste de la mort ; de sa tête partent
des étincelles ; elle tient de la droite une torche
enflammée et de la gauche une faulx. Ce fmé-
FIG. 2. - INSIGNE FUNÉRAIRE DU XVIIe SIÈCLE (REVERS).
(Musées du Cinquantenaire.)
daillonest agrémenté d’un encadrement de feuilles
exécutées au repoussé et soudé à la plaque même.
L’usage de ces insignes nous est inconnu, ainsi
que nous venons de le dire. Comme ils sont à
double face, il y aurait tout lieu de croire qu’ils
étaient destinés à être vus des deux côtés. Fau-
drait il les prendre pour une sorte de jeton ? Mais
ni la forme ni le relief ne semblent autoriser cette
hypothèse. Au surplus, la bordure de feuilles est
pourvue de distance en distance de quatre trous
placés à égale distance les uns des autres. Et cette
particularité serait de nature à faire croire que
l’insigne devait se fixer sur quelque tissu, à moins
que l’encadrement ne soit pas de l’époque de la
plaque : hypothèse qui nous paraît, pour le moins,
invraisemblable.
Voilà, sous une forme réduite, un spécimen du
goût macabre dont le xvne siècle, héritier des tra-
ditions de la Renaissance, s’est plu à faire montre
dans les monuments funéraires. L’opposition de la
vie et de la mort, d’un crâne décharné et de génies
grassouillets, a été un des thèmes qui ont charmé
nos ancêtres, tout pénétrés de traditions classiques.
Elles étaient bien loin,en effet, de leur imagination
et de leurs souvenirs la croix, les images de la
Sainte-Trinité, de la Vierge, des évangélistes ou
de leurs attributs caractéristiques!
A ces symboles, qui leur semblaient surannés, se
substituèrent peu à peu tout un assortiment de