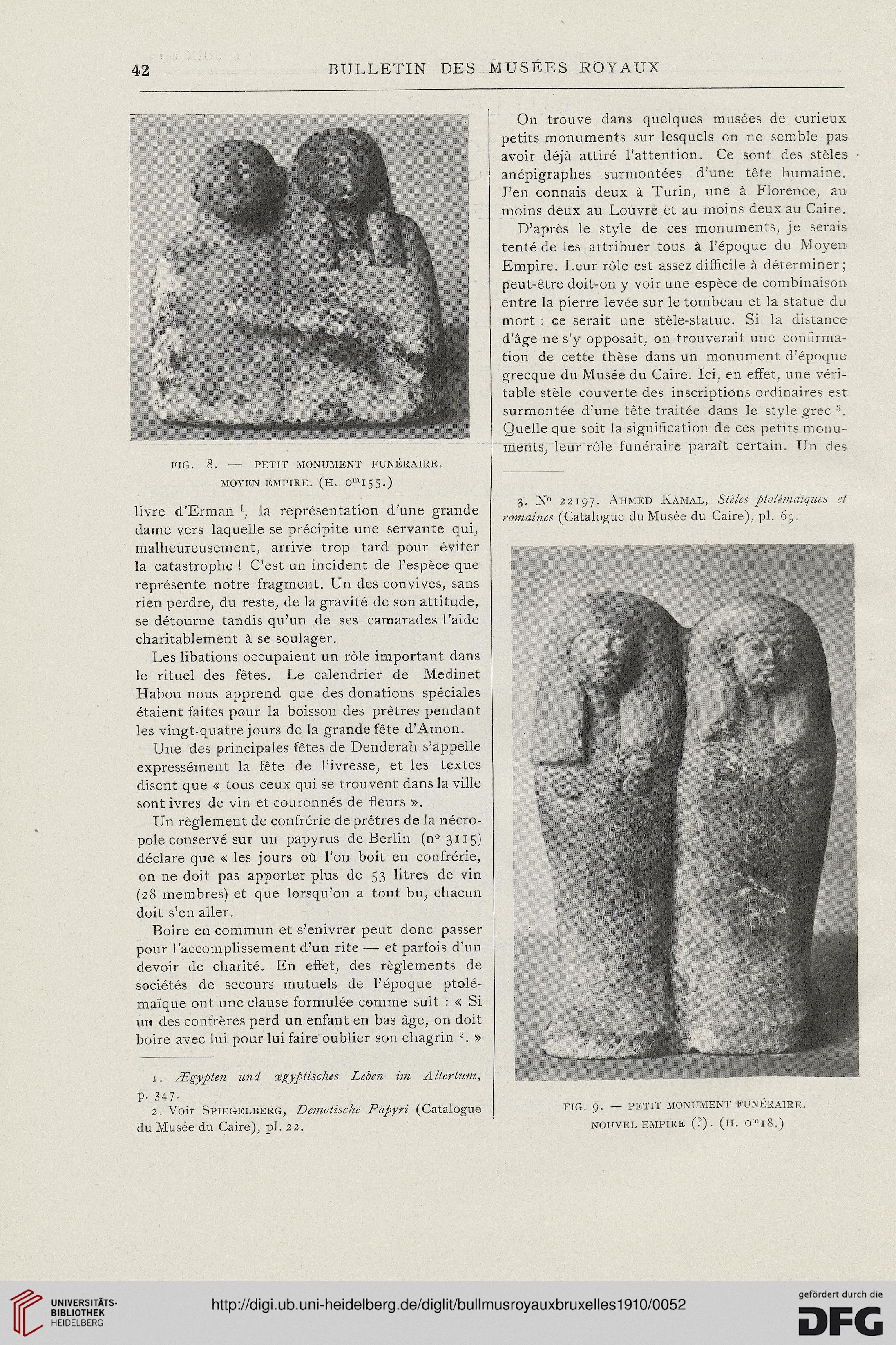42
BULLETIN DES MUSÉES ROYAUX
FIG. 8. - PETIT MONUMENT FUNÉRAIRE.
MOYEN EMPIRE, (h. OmI55.)
livre d'Erman *, la représentation d'une grande
dame vers laquelle se précipite une servante qui,
malheureusement, arrive trop tard pour éviter
la catastrophe ! C’est un incident de l’espèce que
représente notre fragment. Un des convives, sans
rien perdre, du reste, de la gravité de son attitude,
se détourne tandis qu’un de ses camarades l’aide
charitablement à se soulager.
Les libations occupaient un rôle important dans
le rituel des fêtes. Le calendrier de Medinet
Habou nous apprend que des donations spéciales
étaient faites pour la boisson des prêtres pendant
les vingt-quatre jours de la grande fête d’Amon.
Une des principales fêtes de Denderah s’appelle
expressément la fête de l’ivresse, et les textes
disent que « tous ceux qui se trouvent dans la ville
sont ivres de vin et couronnés de fleurs ».
Un règlement de confrérie de prêtres de la nécro-
pole conservé sur un papyrus de Berlin (n°3ii5)
déclare que « les jours où l’on boit en confrérie,
on ne doit pas apporter plus de 53 litres de vin
(28 membres) et que lorsqu’on a tout bu, chacun
doit s’en aller.
Boire en commun et s’enivrer peut donc passer
pour l’accomplissement d’un rite — et parfois d’un
devoir de charité. En effet, des règlements de
sociétés de secours mutuels de l’époque ptolé-
maïque ont une clause formulée comme suit : « Si
un des confrères perd un enfant en bas âge, on doit
boire avec lui pour lui faire oublier son chagrin 1 2. »
1. Ægypten uni œgyptisclus Leben im A Itertum,
P- 347-
2. Voir Spiegelberg, Demotïsche Papy ri (Catalogue
du Musée du Caire), pl. 22.
On trouve dans quelques musées de curieux
petits monuments sur lesquels on ne semble pas
avoir déjà attiré l’attention. Ce sont des stèles
anépigraphes surmontées d’une tête humaine.
J’en connais deux à Turin, une à Florence, au
moins deux au Louvre et au moins deux au Caire.
D’après le style de ces monuments, je serais
tenté de les attribuer tous à l’époque du Moyen
Empire. Leur rôle est assez difficile à déterminer;
peut-être doit-on y voir une espèce de combinaison
entre la pierre levée sur le tombeau et la statue du
mort : ce serait une stèle-statue. Si la distance
d’âge ne s’y opposait, on trouverait une confirma-
tion de cette thèse dans un monument d’époque
grecque du Musée du Caire. Ici, en effet, une véri-
table stèle couverte des inscriptions ordinaires est
surmontée d’une tête traitée dans le style grec 3.
Quelle que soit la signification de ces petits monu-
ments, leur rôle funéraire paraît certain. Un des
3. N° 22197. Ahmed Kamal, Stèles ptolèmàïques et
romaines (Catalogue du Musée du Caire), pl. 69.
FIG. 9. — PETIT MONUMENT FUNÉRAIRE.
NOUVEL EMPIRE (?) . (H. Oml8.)
BULLETIN DES MUSÉES ROYAUX
FIG. 8. - PETIT MONUMENT FUNÉRAIRE.
MOYEN EMPIRE, (h. OmI55.)
livre d'Erman *, la représentation d'une grande
dame vers laquelle se précipite une servante qui,
malheureusement, arrive trop tard pour éviter
la catastrophe ! C’est un incident de l’espèce que
représente notre fragment. Un des convives, sans
rien perdre, du reste, de la gravité de son attitude,
se détourne tandis qu’un de ses camarades l’aide
charitablement à se soulager.
Les libations occupaient un rôle important dans
le rituel des fêtes. Le calendrier de Medinet
Habou nous apprend que des donations spéciales
étaient faites pour la boisson des prêtres pendant
les vingt-quatre jours de la grande fête d’Amon.
Une des principales fêtes de Denderah s’appelle
expressément la fête de l’ivresse, et les textes
disent que « tous ceux qui se trouvent dans la ville
sont ivres de vin et couronnés de fleurs ».
Un règlement de confrérie de prêtres de la nécro-
pole conservé sur un papyrus de Berlin (n°3ii5)
déclare que « les jours où l’on boit en confrérie,
on ne doit pas apporter plus de 53 litres de vin
(28 membres) et que lorsqu’on a tout bu, chacun
doit s’en aller.
Boire en commun et s’enivrer peut donc passer
pour l’accomplissement d’un rite — et parfois d’un
devoir de charité. En effet, des règlements de
sociétés de secours mutuels de l’époque ptolé-
maïque ont une clause formulée comme suit : « Si
un des confrères perd un enfant en bas âge, on doit
boire avec lui pour lui faire oublier son chagrin 1 2. »
1. Ægypten uni œgyptisclus Leben im A Itertum,
P- 347-
2. Voir Spiegelberg, Demotïsche Papy ri (Catalogue
du Musée du Caire), pl. 22.
On trouve dans quelques musées de curieux
petits monuments sur lesquels on ne semble pas
avoir déjà attiré l’attention. Ce sont des stèles
anépigraphes surmontées d’une tête humaine.
J’en connais deux à Turin, une à Florence, au
moins deux au Louvre et au moins deux au Caire.
D’après le style de ces monuments, je serais
tenté de les attribuer tous à l’époque du Moyen
Empire. Leur rôle est assez difficile à déterminer;
peut-être doit-on y voir une espèce de combinaison
entre la pierre levée sur le tombeau et la statue du
mort : ce serait une stèle-statue. Si la distance
d’âge ne s’y opposait, on trouverait une confirma-
tion de cette thèse dans un monument d’époque
grecque du Musée du Caire. Ici, en effet, une véri-
table stèle couverte des inscriptions ordinaires est
surmontée d’une tête traitée dans le style grec 3.
Quelle que soit la signification de ces petits monu-
ments, leur rôle funéraire paraît certain. Un des
3. N° 22197. Ahmed Kamal, Stèles ptolèmàïques et
romaines (Catalogue du Musée du Caire), pl. 69.
FIG. 9. — PETIT MONUMENT FUNÉRAIRE.
NOUVEL EMPIRE (?) . (H. Oml8.)