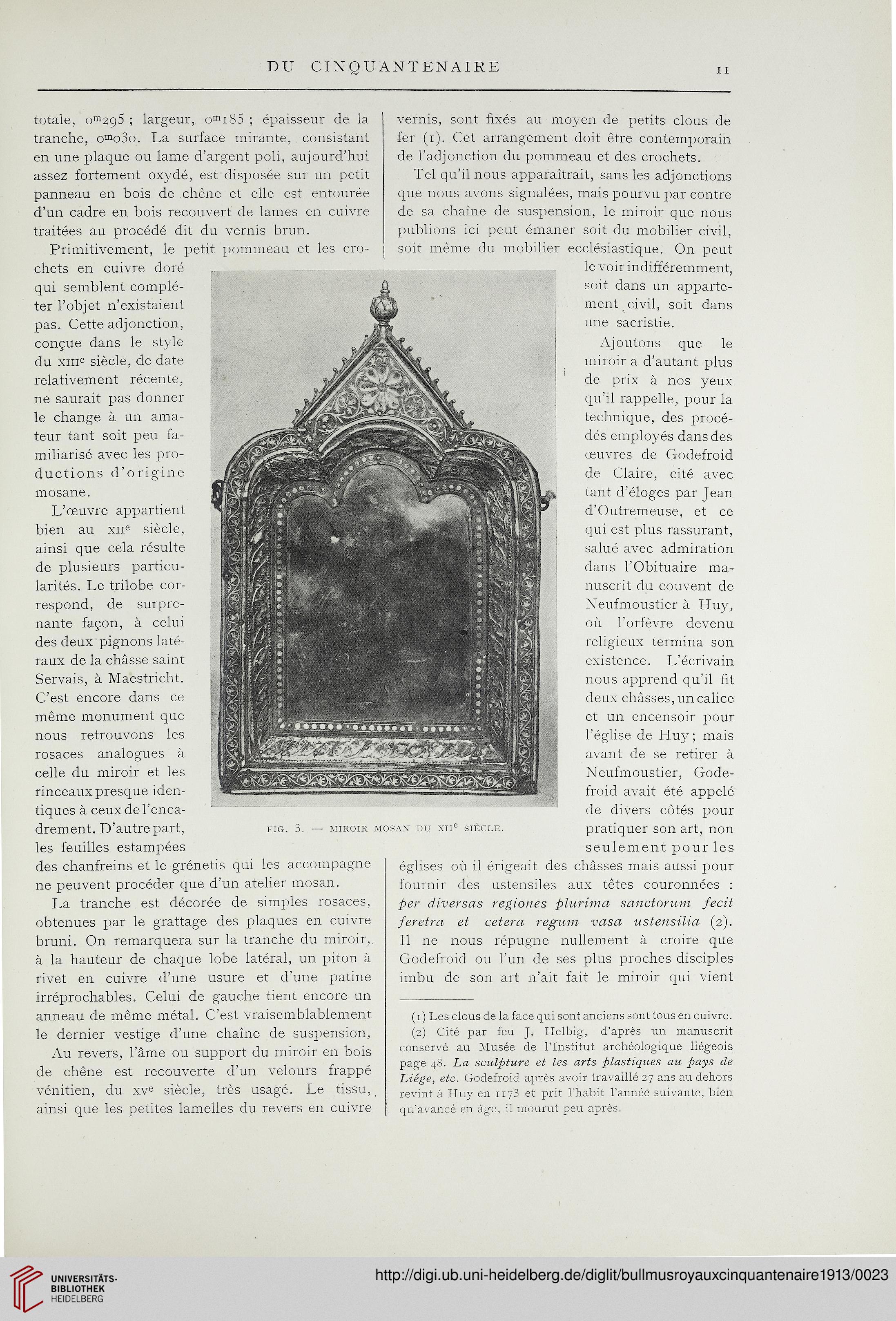DU CINQUANTENAIRE
11
totale, om295 ; largeur, omiS5 ; épaisseur de la
tranche, omo3o. La surface mirante, consistant
en une plaque ou lame d’argent poli, aujourd’hui
assez fortement oxydé, est disposée sur un petit
panneau en bois de chêne et elle est entourée
d’un cadre en bois recouvert de lames en cuivre
traitées au procédé dit du vernis brun.
Primitivement, le petit pommeau et les cro-
chets en cuivre doré
qui semblent complé-
ter l’objet n’existaient
pas. Cette adjonction,
conçue dans le style
du xme siècle, de date
relativement récente,
ne saurait pas donner
le change à un ama-
teur tant soit peu fa-
miliarisé avec les pro-
ductions d’origine
mosane.
L’œuvre appartient
bien au xne siècle,
ainsi que cela résulte
de plusieurs particu-
larités. Le trilobé cor-
respond, de surpre-
nante façon, à celui
des deux pignons laté-
raux de la châsse saint
Servais, à Maestricht.
C’est encore dans ce
même monument que
nous retrouvons les
rosaces analogues à
celle du miroir et les
rinceaux presque iden-
tiques à ceux de l’enca-
drement. D’autre part,
les feuilles estampées
des chanfreins et le grénetis qui les accompagne
ne peuvent procéder que d’un atelier mosan.
La tranche est décorée de simples rosaces,
obtenues par le grattage des plaques en cuivre
bruni. On remarquera sur la tranche du miroir,
à la hauteur de chaque lobe latéral, un piton à
rivet en cuivre d’une usure et d’une patine
irréprochables. Celui de gauche tient encore un
anneau de même métal. C’est vraisemblablement
le dernier vestige d’une chaîne de suspension.
Au revers, l’âme ou support du miroir en bois
de chêne est recouverte d’un velours frappé
vénitien, du xve siècle, très usagé. Le tissu,
ainsi que les petites lamelles du revers en cuivre
vernis, sont fixés au moyen de petits clous de
fer (i). Cet arrangement doit être contemporain
de l’adjonction du pommeau et des crochets.
Tel qu’il nous apparaîtrait, sans les adjonctions
que nous avons signalées, mais pourvu par contre
de sa chaîne de suspension, le miroir que nous
publions ici peut émaner soit du mobilier civil,
soit même du mobilier ecclésiastique. On peut
le voir indifféremment,
soit dans un apparte-
ment civil, soit dans
une sacristie.
Ajoutons que le
miroir a d’autant plus
de prix à nos yeux
qu'il rappelle, pour la
technique, des procé-
dés employés dans des
œuvres de Godefroid
de Claire, cité avec
tant d’éloges par Jean
d’Outremeuse, et ce
qui est plus rassurant,
salué avec admiration
dans l’Obituaire ma-
nuscrit du couvent de
Neufmoustier à 11uy,
où l'orfèvre devenu
religieux termina son
existence. L’écrivain
nous apprend qu’il fit
deux châsses, un calice
et un encensoir pour
l’église de Huy; mais
avant de se retirer à
Neufmoustier, Gode-
froid avait été appelé
de divers côtés pour
pratiquer son art, non
seulement pour les
églises où il érigeait des châsses mais aussi pour
fournir des ustensiles aux têtes couronnées :
per diversas regiones plurima sanctorum fecit
feretra et cetera regain vasa usteusilia (2).
Il ne nous répugne nullement à croire que
Godefroid ou l’un de ses plus proches disciples
imbu de son art n’ait fait le miroir qui vient
(1) Les clous de la face qui sont anciens sont tous en cuivre.
(2) Cité par feu J. Helbig, d’après un manuscrit
conservé au Musée de l’Institut archéologique liégeois
page 48. La sculpture et les arts plastiques au pays de
Liège, etc. Godefroid après avoir travaillé 27 ans au dehors
revint à Huy en 1173 et prit l’habit l’année suivante, bien
qu’avancé en âge, il mourut peu après.
FIG. 3. — MIROIR MOSAN DU XIIe SIÈCLE.
11
totale, om295 ; largeur, omiS5 ; épaisseur de la
tranche, omo3o. La surface mirante, consistant
en une plaque ou lame d’argent poli, aujourd’hui
assez fortement oxydé, est disposée sur un petit
panneau en bois de chêne et elle est entourée
d’un cadre en bois recouvert de lames en cuivre
traitées au procédé dit du vernis brun.
Primitivement, le petit pommeau et les cro-
chets en cuivre doré
qui semblent complé-
ter l’objet n’existaient
pas. Cette adjonction,
conçue dans le style
du xme siècle, de date
relativement récente,
ne saurait pas donner
le change à un ama-
teur tant soit peu fa-
miliarisé avec les pro-
ductions d’origine
mosane.
L’œuvre appartient
bien au xne siècle,
ainsi que cela résulte
de plusieurs particu-
larités. Le trilobé cor-
respond, de surpre-
nante façon, à celui
des deux pignons laté-
raux de la châsse saint
Servais, à Maestricht.
C’est encore dans ce
même monument que
nous retrouvons les
rosaces analogues à
celle du miroir et les
rinceaux presque iden-
tiques à ceux de l’enca-
drement. D’autre part,
les feuilles estampées
des chanfreins et le grénetis qui les accompagne
ne peuvent procéder que d’un atelier mosan.
La tranche est décorée de simples rosaces,
obtenues par le grattage des plaques en cuivre
bruni. On remarquera sur la tranche du miroir,
à la hauteur de chaque lobe latéral, un piton à
rivet en cuivre d’une usure et d’une patine
irréprochables. Celui de gauche tient encore un
anneau de même métal. C’est vraisemblablement
le dernier vestige d’une chaîne de suspension.
Au revers, l’âme ou support du miroir en bois
de chêne est recouverte d’un velours frappé
vénitien, du xve siècle, très usagé. Le tissu,
ainsi que les petites lamelles du revers en cuivre
vernis, sont fixés au moyen de petits clous de
fer (i). Cet arrangement doit être contemporain
de l’adjonction du pommeau et des crochets.
Tel qu’il nous apparaîtrait, sans les adjonctions
que nous avons signalées, mais pourvu par contre
de sa chaîne de suspension, le miroir que nous
publions ici peut émaner soit du mobilier civil,
soit même du mobilier ecclésiastique. On peut
le voir indifféremment,
soit dans un apparte-
ment civil, soit dans
une sacristie.
Ajoutons que le
miroir a d’autant plus
de prix à nos yeux
qu'il rappelle, pour la
technique, des procé-
dés employés dans des
œuvres de Godefroid
de Claire, cité avec
tant d’éloges par Jean
d’Outremeuse, et ce
qui est plus rassurant,
salué avec admiration
dans l’Obituaire ma-
nuscrit du couvent de
Neufmoustier à 11uy,
où l'orfèvre devenu
religieux termina son
existence. L’écrivain
nous apprend qu’il fit
deux châsses, un calice
et un encensoir pour
l’église de Huy; mais
avant de se retirer à
Neufmoustier, Gode-
froid avait été appelé
de divers côtés pour
pratiquer son art, non
seulement pour les
églises où il érigeait des châsses mais aussi pour
fournir des ustensiles aux têtes couronnées :
per diversas regiones plurima sanctorum fecit
feretra et cetera regain vasa usteusilia (2).
Il ne nous répugne nullement à croire que
Godefroid ou l’un de ses plus proches disciples
imbu de son art n’ait fait le miroir qui vient
(1) Les clous de la face qui sont anciens sont tous en cuivre.
(2) Cité par feu J. Helbig, d’après un manuscrit
conservé au Musée de l’Institut archéologique liégeois
page 48. La sculpture et les arts plastiques au pays de
Liège, etc. Godefroid après avoir travaillé 27 ans au dehors
revint à Huy en 1173 et prit l’habit l’année suivante, bien
qu’avancé en âge, il mourut peu après.
FIG. 3. — MIROIR MOSAN DU XIIe SIÈCLE.