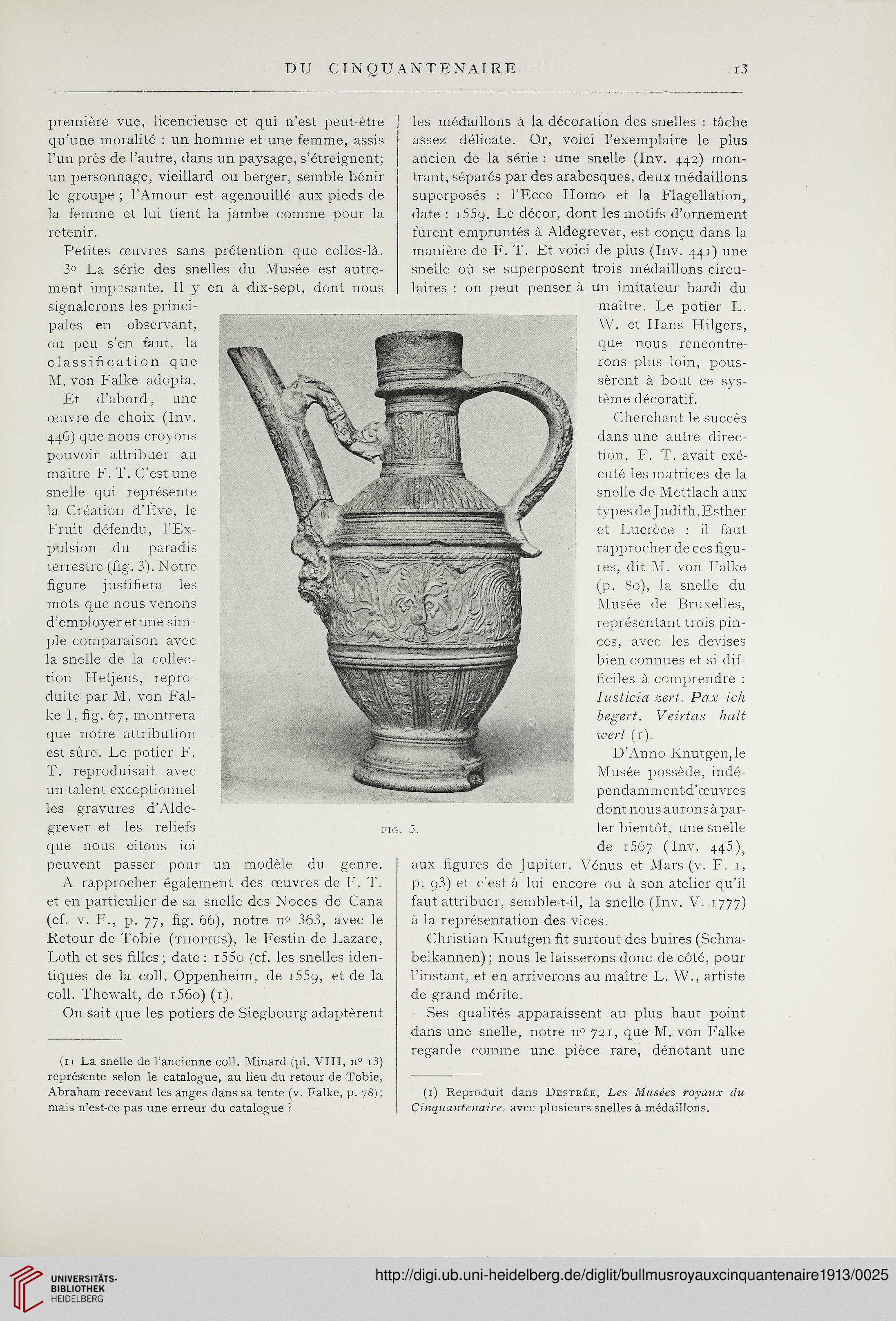DU CINQUANTENAIRE
i3
première vue, licencieuse et qui n’est peut-être
qu’une moralité : un homme et une femme, assis
l’un près de l’autre, dans un paysage, s’étreignent;
un personnage, vieillard ou berger, semble bénir
le groupe ; l’Amour est agenouillé aux pieds de
la femme et lui tient la jambe comme pour la
retenir.
Petites œuvres sans prétention que celles-là.
3° La série des snelles du Musée est autre-
ment impesante. Il y en a dix-sept, dont nous
signalerons les princi-
pales en observant,
ou peu s’en faut, la
classification que
M. von Falke adopta.
Et d’abord, une
œuvre de choix (Inv.
446) que nous croyons
pouvoir attribuer au
maitre F. T. C’est une
snelle qui représente
la Création d’Eve, le
Fruit défendu, l’Ex-
pulsion du paradis
terrestre (fig. 3). Notre
figure justifiera les
mots que nous venons
d’employer et une sim-
ple comparaison avec
la snelle de la collec-
tion Hetjens, repro-
duite par M. von Fal-
ke I, fig. 67, montrera
que notre attribution
est sûre. Le potier F.
T. reproduisait avec
un talent exceptionnel
les gravures d’Alde-
grever et les reliefs
que nous citons ici
peuvent passer pour un modèle du genre.
A rapprocher également des œuvres de F. T.
et en particulier de sa snelle des Noces de Cana
(cf. v. F., p. 77, fig. 66), notre n° 363, avec le
Retour de Tobie (thopius), le Festin de Lazare,
Loth et ses filles; date : i55o (cf. les snelles iden-
tiques de la coll. Oppenheim, de 155g, et de la
coll. Thewalt, de i56o) (1).
On sait que les potiers de Siegbourg adaptèrent (i)
(i) La snelle de l’ancienne coll. Minard (pl. VIII, n° 13)
représente selon le catalogue, au lieu du retour de Tobie,
Abraham recevant les anges dans sa tente (v. Falke, p. 78);
mais n’est-ce pas une erreur du catalogue ?
les médaillons à la décoration des snelles : tâche
assez délicate. Or, voici l’exemplaire le plus
ancien de la série : une snelle (Inv. 442) mon-
trant, séparés par des arabesques, deux médaillons
superposés : l’Ecce Homo et la Flagellation,
date : i55g. Le décor, dont les motifs d’ornement
furent empruntés à Aldegrever, est conçu dans la
manière de F. T. Et voici de plus (Inv. 441) une
snelle où se superposent trois médaillons circu-
laires : on peut penser à un imitateur hardi du
maître. Le potier L.
W. et Hans Hilgers,
que nous rencontre-
rons plus loin, pous-
sèrent à bout ce sys-
tème décoratif.
Cherchant le succès
dans une autre direc-
tion, E. T. avait exé-
cuté les matrices de la
snelle de Mettlach aux
types de Judith, Esther
et Lucrèce : il faut
rapprocher de ces figu-
res, dit M. von Falke
(p. 80), la snelle du
Musée de Bruxelles,
représentant trois pin-
ces, avec les devises
bien connues et si dif-
ficiles à comprendre :
Iusticia zert. Pax ich
begert. Veirtas haït
wert (1).
D’Anno Knutgen,le
Musée possède, indé-
pendammentd’œuvres
dont nous aurons à par-
!er bientôt, une snelle
de i567 (Inv. 440 );
aux figures de Jupiter, Vénus et Mars (v. F. 1,
p. g3) et c’est à lui encore ou à son atelier qu’il
faut attribuer, semble-t-il, la snelle (Inv. V. 1777)
à la représentation des vices.
Christian Knutgen fit surtout des buires (Schna-
belkannen) ; nous le laisserons donc de côté, pour
l’instant, et en arriverons au maître L. W., artiste
de grand mérite.
Ses qualités apparaissent au plus haut point
dans une snelle, notre n° 721, que M. von Falke
regarde comme une pièce rare, dénotant une
(1) Reproduit dans Destrée, Les Musées royaux du
Cinquantenaire, avec plusieurs snelles à médaillons.
i3
première vue, licencieuse et qui n’est peut-être
qu’une moralité : un homme et une femme, assis
l’un près de l’autre, dans un paysage, s’étreignent;
un personnage, vieillard ou berger, semble bénir
le groupe ; l’Amour est agenouillé aux pieds de
la femme et lui tient la jambe comme pour la
retenir.
Petites œuvres sans prétention que celles-là.
3° La série des snelles du Musée est autre-
ment impesante. Il y en a dix-sept, dont nous
signalerons les princi-
pales en observant,
ou peu s’en faut, la
classification que
M. von Falke adopta.
Et d’abord, une
œuvre de choix (Inv.
446) que nous croyons
pouvoir attribuer au
maitre F. T. C’est une
snelle qui représente
la Création d’Eve, le
Fruit défendu, l’Ex-
pulsion du paradis
terrestre (fig. 3). Notre
figure justifiera les
mots que nous venons
d’employer et une sim-
ple comparaison avec
la snelle de la collec-
tion Hetjens, repro-
duite par M. von Fal-
ke I, fig. 67, montrera
que notre attribution
est sûre. Le potier F.
T. reproduisait avec
un talent exceptionnel
les gravures d’Alde-
grever et les reliefs
que nous citons ici
peuvent passer pour un modèle du genre.
A rapprocher également des œuvres de F. T.
et en particulier de sa snelle des Noces de Cana
(cf. v. F., p. 77, fig. 66), notre n° 363, avec le
Retour de Tobie (thopius), le Festin de Lazare,
Loth et ses filles; date : i55o (cf. les snelles iden-
tiques de la coll. Oppenheim, de 155g, et de la
coll. Thewalt, de i56o) (1).
On sait que les potiers de Siegbourg adaptèrent (i)
(i) La snelle de l’ancienne coll. Minard (pl. VIII, n° 13)
représente selon le catalogue, au lieu du retour de Tobie,
Abraham recevant les anges dans sa tente (v. Falke, p. 78);
mais n’est-ce pas une erreur du catalogue ?
les médaillons à la décoration des snelles : tâche
assez délicate. Or, voici l’exemplaire le plus
ancien de la série : une snelle (Inv. 442) mon-
trant, séparés par des arabesques, deux médaillons
superposés : l’Ecce Homo et la Flagellation,
date : i55g. Le décor, dont les motifs d’ornement
furent empruntés à Aldegrever, est conçu dans la
manière de F. T. Et voici de plus (Inv. 441) une
snelle où se superposent trois médaillons circu-
laires : on peut penser à un imitateur hardi du
maître. Le potier L.
W. et Hans Hilgers,
que nous rencontre-
rons plus loin, pous-
sèrent à bout ce sys-
tème décoratif.
Cherchant le succès
dans une autre direc-
tion, E. T. avait exé-
cuté les matrices de la
snelle de Mettlach aux
types de Judith, Esther
et Lucrèce : il faut
rapprocher de ces figu-
res, dit M. von Falke
(p. 80), la snelle du
Musée de Bruxelles,
représentant trois pin-
ces, avec les devises
bien connues et si dif-
ficiles à comprendre :
Iusticia zert. Pax ich
begert. Veirtas haït
wert (1).
D’Anno Knutgen,le
Musée possède, indé-
pendammentd’œuvres
dont nous aurons à par-
!er bientôt, une snelle
de i567 (Inv. 440 );
aux figures de Jupiter, Vénus et Mars (v. F. 1,
p. g3) et c’est à lui encore ou à son atelier qu’il
faut attribuer, semble-t-il, la snelle (Inv. V. 1777)
à la représentation des vices.
Christian Knutgen fit surtout des buires (Schna-
belkannen) ; nous le laisserons donc de côté, pour
l’instant, et en arriverons au maître L. W., artiste
de grand mérite.
Ses qualités apparaissent au plus haut point
dans une snelle, notre n° 721, que M. von Falke
regarde comme une pièce rare, dénotant une
(1) Reproduit dans Destrée, Les Musées royaux du
Cinquantenaire, avec plusieurs snelles à médaillons.