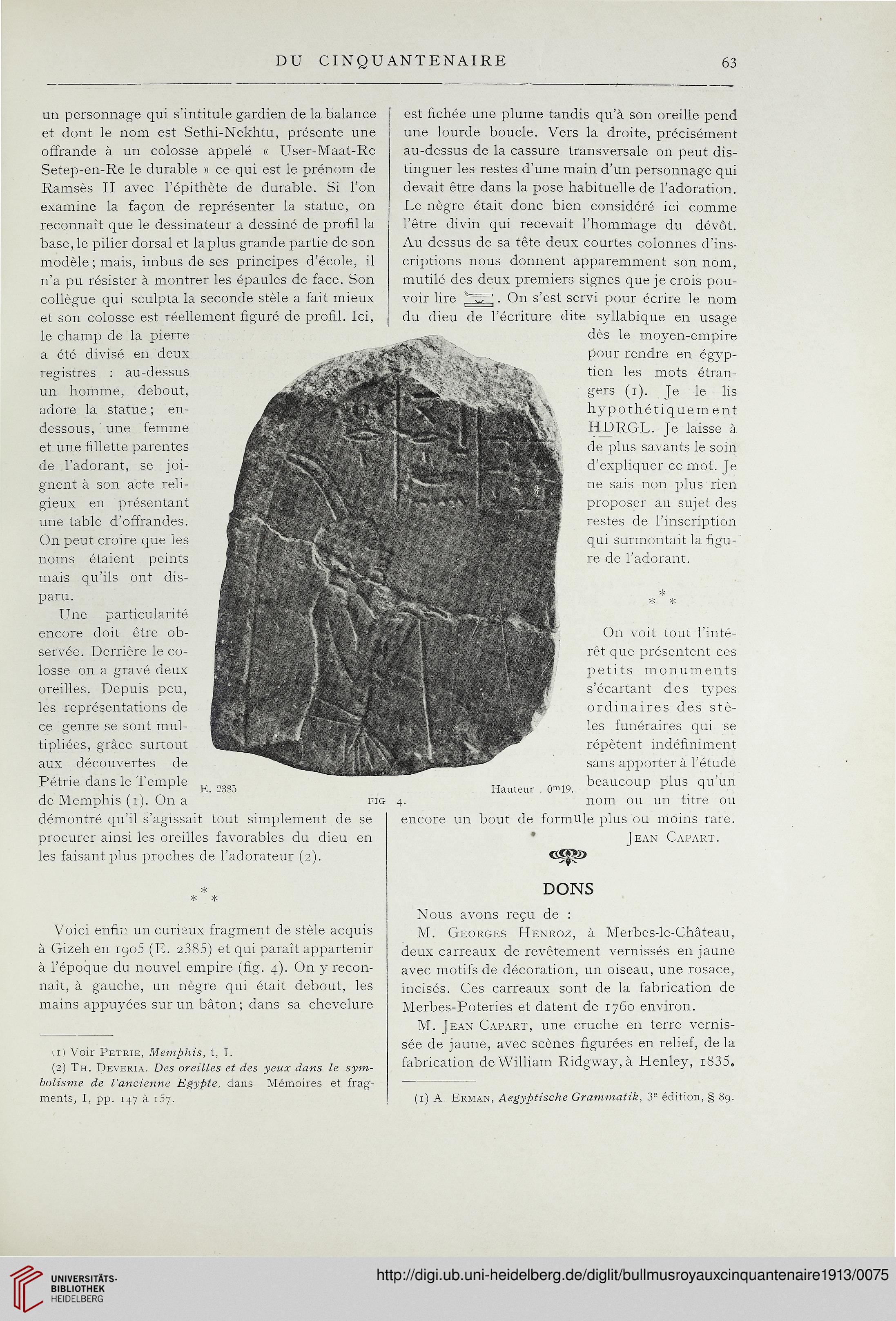DU CINQUANTENAIRE
63
un personnage qui s'intitule gardien de la balance
et dont le nom est Sethi-Nekhtu, présente une
offrande à un colosse appelé « User-Maat-Re
Setep-en-Re le durable » ce qui est le prénom de
Ramsès II avec l’épithète de durable. Si l’on
examine la façon de représenter la statue, on
reconnaît que le dessinateur a dessiné de profil la
base, le pilier dorsal et la plus grande partie de son
modèle; mais, imbus de ses principes d’école, il
n’a pu résister à montrer les épaules de face. Son
collègue qui sculpta la seconde stèle a fait mieux
et son colosse est réellement figuré de profil. Ici,
le champ de la pierre
a été divisé en deux
registres : au-dessus
un homme, debout,
adore la statue ; en-
dessous, une femme
et une fillette parentes
de l’adorant, se joi-
gnent à son acte reli-
gieux en présentant
une table d’offrandes.
On peut croire que les
noms étaient peints
mais qu’ils ont dis-
paru.
Une particularité
encore doit être ob-
servée. Derrière le co-
losse on a gravé deux
oreilles. Depuis peu,
les représentations de
ce genre se sont mul-
tipliées, grâce surtout
aux découvertes de
Pétrie dans le Temple „ 0„_
de Memphis (i). On a fig
démontré qu’il s’agissait tout simplement de se
procurer ainsi les oreilles favorables du dieu en
les faisant plus proches de l’adorateur (2).
est fichée une plume tandis qu’à son oreille pend
une lourde boucle. Vers la droite, précisément
au-dessus de la cassure transversale on peut dis-
tinguer les restes d’une main d’un personnage qui
devait être dans la pose habituelle de l’adoration.
Le nègre était donc bien considéré ici comme
l’être divin qui recevait l’hommage du dévot.
Au dessus de sa tête deux courtes colonnes d’ins-
criptions nous donnent apparemment son nom,
mutilé des deux premiers signes que je crois pou-
voir lire Jmrq. On s’est servi pour écrire le nom
du dieu de l’écriture dite syllabique en usage
dès le moyen-empire
pour rendre en égyp-
tien les mots étran-
gers (1). Je le lis
hypothétique m ent
HDRGL. Je laisse à
de plus savants le soin
d’expliquer ce mot. Je
ne sais non plus rien
proposer au sujet des
restes de l’inscription
qui surmontait la figu-
re de l’adorant.
On voit tout l’inté-
rêt que présentent ces
petits monuments
s’écartant des types
ordinaires des stè-
les funéraires qui se
répètent indéfiniment
sans apporter à l’étude
TT „ beaucoup plus qu’un
4. nom ou un titre ou
encore un bout de formule plus ou moins rare.
Jean Capart.
*
* *
Voici enfin un curieux fragment de stèle acquis
à Gizeh en igo5 (E. 2385) et qui paraît appartenir
à l’époque du nouvel empire (fig. 4). On y recon-
naît, à gauche, un nègre qui était debout, les
mains appuyées sur un bâton ; dans sa chevelure
U) Voir Petrie, Memphis, t, I.
(2) Th. Deveria. Des oreilles et des yeux dans le sym-
bolisme de l'ancienne Egypte, dans Mémoires et frag-
ments, I, pp. 147 à 157.
DONS
Nous avons reçu de :
M. Georges Henroz, à Merbes-le-Château,
deux carreaux de revêtement vernissés en jaune
avec motifs de décoration, un oiseau, une rosace,
incisés. Ges carreaux sont de la fabrication de
Merbes-Poteries et datent de 1760 environ.
M. Jean Capart, une cruche en terre vernis-
sée de jaune, avec scènes figurées en relief, de la
fabrication de William Ridgway, à Henley, i835.
(1) A. Erman, Aegyptische Grammatik, 3e édition, § 8g.
63
un personnage qui s'intitule gardien de la balance
et dont le nom est Sethi-Nekhtu, présente une
offrande à un colosse appelé « User-Maat-Re
Setep-en-Re le durable » ce qui est le prénom de
Ramsès II avec l’épithète de durable. Si l’on
examine la façon de représenter la statue, on
reconnaît que le dessinateur a dessiné de profil la
base, le pilier dorsal et la plus grande partie de son
modèle; mais, imbus de ses principes d’école, il
n’a pu résister à montrer les épaules de face. Son
collègue qui sculpta la seconde stèle a fait mieux
et son colosse est réellement figuré de profil. Ici,
le champ de la pierre
a été divisé en deux
registres : au-dessus
un homme, debout,
adore la statue ; en-
dessous, une femme
et une fillette parentes
de l’adorant, se joi-
gnent à son acte reli-
gieux en présentant
une table d’offrandes.
On peut croire que les
noms étaient peints
mais qu’ils ont dis-
paru.
Une particularité
encore doit être ob-
servée. Derrière le co-
losse on a gravé deux
oreilles. Depuis peu,
les représentations de
ce genre se sont mul-
tipliées, grâce surtout
aux découvertes de
Pétrie dans le Temple „ 0„_
de Memphis (i). On a fig
démontré qu’il s’agissait tout simplement de se
procurer ainsi les oreilles favorables du dieu en
les faisant plus proches de l’adorateur (2).
est fichée une plume tandis qu’à son oreille pend
une lourde boucle. Vers la droite, précisément
au-dessus de la cassure transversale on peut dis-
tinguer les restes d’une main d’un personnage qui
devait être dans la pose habituelle de l’adoration.
Le nègre était donc bien considéré ici comme
l’être divin qui recevait l’hommage du dévot.
Au dessus de sa tête deux courtes colonnes d’ins-
criptions nous donnent apparemment son nom,
mutilé des deux premiers signes que je crois pou-
voir lire Jmrq. On s’est servi pour écrire le nom
du dieu de l’écriture dite syllabique en usage
dès le moyen-empire
pour rendre en égyp-
tien les mots étran-
gers (1). Je le lis
hypothétique m ent
HDRGL. Je laisse à
de plus savants le soin
d’expliquer ce mot. Je
ne sais non plus rien
proposer au sujet des
restes de l’inscription
qui surmontait la figu-
re de l’adorant.
On voit tout l’inté-
rêt que présentent ces
petits monuments
s’écartant des types
ordinaires des stè-
les funéraires qui se
répètent indéfiniment
sans apporter à l’étude
TT „ beaucoup plus qu’un
4. nom ou un titre ou
encore un bout de formule plus ou moins rare.
Jean Capart.
*
* *
Voici enfin un curieux fragment de stèle acquis
à Gizeh en igo5 (E. 2385) et qui paraît appartenir
à l’époque du nouvel empire (fig. 4). On y recon-
naît, à gauche, un nègre qui était debout, les
mains appuyées sur un bâton ; dans sa chevelure
U) Voir Petrie, Memphis, t, I.
(2) Th. Deveria. Des oreilles et des yeux dans le sym-
bolisme de l'ancienne Egypte, dans Mémoires et frag-
ments, I, pp. 147 à 157.
DONS
Nous avons reçu de :
M. Georges Henroz, à Merbes-le-Château,
deux carreaux de revêtement vernissés en jaune
avec motifs de décoration, un oiseau, une rosace,
incisés. Ges carreaux sont de la fabrication de
Merbes-Poteries et datent de 1760 environ.
M. Jean Capart, une cruche en terre vernis-
sée de jaune, avec scènes figurées en relief, de la
fabrication de William Ridgway, à Henley, i835.
(1) A. Erman, Aegyptische Grammatik, 3e édition, § 8g.