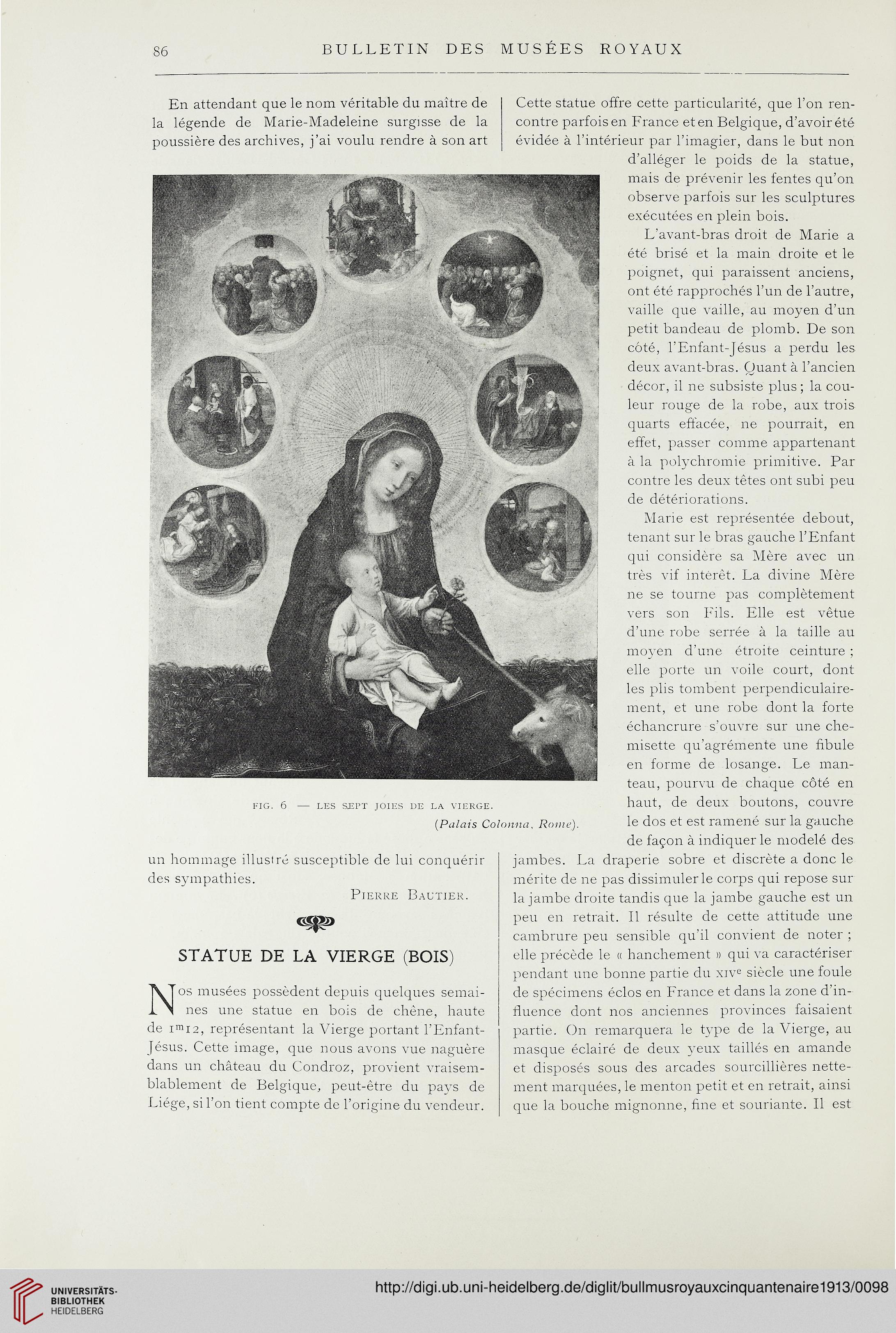86
BULLETIN DES MUSEES ROYAUX
En attendant que le nom véritable du maître de
la légende de Marie-Madeleine surgisse de la
poussière des archives, j’ai voulu rendre à son art
un hommage illustré susceptible de lui conquérir
des sympathies.
Pierre Bautier.
STATUE DE LA VIERGE (BOIS)
Nos musées possèdent depuis quelques semai-
nes une statue en bois de chêne, haute
de im12, représentant la Vierge portant l’Enfant-
Jésus. Cette image, que nous avons vue naguère
dans un château du Condroz, provient vraisem-
blablement de Belgique, peut-être du pays de
Liège, si l’on tient compte de l’origine du vendeur.
Cette statue offre cette particularité, que l’on ren-
contre parfois en France et en Belgique, d’avoir été
évidée à l’intérieur par l’imagier, dans le but non
d’alléger le poids de la statue,
mais de prévenir les fentes qu’on
observe parfois sur les sculptures,
exécutées en plein bois.
L’avant-bras droit de Marie a
été brisé et la main droite et le
poignet, qui paraissent anciens,
ont été rapprochés l’un de l’autre,
vaille que vaille, au moyen d’un
petit bandeau de plomb. De son
côté, l’Enfant-Jésus a perdu les
deux avant-bras. Quant à l’ancien
décor, il ne subsiste plus ; la cou-
leur rouge de la robe, aux trois
quarts effacée, ne pourrait, en
effet, passer comme appartenant
à la polychromie primitive. Par
contre les deux têtes ont subi peu
de détériorations.
Marie est représentée debout,
tenant sur le bras gauche l’Enfant
qui considère sa Mère avec un
très vif intérêt. La divine Mère
ne se tourne pas complètement
vers son Fils. Elle est vêtue
d’une robe serrée à la taille au
moyen d’une étroite ceinture ;
elle porte un voile court, dont
les plis tombent perpendiculaire-
ment, et une robe dont la forte
échancrure s’ouvre sur une che-
misette qu’agrémente une fibule
en forme de losange. Le man-
teau, pourvu de chaque côté en
haut, de deux boutons, couvre
le dos et est ramené sur la ga/uche
de façon à indiquer le modelé des
jambes. La draperie sobre et discrète a donc le
mérite de ne pas dissimuler le corps qui repose sur
la jambe droite tandis que la jambe gauche est un
peu en retrait. Il résulte de cette attitude une
cambrure peu sensible qu’il convient de noter ;
elle précède le « hanchement » qui va caractériser
pendant une bonne partie du xive siècle une foule
de spécimens éclos en France et dans la zone d in-
fluence dont nos anciennes provinces faisaient
partie. On remarquera le type de la Vierge, au
masque éclairé de deux yeux taillés en amande
et disposés sous des arcades sourcillières nette-
ment marquées, le menton petit et en retrait, ainsi
que la bouche mignonne, fine et souriante. Il est
FIG. 6 - LES SEPT JOIES DE LA VIERGE.
[Palais Colonna, Rome).
BULLETIN DES MUSEES ROYAUX
En attendant que le nom véritable du maître de
la légende de Marie-Madeleine surgisse de la
poussière des archives, j’ai voulu rendre à son art
un hommage illustré susceptible de lui conquérir
des sympathies.
Pierre Bautier.
STATUE DE LA VIERGE (BOIS)
Nos musées possèdent depuis quelques semai-
nes une statue en bois de chêne, haute
de im12, représentant la Vierge portant l’Enfant-
Jésus. Cette image, que nous avons vue naguère
dans un château du Condroz, provient vraisem-
blablement de Belgique, peut-être du pays de
Liège, si l’on tient compte de l’origine du vendeur.
Cette statue offre cette particularité, que l’on ren-
contre parfois en France et en Belgique, d’avoir été
évidée à l’intérieur par l’imagier, dans le but non
d’alléger le poids de la statue,
mais de prévenir les fentes qu’on
observe parfois sur les sculptures,
exécutées en plein bois.
L’avant-bras droit de Marie a
été brisé et la main droite et le
poignet, qui paraissent anciens,
ont été rapprochés l’un de l’autre,
vaille que vaille, au moyen d’un
petit bandeau de plomb. De son
côté, l’Enfant-Jésus a perdu les
deux avant-bras. Quant à l’ancien
décor, il ne subsiste plus ; la cou-
leur rouge de la robe, aux trois
quarts effacée, ne pourrait, en
effet, passer comme appartenant
à la polychromie primitive. Par
contre les deux têtes ont subi peu
de détériorations.
Marie est représentée debout,
tenant sur le bras gauche l’Enfant
qui considère sa Mère avec un
très vif intérêt. La divine Mère
ne se tourne pas complètement
vers son Fils. Elle est vêtue
d’une robe serrée à la taille au
moyen d’une étroite ceinture ;
elle porte un voile court, dont
les plis tombent perpendiculaire-
ment, et une robe dont la forte
échancrure s’ouvre sur une che-
misette qu’agrémente une fibule
en forme de losange. Le man-
teau, pourvu de chaque côté en
haut, de deux boutons, couvre
le dos et est ramené sur la ga/uche
de façon à indiquer le modelé des
jambes. La draperie sobre et discrète a donc le
mérite de ne pas dissimuler le corps qui repose sur
la jambe droite tandis que la jambe gauche est un
peu en retrait. Il résulte de cette attitude une
cambrure peu sensible qu’il convient de noter ;
elle précède le « hanchement » qui va caractériser
pendant une bonne partie du xive siècle une foule
de spécimens éclos en France et dans la zone d in-
fluence dont nos anciennes provinces faisaient
partie. On remarquera le type de la Vierge, au
masque éclairé de deux yeux taillés en amande
et disposés sous des arcades sourcillières nette-
ment marquées, le menton petit et en retrait, ainsi
que la bouche mignonne, fine et souriante. Il est
FIG. 6 - LES SEPT JOIES DE LA VIERGE.
[Palais Colonna, Rome).