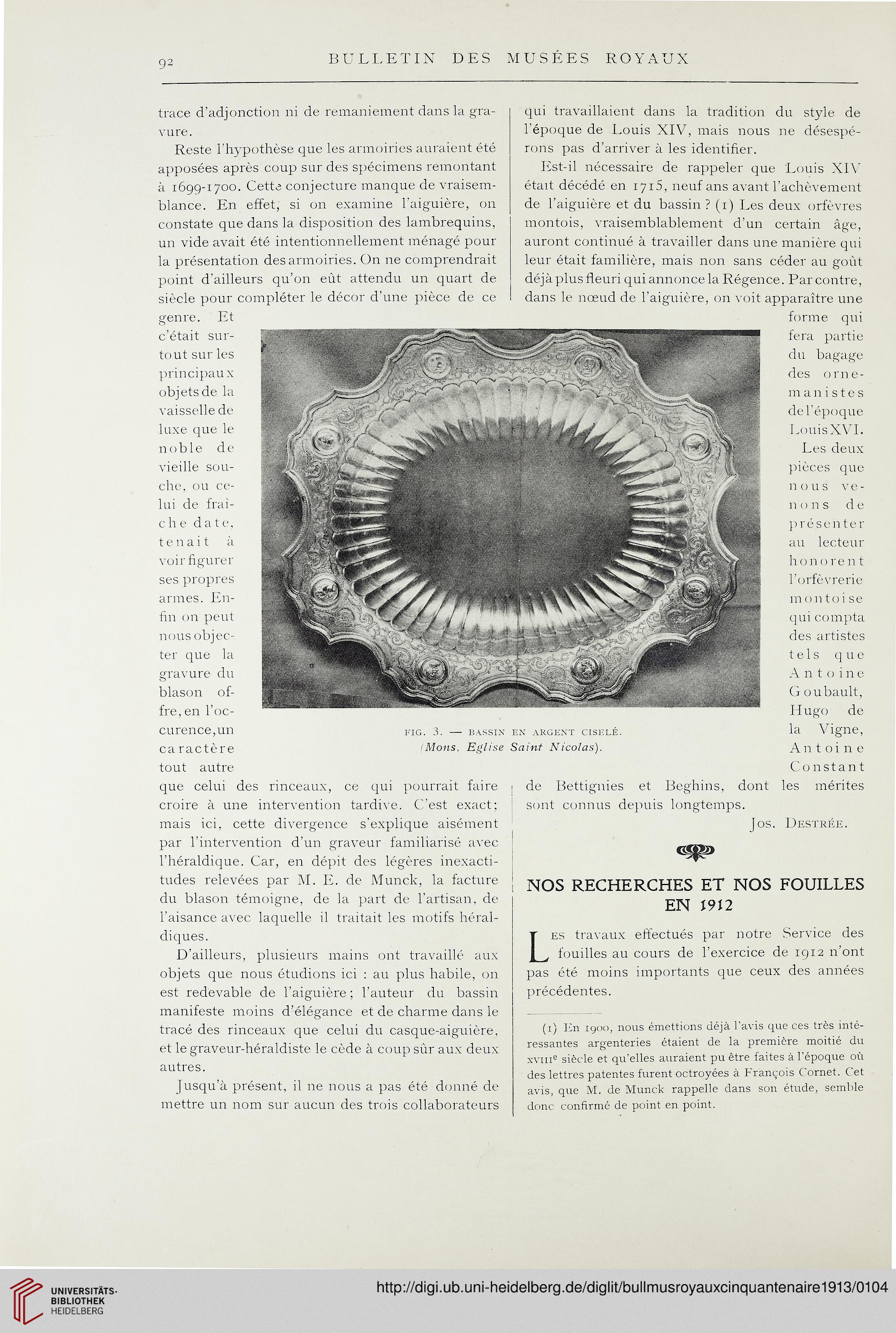92
BULLETIN DES MUSEES ROYAUX
trace d’adjonction ni de remaniement dans la gra-
vure.
Reste l'hypothèse que les armoiries auraient été
apposées après coup sur des spécimens remontant
à 1699-1700. Cette conjecture manque de vraisem-
blance. En effet, si on examine l’aiguière, on
constate que dans la disposition des lambrequins,
un vide avait été intentionnellement ménagé pour
la présentation des armoiries. On ne comprendrait
point d’ailleurs qu’on eût attendu un quart de
siècle pour compléter le décor d'une pièce de ce
genre. Et
c’était sur-
tout sur les
principaux
objets de la
vaisselle de
luxe que le
noble de
vieille sou-
che, ou ce-
lui de fraî-
che date,
tenait à
voir figurer
ses propres
armes. En-
fin on peut
nous objec-
ter que la
gravure du
blason of-
fre, en l’oc-
curence, un
caractère
tout autre
que celui des rinceaux, ce qui pourrait faire
croire à une intervention tardive. C’est exact;
mais ici, cette divergence s'explique aisément
par l’intervention d’un graveur familiarisé avec
l’héraldique. Car, en dépit des légères inexacti-
tudes relevées par M. E. de Munck, la facture
du blason témoigne, de la part de l’artisan, de
l’aisance avec laquelle il traitait les motifs héral-
diques.
D’ailleurs, plusieurs mains ont travaillé aux
objets que nous étudions ici : au plus habile, on
est redevable de l’aiguière ; l’auteur du bassin
manifeste moins d’élégance et de charme dans le
tracé des rinceaux que celui du casque-aiguière,
et le graveur-héraldiste le cède à coup sûr aux deux
autres.
Jusqu’à présent, il ne nous a pas été donné de
mettre un nom sur aucun des trois collaborateurs
qui travaillaient dans la tradition du style de
1 époque de Louis XIV, mais nous ne désespé-
rons pas d’arriver à les identifier.
Est-il trécessaire de rappeler que Louis XIY
était décédé en 1715, neuf ans avant l’achèvement
de l’aiguière et du bassin ? (1) Les deux orfèvres
montois, vraisemblablement d’un certain âge,
auront continué à travailler dans une manière qui
leur était familière, mais non sans céder au goût
déjà plus fleuri qui annonce la Régence. Par contre,
dans le nœud de l’aiguière, on voit apparaître une
forme qui
fera partie
du bagage
des orne-
manistes
de l’époque
Louis XVI.
Les deux
pièces que
n o u s ve-
nons de
présenter
au lecteur
honorent
l’orfèvrerie
m o n t o i s e
qui compta
des artistes
tels que
A n t o i n e
G oubault,
Hugo de
la Vigne,
Antoine
Constant
1 de Bettignies et Beghins, dont les mérites
sont connus depuis longtemps.
[os. Destrée.
I
1 NOS RECHERCHES ET NOS FOUILLES
EN Ï9I2
Les travaux effectués par notre Service des
fouilles au cours de l’exercice de 1912 n ont
pas été moins importants que ceux des années
précédentes.
(1) En 1900, nous émettions déjà l'avis que ces très inté-
ressantes argenteries étaient de la première moitié du
xvme siècle et qu’elles auraient pu être faites à l’époque où
des lettres patentes furent octroyées à François Cornet. Cet
avis, que M. de Munck rappelle dans son étude, semble
donc confirmé de point en point.
BULLETIN DES MUSEES ROYAUX
trace d’adjonction ni de remaniement dans la gra-
vure.
Reste l'hypothèse que les armoiries auraient été
apposées après coup sur des spécimens remontant
à 1699-1700. Cette conjecture manque de vraisem-
blance. En effet, si on examine l’aiguière, on
constate que dans la disposition des lambrequins,
un vide avait été intentionnellement ménagé pour
la présentation des armoiries. On ne comprendrait
point d’ailleurs qu’on eût attendu un quart de
siècle pour compléter le décor d'une pièce de ce
genre. Et
c’était sur-
tout sur les
principaux
objets de la
vaisselle de
luxe que le
noble de
vieille sou-
che, ou ce-
lui de fraî-
che date,
tenait à
voir figurer
ses propres
armes. En-
fin on peut
nous objec-
ter que la
gravure du
blason of-
fre, en l’oc-
curence, un
caractère
tout autre
que celui des rinceaux, ce qui pourrait faire
croire à une intervention tardive. C’est exact;
mais ici, cette divergence s'explique aisément
par l’intervention d’un graveur familiarisé avec
l’héraldique. Car, en dépit des légères inexacti-
tudes relevées par M. E. de Munck, la facture
du blason témoigne, de la part de l’artisan, de
l’aisance avec laquelle il traitait les motifs héral-
diques.
D’ailleurs, plusieurs mains ont travaillé aux
objets que nous étudions ici : au plus habile, on
est redevable de l’aiguière ; l’auteur du bassin
manifeste moins d’élégance et de charme dans le
tracé des rinceaux que celui du casque-aiguière,
et le graveur-héraldiste le cède à coup sûr aux deux
autres.
Jusqu’à présent, il ne nous a pas été donné de
mettre un nom sur aucun des trois collaborateurs
qui travaillaient dans la tradition du style de
1 époque de Louis XIV, mais nous ne désespé-
rons pas d’arriver à les identifier.
Est-il trécessaire de rappeler que Louis XIY
était décédé en 1715, neuf ans avant l’achèvement
de l’aiguière et du bassin ? (1) Les deux orfèvres
montois, vraisemblablement d’un certain âge,
auront continué à travailler dans une manière qui
leur était familière, mais non sans céder au goût
déjà plus fleuri qui annonce la Régence. Par contre,
dans le nœud de l’aiguière, on voit apparaître une
forme qui
fera partie
du bagage
des orne-
manistes
de l’époque
Louis XVI.
Les deux
pièces que
n o u s ve-
nons de
présenter
au lecteur
honorent
l’orfèvrerie
m o n t o i s e
qui compta
des artistes
tels que
A n t o i n e
G oubault,
Hugo de
la Vigne,
Antoine
Constant
1 de Bettignies et Beghins, dont les mérites
sont connus depuis longtemps.
[os. Destrée.
I
1 NOS RECHERCHES ET NOS FOUILLES
EN Ï9I2
Les travaux effectués par notre Service des
fouilles au cours de l’exercice de 1912 n ont
pas été moins importants que ceux des années
précédentes.
(1) En 1900, nous émettions déjà l'avis que ces très inté-
ressantes argenteries étaient de la première moitié du
xvme siècle et qu’elles auraient pu être faites à l’époque où
des lettres patentes furent octroyées à François Cornet. Cet
avis, que M. de Munck rappelle dans son étude, semble
donc confirmé de point en point.