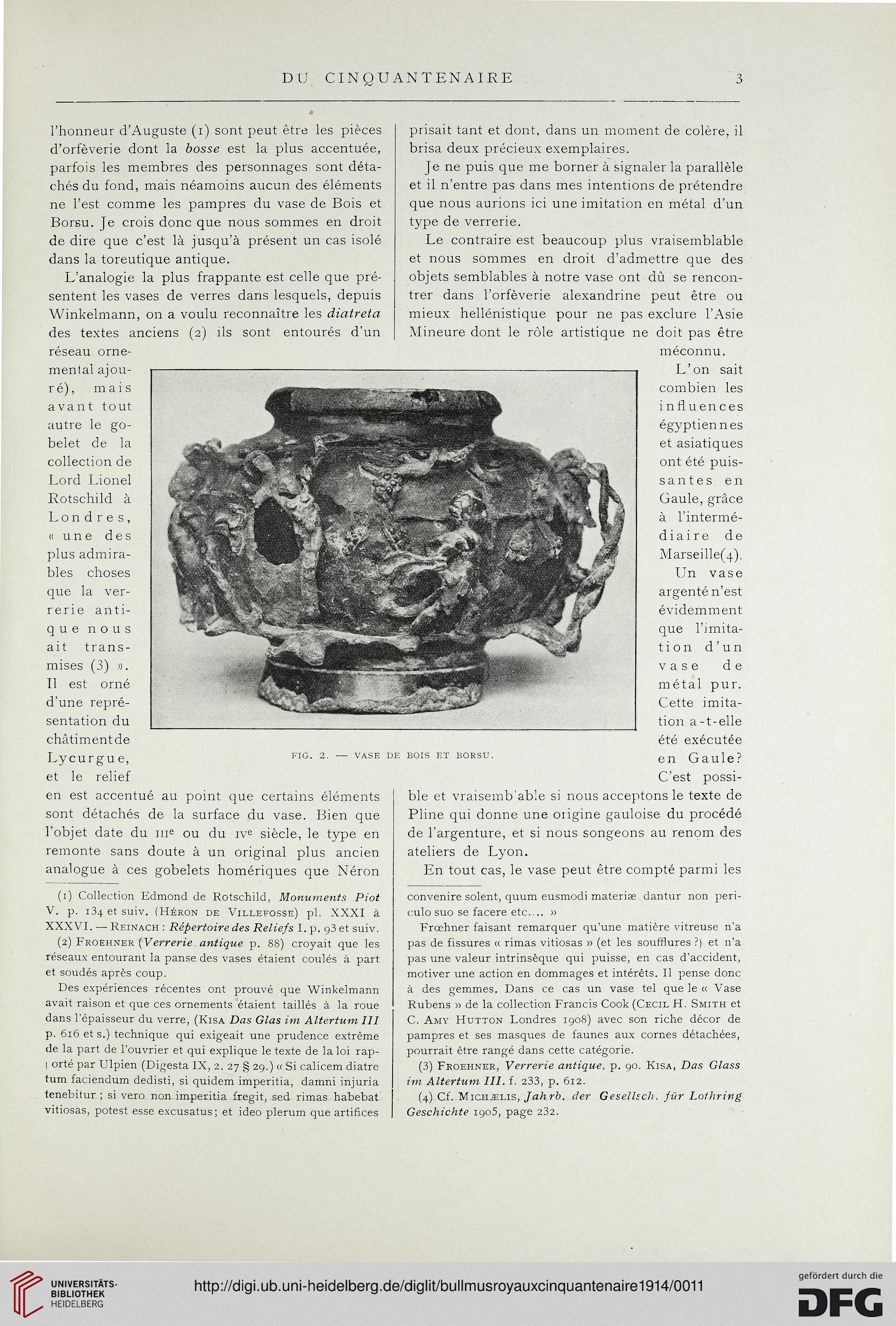DU CINQUANTENAIRE
3
l’honneur d’Auguste (i) sont peut être les pièces
d’orfèverie dont la bosse est la plus accentuée,
parfois les membres des personnages sont déta-
chés du fond, mais néamoins aucun des éléments
ne l’est comme les pampres du vase de Bois et
Borsu. Je crois donc que nous sommes en droit
de dire que c’est là jusqu’à présent un cas isolé
dans la toreutique antique.
L’analogie la plus frappante est celle que pré-
sentent les vases de verres dans lesquels, depuis
Winkelmann, on a voulu reconnaître les diatreta
des textes anciens (2) ils sont entourés d’un
réseau orne-
mental ajou-
ré), mais
avant tout
autre le go-
belet de la
collection de
Lord Lionel
Rotschild à
Londres,
« une des
plus admira-
bles choses
que la ver-
rerie anti-
que nous
ait trans-
mises (3) ».
Il est orné
d’une repré-
sentation du
châtiment de
Lycurgu e,
et le relief
en est accentué au point que certains éléments
sont détachés de la surface du vase. Bien que
l’objet date du 111e ou du ive siècle, le type en
remonte sans doute à un original plus ancien
analogue à ces gobelets homériques que Néron
(1) Collection Edmond de Rotschild, Monuments Piot
V. p. 134 et suiv. (Héron de Villefosse) pl. XXXI à
XXXVI. — Reinach : Répertoire des Reliefs I. p. g3et suiv.
(2) Froehner [Verrerie antique p. 88) croyait que les
réseaux entourant la panse des vases étaient coulés à part
et soudés après coup.
Des expériences récentes ont prouvé que Winkelmann
avait raison et que ces ornements étaient taillés à la roue
dans l’épaisseur du verre, (Kisa Das Glas itn Altertum III
p. 616 et s.) technique qui exigeait une prudence extrême
de la part de l’ouvrier et qui explique le texte de la loi rap-
I orté par Ulpien (Digesta IX, 2, 27 § 29.) « Si calicem diatre
tum faciendum dedisti, si quidem imperitia, damni injuria
tenebitur ; si vero non imperitia fregit, sed rimas habebat
vitiosas, potest esse excusatus; et ideo plerum que artifices
prisait tant et dont, dans un moment de colère, il
brisa deux précieux exemplaires.
je ne puis que me borner à signaler la parallèle
et il n’entre pas dans mes intentions de prétendre
que nous aurions ici une imitation en métal d’un
type de verrerie.
Le contraire est beaucoup plus vraisemblable
et nous sommes en droit d’admettre que des
objets semblables à notre vase ont dù se rencon-
trer dans l’orfèverie alexandrine peut être ou
mieux hellénistique pour ne pas exclure l’Asie
Mineure dont le rôle artistique ne doit pas être
méconnu.
L’on sait
combien les
influences
égyptiennes
et asiatiques
ont été puis-
santés en
Gaule, grâce
à l’intermé-
diaire de
Marseille^),
Un vase
argenté n’est
évidemment
que l’imita-
tion d’un
vase de
métal pur.
Cette imita-
tion a -t-elle
été exécutée
en Gaule?
C’est possi-
ble et vraisemb'able si nous acceptons le texte de
Pline qui donne une oiigine gauloise du procédé
de l’argenture, et si nous songeons au renom des
ateliers de Lyon.
En tout cas, le vase peut être compté parmi les * * 3 4
convenire soient, quum eusmodi materiæ dantur non peri-
culo suo se facere etc_ »
Frœhner faisant remarquer qu’une matière vitreuse n’a
pas de fissures « rimas vitiosas » (et les soufflures ?) et 11’a
pas une valeur intrinsèque qui puisse, en cas d’accident,
motiver une action en dommages et intérêts. Il pense donc
à des gemmes. Dans ce cas un vase tel que le « Vase
Rubens » de la collection Francis Cook (Cecil H. Smith et
C. Amy Hutton Londres 1908) avec son riche décor de
pampres et ses masques de faunes aux cornes détachées,
pourrait être rangé dans cette catégorie.
(3) Froehner, Verrerie antique, p. 90. Kisa, Das Glass
im Altertum III. f. 233, p. 612.
(4) Cf. Michælis, Jahrb. der Gesellsch. für Lothring
Geschichte igo5, page 232.
FIG. 2. - VASE de BOIS ET BORSU.
3
l’honneur d’Auguste (i) sont peut être les pièces
d’orfèverie dont la bosse est la plus accentuée,
parfois les membres des personnages sont déta-
chés du fond, mais néamoins aucun des éléments
ne l’est comme les pampres du vase de Bois et
Borsu. Je crois donc que nous sommes en droit
de dire que c’est là jusqu’à présent un cas isolé
dans la toreutique antique.
L’analogie la plus frappante est celle que pré-
sentent les vases de verres dans lesquels, depuis
Winkelmann, on a voulu reconnaître les diatreta
des textes anciens (2) ils sont entourés d’un
réseau orne-
mental ajou-
ré), mais
avant tout
autre le go-
belet de la
collection de
Lord Lionel
Rotschild à
Londres,
« une des
plus admira-
bles choses
que la ver-
rerie anti-
que nous
ait trans-
mises (3) ».
Il est orné
d’une repré-
sentation du
châtiment de
Lycurgu e,
et le relief
en est accentué au point que certains éléments
sont détachés de la surface du vase. Bien que
l’objet date du 111e ou du ive siècle, le type en
remonte sans doute à un original plus ancien
analogue à ces gobelets homériques que Néron
(1) Collection Edmond de Rotschild, Monuments Piot
V. p. 134 et suiv. (Héron de Villefosse) pl. XXXI à
XXXVI. — Reinach : Répertoire des Reliefs I. p. g3et suiv.
(2) Froehner [Verrerie antique p. 88) croyait que les
réseaux entourant la panse des vases étaient coulés à part
et soudés après coup.
Des expériences récentes ont prouvé que Winkelmann
avait raison et que ces ornements étaient taillés à la roue
dans l’épaisseur du verre, (Kisa Das Glas itn Altertum III
p. 616 et s.) technique qui exigeait une prudence extrême
de la part de l’ouvrier et qui explique le texte de la loi rap-
I orté par Ulpien (Digesta IX, 2, 27 § 29.) « Si calicem diatre
tum faciendum dedisti, si quidem imperitia, damni injuria
tenebitur ; si vero non imperitia fregit, sed rimas habebat
vitiosas, potest esse excusatus; et ideo plerum que artifices
prisait tant et dont, dans un moment de colère, il
brisa deux précieux exemplaires.
je ne puis que me borner à signaler la parallèle
et il n’entre pas dans mes intentions de prétendre
que nous aurions ici une imitation en métal d’un
type de verrerie.
Le contraire est beaucoup plus vraisemblable
et nous sommes en droit d’admettre que des
objets semblables à notre vase ont dù se rencon-
trer dans l’orfèverie alexandrine peut être ou
mieux hellénistique pour ne pas exclure l’Asie
Mineure dont le rôle artistique ne doit pas être
méconnu.
L’on sait
combien les
influences
égyptiennes
et asiatiques
ont été puis-
santés en
Gaule, grâce
à l’intermé-
diaire de
Marseille^),
Un vase
argenté n’est
évidemment
que l’imita-
tion d’un
vase de
métal pur.
Cette imita-
tion a -t-elle
été exécutée
en Gaule?
C’est possi-
ble et vraisemb'able si nous acceptons le texte de
Pline qui donne une oiigine gauloise du procédé
de l’argenture, et si nous songeons au renom des
ateliers de Lyon.
En tout cas, le vase peut être compté parmi les * * 3 4
convenire soient, quum eusmodi materiæ dantur non peri-
culo suo se facere etc_ »
Frœhner faisant remarquer qu’une matière vitreuse n’a
pas de fissures « rimas vitiosas » (et les soufflures ?) et 11’a
pas une valeur intrinsèque qui puisse, en cas d’accident,
motiver une action en dommages et intérêts. Il pense donc
à des gemmes. Dans ce cas un vase tel que le « Vase
Rubens » de la collection Francis Cook (Cecil H. Smith et
C. Amy Hutton Londres 1908) avec son riche décor de
pampres et ses masques de faunes aux cornes détachées,
pourrait être rangé dans cette catégorie.
(3) Froehner, Verrerie antique, p. 90. Kisa, Das Glass
im Altertum III. f. 233, p. 612.
(4) Cf. Michælis, Jahrb. der Gesellsch. für Lothring
Geschichte igo5, page 232.
FIG. 2. - VASE de BOIS ET BORSU.