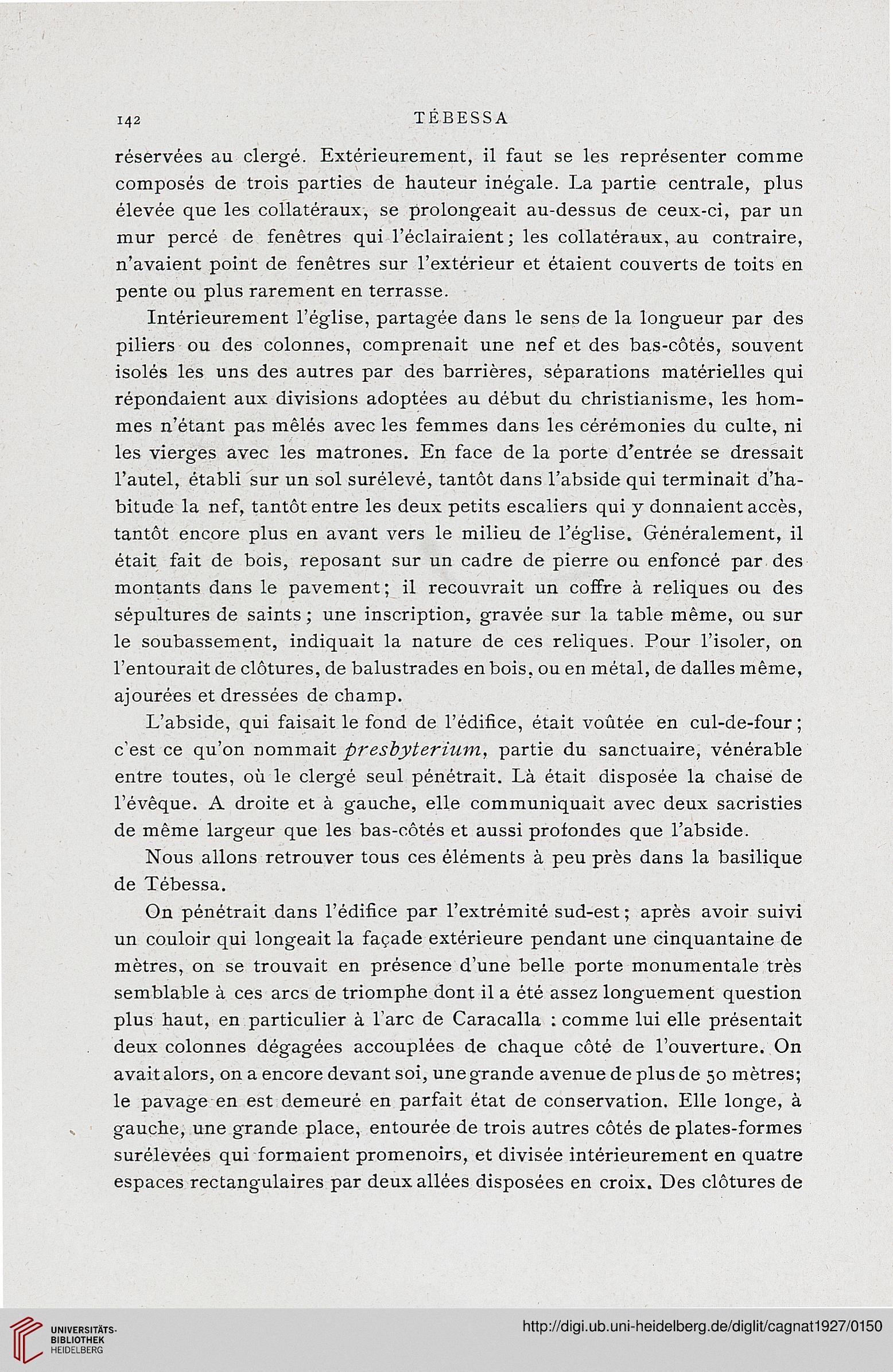i42 TÉBESSA
réservées au clergé. Extérieurement, il faut se les représenter comme
composés de trois parties de hauteur inégale. La partie centrale, plus
élevée que les collatéraux, se prolongeait au-dessus de ceux-ci, par un
mur percé de fenêtres qui l'éclairaient ; les collatéraux, au contraire,
n'avaient point de fenêtres sur l'extérieur et étaient couverts de toits en
pente ou plus rarement en terrasse.
Intérieurement l'église, partagée dans le sens de la longueur par des
piliers ou des colonnes, comprenait une nef et des bas-côtés, souvent
isolés les uns des autres par des barrières, séparations matérielles qui
répondaient aux divisions adoptées au début du christianisme, les hom-
mes n'étant pas mêlés avec les femmes dans les cérémonies du culte, ni
les vierges avec les matrones. En face de la porte d'entrée se dressait
l'autel, établi sur un sol surélevé, tantôt dans l'abside qui terminait d'ha-
bitude la nef, tantôt entre les deux petits escaliers qui y donnaient accès,
tantôt encore plus en avant vers le milieu de l'église. Généralement, il
était fait de bois, reposant sur un cadre de pierre ou enfoncé par des
montants dans le pavement ; il recouvrait un coffre à reliques ou des
sépultures de saints ; une inscription, gravée sur la table même, ou sur
le soubassement, indiquait la nature de ces reliques. Pour l'isoler, on
l'entourait de clôtures, de balustrades en bois, ou en métal, de dalles même,
ajourées et dressées de champ.
L'abside, qui faisait le fond de l'édifice, était voûtée en cul-de-four;
c'est ce qu'on nommait presbyterium, partie du sanctuaire, vénérable
entre toutes, où le clergé seul pénétrait. Là était disposée la chaisè de
l'évêque. A droite et à gauche, elle communiquait avec deux sacristies
de même largeur que les bas-côtés et aussi profondes que l'abside.
Nous allons retrouver tous ces éléments à peu près dans la basilique
de Tébessa.
On pénétrait dans l'édifice par l'extrémité sud-est ; après avoir suivi
un couloir qui longeait la façade extérieure pendant une cinquantaine de
mètres, on se trouvait en présence d'une belle porte monumentale très
semblable à ces arcs de triomphe dont il a été assez longuement question
plus haut, en particulier à Tare de Caracalla : comme lui elle présentait
deux colonnes dégagées accouplées de chaque côté de l'ouverture. On
avait alors, on a encore devant soi, une grande avenue de plus de 50 mètres;
le pavage en est demeuré en parfait état de conservation. Elle longe, à
gauche, une grande place, entourée de trois autres côtés de plates-formes
surélevées qui formaient promenoirs, et divisée intérieurement en quatre
espaces rectangulaires par deux allées disposées en croix. Des clôtures de
réservées au clergé. Extérieurement, il faut se les représenter comme
composés de trois parties de hauteur inégale. La partie centrale, plus
élevée que les collatéraux, se prolongeait au-dessus de ceux-ci, par un
mur percé de fenêtres qui l'éclairaient ; les collatéraux, au contraire,
n'avaient point de fenêtres sur l'extérieur et étaient couverts de toits en
pente ou plus rarement en terrasse.
Intérieurement l'église, partagée dans le sens de la longueur par des
piliers ou des colonnes, comprenait une nef et des bas-côtés, souvent
isolés les uns des autres par des barrières, séparations matérielles qui
répondaient aux divisions adoptées au début du christianisme, les hom-
mes n'étant pas mêlés avec les femmes dans les cérémonies du culte, ni
les vierges avec les matrones. En face de la porte d'entrée se dressait
l'autel, établi sur un sol surélevé, tantôt dans l'abside qui terminait d'ha-
bitude la nef, tantôt entre les deux petits escaliers qui y donnaient accès,
tantôt encore plus en avant vers le milieu de l'église. Généralement, il
était fait de bois, reposant sur un cadre de pierre ou enfoncé par des
montants dans le pavement ; il recouvrait un coffre à reliques ou des
sépultures de saints ; une inscription, gravée sur la table même, ou sur
le soubassement, indiquait la nature de ces reliques. Pour l'isoler, on
l'entourait de clôtures, de balustrades en bois, ou en métal, de dalles même,
ajourées et dressées de champ.
L'abside, qui faisait le fond de l'édifice, était voûtée en cul-de-four;
c'est ce qu'on nommait presbyterium, partie du sanctuaire, vénérable
entre toutes, où le clergé seul pénétrait. Là était disposée la chaisè de
l'évêque. A droite et à gauche, elle communiquait avec deux sacristies
de même largeur que les bas-côtés et aussi profondes que l'abside.
Nous allons retrouver tous ces éléments à peu près dans la basilique
de Tébessa.
On pénétrait dans l'édifice par l'extrémité sud-est ; après avoir suivi
un couloir qui longeait la façade extérieure pendant une cinquantaine de
mètres, on se trouvait en présence d'une belle porte monumentale très
semblable à ces arcs de triomphe dont il a été assez longuement question
plus haut, en particulier à Tare de Caracalla : comme lui elle présentait
deux colonnes dégagées accouplées de chaque côté de l'ouverture. On
avait alors, on a encore devant soi, une grande avenue de plus de 50 mètres;
le pavage en est demeuré en parfait état de conservation. Elle longe, à
gauche, une grande place, entourée de trois autres côtés de plates-formes
surélevées qui formaient promenoirs, et divisée intérieurement en quatre
espaces rectangulaires par deux allées disposées en croix. Des clôtures de